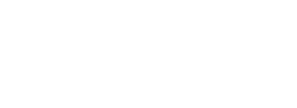Intranet
Accueil > Interviews & points de vue > Interview de Catherine Aubertin : développement durable, (...) |
Une interview exclusive de... Interview de Catherine Aubertin : développement durable, négociations climatiques...Catherine Aubertin (économiste, directrice de recherche, IRD) 2010 Après de longs séjour en Côte d’Ivoire, au Brésil et au Laos, Catherine Aubertin dirige le pôle « Politiques de l’environnement » de l’UR 199 à l’Institut de recherche pour le développement (IRD), et anime plusieurs groupes de recherche sur les questions du développement durable et de la biodiversité. Elle est membre du comité de rédaction de la revue Natures Sciences Sociétés. Voir sa bibliographie en fin d’interview. |
 |
Présentation et extraits en ligne
Dans cet entretien, Catherine Aubertin s’exprime sur le concept de développement durable, la situation écologique et le modèle de développement actuels, des outils internationaux comme le Protocole de Kyoto, sur la situation de la recherche en France...
Développement, développement durable, croissance, décroissance....
Que penses-tu de la définition officielle du développement durable « un mode de développement qui assure les besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures à assurer les leurs » - avec la suite qu’on oublie souvent « particulièrement les besoins des plus démunis » ?
Cette définition est l’une parmi des milliers... Je crois qu’il est important aussi de reconnaître la multiplicité des approches en termes de développement durable, même si celles-ci peuvent être jugées insuffisantes ou dévoyées, car si elles sont significatives de la difficulté à transformer le développement durable en objet politique, elles ouvrent sur la diversité des choix possibles pour l’humanité. La dernière partie de cette définition mérite en effet d’être rappelée car elle introduit la question de l’équité intragénérationnelle aux côtés de l’équité intergénérationelle. Ce qui m’intéresse dans cette définition, c’est cette notion de progression dans le temps, de nécessaire réflexion collective à long terme qui ne va pas du tout dans la logique du capitalisme, individualiste et de court terme. Sinon, le terme de « générations futures » permet de faire intervenir des gens qui ne sont pas là et de préjuger de leur bien, de leurs devoirs ou des devoirs qu’on aurait vis-à-vis d’eux… Il y a ce côté culpabilisant...
N’est-ce pas une forme de maturité de l’espèce humaine que de penser aux gens qui ne sont pas nés ?
Ca pourrait l’être, effectivement.Mais quand on se trouve dans des négociations internationales, et qu’aux générations futures certains ajoutent la biosphère, la nature, la terre, le souffle des forêts, tous ceux qui ne s’expriment pas, les sans voix qu’on appelle les « tiers absents », etc., toutes les manipulations sont possibles. Ces générations futures « espèce humaine » sont convoquées selon les besoins, souvent pour la rhétorique. Qui est le porte-parole légitime des générations futures ? La question est intéressante. Qui a le droit de parler au nom des générations futures ? Souvent la justice et l’éthique vis-à-vis des générations future apparaissent via le choix d’un taux d’actualisation ou de la prise en compte de phénomènes d’irréversibilité qui ne reflètent pas les préférences pour le présent…
Penses tu que l’humanité puisse disparaître ?
Des civilisations sont déjà mortes. L’espèce humaine est parfaitement capable de s’auto-exterminer. Mais il restera bien quelques groupes humains. Sur cette question, il faut plutôt voir dans les bandes dessinées et dans les romans d’anticipation…
Que penses-tu de certaines analyses écologistes radicales disant que l’espèce humaine pourrait être un raté de l’évolution, dont la planète se déferait in extremis, puisque cette espèce menace les équilibres globaux, afin de préserver le vivant ?
C’est là aussi une vision du tiers-absent. C’est l’humain qui parle au nom de la planète, qui l’imagine se dire : « Zut, il y a cette pustule qui me gêne, là, qui s’appelle l’humanité ». L’image est amusante, mais c’est une vision anthropocentrée… Ce sont les hommes eux-mêmes qui organiseront leur disparition en détruisant les ressources de la planète. Inutile d’invoquer la déesse Gaia ou des forces extérieures.
Le problème n’est il pas celui de l’hyperconsommation des riches ?
Les pauvres consomment aussi pour leurs besoins. En économie on a la courbe en cloche de Kuznets, qui dit que pour se développer, les pays sont obligés de détruire les ressources naturelles dans un premier temps.Puis quand ils sont en haut de la cloche et ont atteint un niveau de développement suffisant (et l’on suppose, qu’ils rencontrent aussi des limites d’utilisation des ressources naturelles) ils vont finalement faire attention à leur environnement. La courbe va redescendre et on va commencer à protéger la planète, la biodiversité, etc. Ce serait quelque chose de mécanique, des jeux de simple transition. Nous serions arrivés à un nouveau stade du capitalisme où on commence à intégrer l’environnement, permettant de continuer le mode de développement économique actuel. De la même façon qu’il devait intégrer la question sociale à la fin du 19ème siècle, le capitalisme doit maintenant intégrer la question environnementale.
Existe t-il un autre modèle possible que le capitalisme ?
Le capitalisme a très bien su intégrer les mots d’ordre du développement durable. Ainsi, les entreprises ont bien su adapter les lois sur la responsabilité sociale et environnementale (RSE) via des engagements volontaires et se jouent de la multiplication des normes et du « reporting » développement durable. Pour l’instant, on ne sait pas ce qui peut sortir des acteurs qui proposent des alternatives radicales, comme les alter-mondialistes ou certains tenants de l’économie solidaire ou de la décroissance. Aucune force politique n’apparaît clairement. En revanche, on observe des propositions disparates, des multitudes d’initiatives solidaires, comme par exemple les systèmes d’échange local (SEL). C’est pour le moment assez souterrain.
Que penses tu de l’optique de Gus Massiah dont la définition du développement serait « processus de transformation sociale » ?
A l’origine la notion de développement vient de la biologie. C’est une modification qualitative qui accompagne la croissance de l’individu, ce qui fait qu’on n’obtient pas un oeuf géant, mais un poulet. En économie, l’accumulation quantitative (la croissance) doit se fait d’abord, et après les choses s’arrangent autrement, et sont supposées permettre une transformation qualitative. On répartirait alors mieux les richesses, on penserait à d’autres formes d’épanouissement de l’individu, à la protection de l’environnement. Ce serait ça le développement. Le problème reste qu’on ne sort toujours pas de la confusion entre croissance et développement. Quand on travaille avec les pays du Sud, on voit bien que le développement aujourd’hui est d’abord compris comme la croissance. Cela a d’ailleurs été le discours unanime de la campagne présidentielle, en France comme au Brésil. Oui, bien sûr, le développement est un processus de transformation sociale. Cette transformation est liée aujourd’hui à la prise de conscience du bouleversement de la planète dû aux changements globaux, mais surtout elle viendra de la capacité d’apprentissage et d’échange de l’ensemble des acteurs, des politiques, des consommateurs et des citoyens, des scientifiques et des détenteurs de savoirs non scientifiques comme les ONG, privés, naturalistes amateurs... La question centrale est d’organiser les passerelles et les réseaux, les négociations et les concertations.
Et la croissance durable ?
C’est une plaisanterie et les économistes jusqu’aux Trente glorieuses n’y croyaient pas. La croissance avec les modes de consommation et de production actuels est impossible. On est limités par un stock fini de ressources et d’énergie.
Changement climatique, conventions internationales
Le changement climatique constitue-t-il un obstacle à la croissance et au développement ?
Non au contraire ! Je crois que le traitement du changement climatique tel qu’il est amorcé va sauver pour un temps le capitalisme. C’est un coup de génie dont on n’a pas encore vraiment mesuré tout ce qu’il allait apporter. Le changement climatique va réconcilier absolument tout le monde et donner un objectif commun simple, avec une vision technique d’ingénieur. On a vu récemment que la lutte contre le changement climatique se mariait bien avec la rhétorique de la « croissance verte » et donnait ainsi un contenu tangible au développement durable. Là aussi, on part de la crise pour la transformer en opportunités. Le Grenelle de l’environnement a lourdement insisté sur toutes ces nouvelles niches offertes par les technologies « vertes » en matière d’innovation, d’emploi, de profit... Il prévoyait la création de 600 000 emplois grâce à la mise aux nouvelles normes environnementales dans l’énergie, les transports, l’habitat, l’agriculture… Il faut noter qu’ici c’est l’environnement qui vient au secours de l’économie, avec l’intervention forte de l’Etat. La croissance verte serait une sorte de développement durable où l’Etat reprendrait sa place. Pour certains, la lutte contre le changement climatique se résumerait à imaginer cette croissance verte basée sur des innovations techniques garantissant une économie de basse teneur en carbone.
Là, on est vraiment loin de la complexité du problème soulevé par la biodiversité, qui était liée au culturel, aux populations qui pendant des générations avaient amélioré leurs semences, leurs ressources, etc. Toutes les questions d’environnement semblent se ramener au changement climatique. La convention sur la diversité biologique, celle sur la désertification, tous ces problèmes qui remettaient en cause les relations humains/nature se trouvent englobés dans le climat. En fait, la biodiversité est vue comme une infrastructure naturelle pour lutter contre le changement climatique. C’est ce que l’on observe avec les mécanismes REDD (réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation) où les forêts sont vues comme des puits de carbone. Les dimensions sociale et économique tendent à s’estomper dans cette dimension environnementale prise en charge par la une vision de comptabilité de tonnes de carbone.
Le Protocole de Kyoto a-il un impact ?
Toutes les conventions internationales ont leur dynamique propre, qui, souvent, oublient très vite l’apport des scientifiques au profit des rapports de force géopolitiques qui débouchent sur des outils économiques et juridiques. Théoriquement, le marché des crédits carbone est une application d’un outil économique sur un problème d’environnement, qui, à terme, devrait jouer sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C’est extrêmement intéressant, mais faire fonctionner ce marché nécessite énormément d’encadrement administratif - il faut que les industriels s’entendent, que les États jouent le jeu ; en termes économiques ça demande énormément de « coût de transaction » pour entrer sur le marché.
Cette mise en marché d’un problème environnemental a d’abord concerné les pays industrialisés. Le Protocole ne concerne en effet que les pays industrialisés responsables historiques de l’accumulation de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Avec la fin de la période Kyoto, en 2012, il faudra bien que les pays du Sud participent à l’effort de réduction des émissions de GES. Donc cette nouvelle marchandise carbone va aussi être adoptée par les pays du Sud. Aussi, des pays du Sud s’organisent, des bourses parallèles se mettent en place, des bourses de produits carbone reposant sur des émissions évitées.
J’ai été étonné d’entendre le responsable de la coordination des Indiens de l’Amazonie brésilienne, qui comptait instaurer sa propre bourse de crédit carbone, dire : « nous contribuons au développement durable, nous n’abattons pas la forêt, nous n’émettons pas de carbone,donc ça vaut tant de dollars ». Et ces crédits vont être vendus à des ONG, des industriels, pour donner bonne conscience à tout le monde. On est dans la quintessence du marché, comme abstraction. C’est la construction économique qui prime. Il faut que chacun apporte des preuves quant au fait qu’il contribue à la non-émission de carbone. Pour le moment c’est un marché virtuel, qui s’élabore de toutes pièces devant nous, grâce à la volonté qu’ont ses promoteurs d’y croire.C’est passionnant sur le plan intellectuel et largement déconnecté des connaissances des scientifiques du climat sur les échanges atmosphère-océan, sur les rétroactions, sur tous ces aspects extrêmement complexes, etc. C’est pourquoi on peut parler de construction sociale d’un problème d’environnement
La tonne de carbone se mesure facilement. Si on sait qui l’a émise (donc qui est responsable du dommage et qui doit le compenser), la question de sa valorisation est presque résolue. Il faut alors identifier un fournisseur vertueux du service de séquestration de carbone pour créer un marché. Très vite, on a pu lier le problème du changement climatique à des quantités et à des compensations financières. Pour la biodiversité, on tournait autour du pot - sans doute pour des raisons éthiques - donner un prix à un ours blanc, à un panda, à une fleur, c’est donner un prix à la vie, car la biodiversité s’assimile à la vie. Il y a des équivalents pétrole, des équivalents carbone entre les différents GES. A partir de là, le marché va pouvoir s’installer de façon plus facile.
C’est l’apothéose du marché ?
C’est l’apothéose du marché. Mais en même temps, pour un économiste, ce n’est pas un marché. Il est beaucoup trop institutionnalisé et encadré. Dans un marché, des consommateurs rencontrent des producteurs, des prix et des quantités s’établissent. Ici, la machine qui se met en route pour établir un marché, distribuer des quota, c’est vraiment de l’économie administrée, et même planifiée à la soviétique. A vrai dire, c’est plutôt l’apothéose du référentiel marchand. Car des émissions de carbone non émises, c’est vraiment une marchandise immatérielle. Des éléments de l’environnement, deviennent des marchandises, ils ont des prix et on les échanges. En échangeant, on va réduire les émissions de GES et en plus on va faire de l’argent et en plus on va récupérer l’éthique, en équilibrant émissions et non émissions afin de rester en deçà d’un seuil admissible de pollution pour protéger la planète.
Ca devient même une démarche individuelle, par ex. la compensation carbone
Tout le monde s’y met. Chacun peut calculer ses émissions. J’ai récemment récupéré dans un supermarché un carnet où les clients peuvent calculer leur consommation de C02. C’est là que tu t’aperçois que tu peux toujours trier tes poubelles et ne pas laisser couler l’eau en te brossant les dents, dès que tu prends ta voiture ou l’avion, c’est raté.
Tu ne compenses pas tes émissions carbone quand tu vas en mission en Amazonie ?
Non, pas pour le moment, cela ne fait pas partie du budget mission. Mais effectivement de nombreuses entreprises le font déjà. En France, je crois que l’Agence française de développement (AFD) le fait. Le gouvernement brésilien propose de calculer les coûts de réunion des administrations –le Brésil étant très vaste, ils doivent voyager beaucoup pour les réunions- et d’établir un fonds carbone… Pourquoi ne pas proposer qu’il serve à racheter les crédits des Amérindiens…
La grande question ici est qui va certifier ces crédits, qui va organiser et contrôler leurs échanges. Des dérives sont inévitables.
N’est ce pas aussi l’apothéose de grands enfants à cravates qui jouent au monopoly ?
Oui, mais on était déjà là-dedans avec le développement de l’économie financière, avec toutes ces histoires de golden boys qui conçoivent de nouveaux produits financiers et qui jouent sur toutes les bourses du monde. On est dans une situation de dématérialisation des échanges. Quand tu achètes un téléphone portable, tu n’achètes pas le prix de la main-d’oeuvre ou les matériaux pour le produire, tu dois acheter pour au moins 80 % de droits de propriété intellectuelle, de royalties sur des brevets. Pour les semences de coton de Monsanto, on estime que 70 % des coûts sont des royalties. On est dans l’économie de la connaissance. Ce sont ces jeux de brevets qui créent de la richesse. Entre le jeu des brevets et le jeu de la finance, on est dans une société prête à admettre ces nouvelles constructions « carbone ». Sans compter que pour avoir des crédits carbone, il va sûrement falloir breveter de nouveaux mécanismes et de nouvelles technologies de réduction de consommation d’énergie.
L’Afrique, qui est très concernée par le changement climatique n’apparaît-elle pas absente du débat ?
La politique française en Afrique se résume surtout à faire de l’adaptation, de l’aide conditionnelle au développement. Le ministère français des affaires étrangères propose à l’Afrique de financer des stratégies d’adaptation. Ca fait pourtant un bout de temps que les Africains du Sahel ont appris à vivre avec la sécheresse. Quand il s’agit de l’Afrique, il y a une démarche caritative et humanitaire, avec surtout en arrière-plan la volonté de limiter les migrations.
En Amérique Latine, on se trouve face à des populations qui disent : au nom de la responsabilité commune mais différenciée, il faut une politique de compensation. On rencontre des Amérindiens qui nous disent : « Nous, on va faire notre bourse de carbone et vous les Blancs, vous serez bien obligés de nous verser des compensations ». Le Brésil est leader dans les négociations sur la déforestation évitée, en position de revendication, en jetant la faute sur la civilisation industrielle. Alors qu’en Afrique, c’est : il faut nous aider. Ou plutôt c’est comme ça que le ministère des Affaires étrangères français et certaines ONG le traduisent. D’un côté nous avons l’adaptation - limiter les dégâts, fixer les populations - et de l’autre la limitation – agir pour réduire les émissions de GES - par ces marchés de crédits d’émissions, de compensation. Cela ne veut pas dire que les pays forestiers du bassin du Congo ne commencent pas à s’organiser dans le cadre de la déforestation évitée, ni que les pays d’Amérique latine ne travaillent pas aussi sur l’adaptation. C’est la conception de l’aide publique au développement qui est ici mise à mal.
Pourtant ce sont les Africains qui émettent le moins de GES et qui devraient bénéficier de quotas pour se développer
C’est absolument juste. Ils devraient mieux faire valoir cette réalité. Cependant on entend moins ce discours en Afrique, du moins il n’est pas porté de façon aussi combative qu’ailleurs. Ce sont peut-être les habitudes coloniales qui maintiennent un couvercle là-dessus, qui fait qu’on trouve que l’adaptation au changement climatique c’est ce qui faut pour les populations africaines. En même temps, on admet que les Africains émettent peu de GES et qu’ils ont donc un droit à revendiquer quelque chose, voire à utiliser des énergies fossiles. Cependant la France fait un effort réel pour permettre aux pays africains d’apparaître sur la scène des négociations internationales.
Y a t il eu des avancées lors des dernières conférences d’environnement à Nagoya et à Cancun ?
Avec l’entrée des pays du Sud dans les négociation de la convention climat les discussion ont été moins cadrées par les outils économiques et moins focalisées sur l’énergie. La question de la conservation des forêts va pouvoir être prise en compte. Avec les compensations pour la « déforestation évitée » annoncées par les mécanismes REDD, nous allons vite entrer dans une ère de marchandage revendicatif Sud-Nord et dans ce cas, nous serons loin du modèle économique du marché instauré à Kyoto.
Par ailleurs, il est intéressant d’observer la convergence des grandes conventions biodiversité et climat, à Nagoya et à Cancun. S’y dessine encore une autre définition du développement durable. Au départ, ces conventions se concentraient sur des préoccupations environnementales strictement techniques et scientifiques. Elles affichent désormais trois grandes priorités : une nouvelle économie verte, à basse teneur en carbone et fortes technologies, qui intégrerait les atteintes à l’environnement dans les comptes nationaux ; une gouvernance internationale de l’environnement où seraient reconnus les droits de chacun dans un cadre de justice climatique ; enfin, l’éradication de la pauvreté. Cela renouvelle la définition avec les trois piliers (économie/environnement/social), mais la forme politique du développement durable et la prise en compte des changements globaux pour imaginer les changements sociaux, restent toujours en suspens.
La recherche française sur le développement
Parlons de la situation de la recherche. Est-on distancés en France en matière de recherche ? L’IRD est en restructuration. Que devient la recherche française sur le développement ? Y a-t-il une école française en la matière ?
Le gros avantage de la France, c’est le fait que très vite on ait pu, dans divers instituts de recherche et du fait de nos relations avec les pays du Sud – l’IRD était on avance dans ce domaine – à la fois remettre en cause le concept de développement universel et faire le lien entre l’environnement et le développement. Ca rejoint la notion d’écodéveloppement développée par Ignacy Sachs. En France, parce qu’il y avait ce corps de chercheurs qui travaillaient à l’étranger en coopération avec les scientifiques locaux, mais aussi les organisations villageoises, on a vu très vite comment l’environnement pouvait avoir des liens avec le développement, et aussi développer le thème de la gestion des ressources naturelles. Très vite, on a raisonné en termes de gestion des ressources, gestion des forêts tropicales, des sols, de politiques publiques sur le foncier, etc. Cette notion de gestion dans les pays tropicaux a été le terreau d’une réflexion sur ces liaisons entre environnement et développement et le lieu d’expression de pluridisciplinarités scientifiques. Des économistes pouvaient travailler avec des sociologues, des hydrologues, des pédologues, des agronomes… d’autant plus qu’il y avait également l’aspect santé. L’IRD a été créée aussi pour les grandes endémies, pour les maladies tropicales. On observait bien comment les maladies tropicales étaient liées aux conditions sanitaires et sociales et aux modifications de l’environnement.
Dans mon unité de recherche, on passe des Conventions internationales aux politiques publiques locales, de la relation entre la gestion locale d’une forêt à la création de marchandises (ressources génétiques, crédits carbone) pour le marché international. Cette recherche de terrain qui articule local et global est très riche. On a à la fois cette connaissance des terrains, cette observation de la fabrication des discours au Nord et au Sud, des positions qui arrivent jusqu’aux Conventions internationales et, dans l’autre sens, comment les Conventions sont utilisées localement, sont appropriées ou non par des groupes locaux. Je pense que la France est en avance là dessus, mais ne valorise pas suffisamment ces acquis.
Est-ce que cette dynamique originale va pouvoir continuer ?
La partie « coopération » de notre travail est mal reconnue dans les réformes de l’universté et de la recherhce. Le passage des unités de recherche dans des UMR de l’université, va porter un grave coup à la pluridisciplinarité et aux relations internationales propres à la recherche en coopération. Nous sommes entrés dans un monde très ritualisé avec obligation de publier dans des revues internationales extrêmement formatées. Les Français ont beaucoup de mal dans ce domaine, ne savent pas bien s’exprimer dans une langue étrangère dans ces formats spécifiques, surtout en sciences sociales où la forme de l’expression est primordiale. Nous sommes mieux lotis que les universitaires, mais la part d’administration dans notre travail ne fait qu’augmenter, avec de plus en plus de nécessité de répondre à des appels d’offre sur des sujets prédéterminés, souvent en décalage avec les enjeux de la recherche. Le manque de recrutement de jeunes chercheurs est mortifère pour les équipes.
Vers une société durable ?
Finalement, est-ce que tu garderais la notion de développement durable ?
Oui. De toute façon le coup est parti. On a même un ministre du développement durable. Après tout, ce n’est pas une notion qui ne recouvre rien. Il est intéressant de voir comment chaque corporation, chaque groupe s’approprie le terme, ce qu’il y met. C’est un sujet d’étude. Qu’est ce que le développement durable pour le gouvernement ? L’après-Grenelle permet d’avoir des doutes. Nous avons vu que pour les entreprises, le développement durable est en train de se stabiliser autour de la RSE qui codifient des normes de qualité. C’est une définition du développement durable encadrée juridiquement, formée d’un mélange de bonnes pratiques, d’indices, de labels. C’est une construction intéressante à observer, tout en voyant bien qu’elle ne remet pas en cause l’essentiel, c’est-à-dire le principe d’accumulation. Mais cela modifie le fonctionnement interne des entreprises et certaines valeurs. Les grandes écoles et les universités ont maintenant des filières développement durable, considérées comme un atout technique supplémentaire à la production, au commerce. Ces itinéraires développement durable ont lieu aussi bien chez les ingénieurs que chez les commerciaux ou les administratifs. Ce sont des nouvelles recettes.
Toute cette accumulation de « bonnes pratiques » pourrait-elle faire basculer la civilisation vers le durable ?
Sans compter la formidable accumulation de savoir ! Mais il me semble que ça ne remet pas en cause l’essentiel, la production, la croissance, le fait d’accumuler toujours plus. Regardons en France comment se négocient la réforme des retraites. Les tensions sociales nous rappellent que le développement durable est d’abord une tentative de résolution des conflits.
Cette accumulation perpétuelle d’objets, est-elle inhérente à l’espèce humaine ?
Non, les anthropologues ont bien montré que l’accumulation et le surplus était plutôt un problème pour les sociétés dites primitives, qui sont obligées de distribuer les surplus régulièrement (par exemple dans le cas du Potlatch, ou du don). La gestion des surplus a constitué un problème pour ces sociétés. Le besoin d’accumulation est vraiment inhérent au capitalisme, entretenu par tous les moyens possibles : télévision, globalisation, modèle… Dans n’importe quel village, on a accès à des séries américaines, de consommation, où la vie semble facile. On enseigne aux gens qu’ils sont pauvres parce qu’ils ne consomment pas. Tout concourt pour nous convaincre que les besoins matériels sont illimités.
Le mouvement de la « décroissance », rappelle que les valeurs de modestie, de frugalité, en respectant son environnement ont toujours existé. Le terme décroissance recouvre des écoles théoriques différentes et des pratiques différentes. Des gens d’extrême droite attachés aux vertus locales peuvent se reconnaître dans certaines branches de la décroissance. On tend à admettre qu’il va falloir vivre avec moins d’énergie, mais en a-t-on mesuré toutes les conséquences ? Peut-on imaginer des villes qui ne soient pas éclairées la nuit, la fin de la voiture et des transports longue distance ? Il y a beaucoup de choses difficilement envisageables actuellement. Des possibilités techniques étonnantes existent pourtant, comme les maisons non seulement neutres en énergie mais qui en produisent. Pour l’instant on reste à des solutions, des innovations techniques, sans passer à une réflexion sur des comportements, sur le vivre ensemble. Il y a beaucoup d’investissements dans les technologies d’économies d’énergie, mais peu de réflexion sur ce que serait une société peu consommatrice d’énergie. La parole a été prise par les ingénieurs, comme pour le changement climatique.
Est ce qu’il y a un facteur social et culturel lié au « genre », sachant que les ingénieurs sont majoritairement des hommes ?
La priorité aux solutions techniques est-elle particulièrement masculine ? Ce serait postuler que les femmes sont plus sensibles aux relation humaines qu’aux techniques. Il est plus facile de réfléchir en termes techniques, de donner des réponses techniques. Si on pousse à bout ce qu’il faudrait faire en termes de comportements et de réponse sociale, on entre dans l’inconnu. Ne plus manger de viande, ne plus utiliser de voiture, c’est une remise en cause totale. La technique est rassurante. Et elle a vraiment des résultats qui peuvent être formidable, dans le bâtiment, les ampoules basse consommation, etc. Les ingénieurs ont réussi techniquement à diminuer par 4 et même plus la consommation d’énergie de certains appareils. Le problème, c’est qu’on consomme plus, même si par unité de production certaines consommations sont divisées par plus de 4. Les matériaux intelligents dans la construction seront efficaces à partir du moment où on interdira les maisons individuelles, car il faudra bien regrouper les gens. On va bien aussi devoir interdire les voitures, etc. Ca, socialement, on ne peut pas l’imaginer à court terme. Certes, le court terme en économie, c’est 3-7 ans, le long terme ça doit commencer dans 5 à 10 ans. Mais même en l’espace d’une génération on voit mal ces changements intervenir ou alors effectivement, ce serait à la suite d’un très gros traumatisme. Cela montre bien que la technique toute seule n’est pas suffisante.
Ces formidables innovations dans le domaine de l’énergie et qui donc bénéficient de subventions, d’incitations, trouvent tout de suite des marchés et sont une nouvelle voie de développement du capitalisme, comme le DD en général. Le marché vend maintenant de la technique de réduction d’énergie, des techniques basées sur cette nécessité de réduction de l’énergie. C’est un nouveau moteur. Il y a eu le moteur des droits de propriété intellectuelle, là aussi de l’immatériel. On va créer des matériaux intelligents, mais sur chaque brique intelligente, on aura une dizaine de brevets.
C’est difficile de faire des pauses. Des voies de réflexion apparaissent, on s’engouffre, on s’emballe. On voit ce qui se passe avec les biocarburants : présentés comme une panacée, ils sont maintenant fort critiqués. Le progrès technique n’est-il pas immédiatement rattrapé par l’idéologie de la croissance ? Peut-on produire plus et consommer moins ? A l’origine, pour les théoriciens du facteur 4, la question n’était pas de diviser par 4 la production d’énergie, mais de produire deux fois plus avec deux fois moins d’énergie...
Le développement durable est censé mettre en avant ce genre de propositions, mais ça n’avance guère. En France existe pourtant une réflexion, une fonction publique, dans les ministères des gens réfléchissent, des universitaires, des urbanistes écrivent, etc. Il y a beaucoup de possibles, mais on est encore dans le domaine d’une certaine science-fiction.
Mais ces gens qui réfléchissent ne mettent pas forcément eux-mêmes en pratique ?
Oui, mais mettre en pratique, c’est tellement dérisoire quand il n’y a pas de vision politique globale. Ne pas faire couler le robinet, d’accord. Mais par rapport à la guerre en Irak et les puits de pétrole qui flambent, à la marée noire dans le golfe du Mexique, j’ai l’impression qu’on demande un effort dérisoire. D’un point de vue politique, se cantonner à cet instrument qu’est le marché des permis d’émissions ne suffit pas. Même si Kyoto fonctionnait, ça ne réduirait les émissions de GES que de 5 % à court terme en 2012. C’est déjà important pour la prise de conscience. Mais on n’a pas encore pris la mesure de l’importance des bouleversements à venir et je ne vois pas énormément de penseurs là dessus. Nous souffrons d’un déficit d’imagination.
Comment expliquer que la plupart des intellectuels dominants, médiatiques n’intègrent pas du tout le paradigme écologique, ce qui paraît assez spécifique à la France ?
Je ne sais pas si c’est spécifique à la France, mais il est vrai que les intellectuels n’en parlent pas. Les gens qui parlent au nom de l’écologie sont souvent des catastrophistes – peut-être à juste titre – mais avec des difficultés à rattacher leur discours à une vision politique. Les politiques en général n’arrivent pas à se saisir de l’écologie et ceux qui parlent au nom de l’écologie ont du mal à intégrer le social. On a beaucoup essayé de faire de l’écologie politique, à partir des années 1970 et on a l’impression que ça n’a pas été très concluant. La revue de Jean Paul Deléage qui s’appelait « Écologie politique » s’est transformée en « Ecologie et politique ». Est-ce qu’une écologie peut être politique ? Dans les faits, cela s’avère difficile. Les scores des Verts aux élections en sont une illustration.
N’est-ce pas toujours la même difficulté à intégrer à égalité les différentes dimensions du développement durable, par exemple le social ?
En général on arrive assez bien à intégrer l’environnement. Dans ce domaine existent des solutions techniques, des normes, des labels, etc. Mais pour ce qui est du social, on aura énormément de mal à l’intégrer dans le mouvement de mondialisation. On manque de visionnaires !
Nicolas Hulot n’est-il pas un visionnaire ?
Non ! C’est un tireur de sonnette d’alarme. Les écolos restent dans ce rôle-là. Et les scientifiques aussi d’ailleurs. On tire les sonnettes d’alarme.
Certaines sont plus ou moins entendues parce qu’elles peuvent se traduire directement en termes techniques. On revient toujours à cet aspect technique. En termes politiques c’est beaucoup plus difficile. De ce point de vue, le discours du DD est néfaste quand, à force de tout globaliser, il marginalise des phénomènes très importants, comme les phénomènes migratoires, la mondialisation, la démographie, la répartition des humains à la surface de la terre. De même, que signifie le discours sur l’aide au développement en face des pays émergents, la Chine, l’Inde ? On est vraiment dans une période de transition, mais vers quoi ?
Le Grenelle de l’environnement a montré que les ONG et les industriels pouvaient s’entendre, mais que les politiques ne suivaient pas. Le fait qu’après le Grenelle, au premier conflit avec les pêcheurs, il n’y ait pas eu d’explication pédagogique sur le fait que l’énergie allait devenir de plus en plus rare et chère, est très inquiétant.
Conclusion
Quel est le domaine de recherche qui t’intéresse le plus en ce moment ?
Mes travaux de recherche portent sur comment les questions d’environnement passent dans la sphère politique, deviennent des objets politiques. Comment des observations, des faits liés à l’environnement sont traduits dans les négociations politiques internationales, et aussi comment la science économique aborde ces questions d’environnement, comment s’impose le discours marchand comme solution, alors qu’en même temps la solution qu’on essaie de mettre en place ne relève pas du marché au sens théorique.
On est obligés de se réclamer du marché même pour faire de la planification. Le Protocole de Kyoto, est une sorte de base pour une Organisation mondiale de l’environnement, mais il repose sur un dogme : la régulation doit se faire par le marché. C’est une façon d’obtenir un consensus. On fait de la régulation planifiée entre États en disant que c’est le marché. Le marché permet en théorie la meilleure allocation des ressources, mais sans prétendre à aucune préoccupation d’équité, de solidarité, de justice sociale.
Les connaissances, les indicateurs scientifiques eux-mêmes font l’objet de négociations quand ils passent dans le politique. Les politiques vont toujours plus vite que nous, les chercheurs. Le résultat, quand ça passe dans le politique est souvent inattendu. Il nous faut alors l’expliquer. C’est ça qui est passionnant.
Publications
Catherine Aubertin a publié avec Franck-Dominique Vivien Les enjeux de la biodiversité (Economica, Paris, 1998) et Le développement durable ; enjeux politiques, économiques et sociaux (La Documentation française, 2006), et coordonné les ouvrage Représenter la nature ? ONG et biodiversité (IRD Éditions, Paris, 2005), Les marchés de la biodiversité (avec Florence Pinton et Valérie Boisvert, IRD Editions, Paris, 2007) et Aires protégées, espaces durables ? (avec Estienne Rodary, IRD Editions, Marseille, 2008).