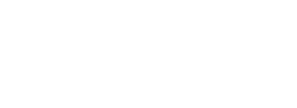- Nos projets & actions en cours
L’association Adéquations agit en matière d’information, formation, projets en croisant les enjeux d’égalité femmes-hommes, de transition écologique et climat, de solidarité internationale et droits humains
- Nos formations et accompagnements
- Evénements & webinaires
Adéquations
- Transition écologique et égalité femmes-hommes
- Education non sexiste et Droits de l’enfant
- Solidarité internationale et coopération
- Egalité femmes-hommes & genre
Etudes et archives
- Actions collectives & partenariats
- Démocratie &
veilles citoyennes - Développement humain durable
Expertises, méthodes
- Membres et partenaires
|
Accueil > Membres et partenaires > Anna Griève > Etude sur Goethe > Le Processus d’individuation chez Gœthe |

Le Processus d’individuation chez Gœthe
Extraits d’une étude non publiée d’Anna Griève
2008, par
Rapprochant Goethe et Jung, ce texte décrit le parcours de Goethe comme un "processus d’individuation". Il montre que la pensée de Goethe présente une première élaboration, dans un langage différent, moins psychologique, de cette notion jungienne fondamentale. Partant du premier grand texte de Goethe, "Les Souffrances du jeune Werther" (1774), Anna Griève commente dans la perspective de ce processus la plupart des oeuvres majeures, poèmes, théâtre (Iphigénie en Tauride, Faust) et romans (Les Années d’apprentissage de Wilhem Meister, Les Affinités électives, Les Années de voyage de Wilhelm Meister).
A noter qu’Anna Griève revient sur la pensée et l’oeuvre de Goethe dans la conclusion de son récent ouvrage Les Trois corbeaux, ou la science du mal dans les contes merveilleux, éditions Imago, février 2010.
- Les Souffrances du jeune Werther, p1
- La "Bildung" selon Gœthe, p4
- Les figures féminines dans l’œuvre de Gœthe, p4
- Les Années d’apprentissage de Wilhelm Meister, p4
- Les Affinités électives, p5
- Les Années de voyage de Wilhelm Meister, p6
- La figure de Méphistophélès dans Faust, p8
- Gœthe, la quête et l’enquête, Jung, p9
2 - Ce qui frappe, dès les derniers paragraphes de la première lettre écrite par Werther – c’est-à-dire dès la première page du roman, puisque celui-ci consiste en la succession des seules lettres de Werther à un ami – c’est l’expression très spontanée d’un sentiment de la nature tout à fait indépendant du sentiment amoureux – il n’a pas encore été, si peu que ce soit, question de Charlotte – et qui s’épanouit en même temps que la luxuriance printanière dans la "région paradisiaque" où séjourne le jeune homme. On se souvient alors que l’expression lyrique du sentiment de la nature est apparue, avec celle des émotions en général et tout particulièrement des émotions de l’amour et du désir amoureux, vers la moitié du dix-huitième siècle, dans La Nouvelle Héloïse en particulier, qu’il n’en allait nullement de même moins d’un siècle plus tôt, dans La Princesse de Clèves, où la nature n’a point de part, et où la passion même "la plus tendre et la plus violente" ne s’exprime que dans un comportement et une langue corsetés de rigoureuse bienséance, ne glissant vers l’épanchement que pour aussitôt être ramenée sous le plus étroit contrôle. Il apparaît clairement que le théâtre de la même époque, dans son expression très libre des sentiments les plus passionnés, voire les plus coupablement passionnés, était à la fois le moyen de laisser parler l’amour et de le maintenir à distance, hors de la sphère de l’intimité du cœur, où il devient, dès qu’il y est reçu, tellement immaîtrisable et à tant d’égards si dangereux. C’est seulement dans la deuxième moitié du dix-huitième siècle, avec l’avènement politique de la notion d’individu, que le sentiment de la nature et le sentiment amoureux se mêlent dans une liberté d’expression nouvellement acquise. Avec la pensée de situer le roman de Gœthe dans l’évolution générale vers une expression de plus en plus personnelle et immédiate du sentiment, des émotions, et de comparer, chez Gœthe et chez Rousseau, le lien entre sentiment amoureux et sentiment de la nature, il est intéressant de rouvrir La Nouvelle Héloïse à la fin du quatrième livre, et de relire le récit de la promenade-pèlerinage que Saint Preux fait avec Julie jusqu’au "lieu chéri", "retraite isolée" dans la montagne, où il avait passé autrefois, "tout occupé d’elle", des jours à attendre la permission de retourner près d’elle. La nature y est d’une part décrite dans sa beauté, par un spectateur extérieur à elle, comme le cadre magnifique d’un magnifique amour. Et d’autre part, lorsque Saint-Preux s’adresse à Julie pour évoquer les souvenirs liés à ce lieu, la nature est constamment mise, de façon d’ailleurs très rhétorique, en rapport de sympathie et ici surtout d’opposition aux sentiments violents qui l’agitaient alors : c’est-à-dire qu’elle n’est pas, là non plus, considérée en elle-même, mais en quelque sorte annexée par la subjectivité. Elle est donc ou bien admirée de l’extérieur, ou bien incorporée au sentiment subjectif. Ce n’est pas que Rousseau n’ait pas connu une autre manière encore, beaucoup plus profonde, de ressentir la nature : les Rêveries du promeneur solitaire le montrent assez, mais le sentiment amoureux est absent de ce texte. Nous nous en tenons ici au lien, en réalité aux deux formes du lien entre sentiment de la nature et sentiment amoureux dans le roman de Rousseau.
Si, après la lecture de ces quelques pages de La Nouvelle Héloïse, on revient à la lettre qui ouvre le Werther, où le sentiment de la nature, comme il a été dit plus haut, s’exprime indépendamment du sentiment amoureux, qui naîtra un mois plus tard, on se trouve aussitôt transféré tellement au delà de la contemplation, même exaltée, de la beauté de la nature printanière, et ce mouvement jubilatoire s’inverse tellement en écrasement, que l’on pressent d’emblée une tout autre dimension du sentiment. Après avoir écrit quel "baume délicieux" la solitude est pour son cœur dans ces collines sur lesquelles le printemps répand sa chaleur et son abondance, Gœthe-Werther écrit en effet ceci : "Chaque arbre, chaque haie est un bouquet de fleurs, et on voudrait devenir scarabée pour pouvoir se perdre dans cette mer de parfums et y trouver toute sa nourriture." Cependant, afin de ne pas laisser à ces lignes le caractère d’un passage isolé et insuffisamment significatif, afin également d’éviter les répétitions et de pouvoir donner en une fois toute son ampleur au commentaire, nous souhaitons citer ici in extenso la deuxième lettre du roman, datée du 10 mai, qui pour être extrêmement connue n’en est pas moins essentielle, tout le roman y étant contenu en puissance – avec l’espoir que le lecteur ne dédaigne pas ce texte comme le délire facile d’un romantisme désuet et ridicule, mais en perçoive le souffle immense, le brûlant désir d’union immédiate et infinie, ce caractère à la fois absolument sain et extrêmement dangereux, aussi éloigné du morbide que du conforme et de l’insignifiant.
"Une joie merveilleusement calme s’est emparée de mon âme tout entière, pareille aux doux matins de printemps que je goûte de tout mon cœur. Je suis seul et savoure ma vie dans cette région, créée pour des âmes comme la mienne. Je suis si heureux, mon ami, et tellement abîmé dans un sentiment de paisible existence, que mon art en souffre. Je ne pourrais pas dessiner en ce moment, pas un seul trait, et n’ai jamais été si grand peintre qu’en ces instants. Lorsqu’autour de moi la brume s’exhale de cette chère vallée, que le soleil repose sur l’obscurité impénétrable de ma forêt bien-aimée, où seuls quelques rayons parviennent à se glisser au cœur du sanctuaire, et qu’étendu alors dans l’herbe haute près de la cascade du ruisseau, tout contre la terre mille brins d’herbe de toute sorte attirent mon attention ; lorsque, percevant le fourmillement du petit monde qui vit parmi ces tiges, les formes innombrables, insondables, de tous ces moucherons et vermisseaux, je les sens tout contre mon cœur et sens la présence du Tout-puissant, qui nous a créés à son image, le souffle du Tout-aimant qui nous porte et maintient dans une félicité éternelle ; mon ami ! quand alors mes yeux s’obscurcissent et que le monde autour de moi et le ciel reposent tout entiers dans mon âme comme la forme d’une bien-aimée, un désir immense et sans but souvent me saisit et je pense : Ah ! si tu pouvais exprimer, si tu pouvais insuffler au papier ce qui vit en toi avec tant de chaude plénitude, de sorte que ce papier devienne le miroir de ton âme comme ton âme est le miroir du Dieu infini ! – mon ami – Mais tout cela me détruit, je succombe sous la puissance de cette splendeur."
On comprend, après avoir lu ce texte, qu’il est vain de parler ici, comme on peut le faire à propos de La Nouvelle Héloïse, du lien qui unit, ou des liens qui unissent – dans un éveil général à la beauté, dans une recherche d’écho des émotions, ou même dans une sensation de participation au mouvement de la vie – le sentiment de la nature et le sentiment amoureux, car le propre du texte de Gœthe est justement que le sentiment qui s’y exprime est en deçà de la différenciation de ces deux formes du sentiment. Ici l’amour, le désir, comme une masse instable d’énergie originelle sans objet constitué, défini, eux-mêmes porteurs du tout en eux-mêmes prennent le tout pour objet, qui ne peut être qualifié, comme dans certaine théologie, que négativement : il est "in-fini", "in-nombrable", "in-sondable". Mais plus que l’immensité, plus que la multiplicité et la surabondance, qui n’en sont que les manifestations extensives et quantitatives, c’est cet in-sondable, c’est le mystère intime du monde, et dans le monde, du vivant, qui est fondamentalement l’objet du désir. "Je les voyais agir et créer les unes par les autres dans les profondeurs de la terre, toutes ces forces insondables", écrit Werther, se souvenant de la lettre écrite le 10 mai, dans la lettre du 18 août. Et Faust veut connaître "ce qui tient le monde ensemble au plus intime". De façon extrêmement remarquable, le texte ci-dessus, tellement prodigue en adjectifs, dans son ivresse d’amour ne présente pas une seule fois l’adjectif "beau", ni d’ailleurs le mot "beauté", ni aucun terme qui marque une appréciation esthétique. Le mot "splendeur" seul apparaît, à la dernière ligne du texte, mais tout ce qui précède transforme justement le sens du mot, et y fait entrer bien autre chose que la seule émotion causée par la beauté. En rapport avec non pas exactement cette absence d’émotion esthétique, mais cette latence de l’émotion esthétique, comme diffuse encore au sein de l’émotion primordiale, centrale, et non encore constituée comme telle, il est frappant de constater combien le regard joue un rôle secondaire, à la fois élémentaire et transitoire, dans un texte dont la majeure partie consiste en une description. Le paysage ne présente aucune ligne précise : c’est un creux couvert d’arbres, au sein duquel le texte se situe d’emblée, une vallée humide qui fume sous le chaud soleil de midi, lequel est su, mais non pas vu, car Werther est comme enfoui dans un creux plus profond encore, dans l’obscurité impénétrable de la forêt, dans le "sanctuaire intérieur", où il est allongé parmi l’herbe haute, tout contre la terre, près du ruisseau, là où ne parviennent que quelques rares filets de lumière. Ce printemps plein de feu, il le perçoit surtout par ces vapeurs qui montent du sol autour de lui, où il baigne plus encore qu’il ne les voit, et son regard, sans espace où se déployer, sans formes où se poser, se trouve ramené au plus proche, à ces herbes et ces insectes qui entrent en contact avec son corps, et dont la vie lui devient plus sensible par cette proximité immédiate, comme si le regard, privé de la distance qu’il est son propre d’établir, devenait une modalité du toucher, était comme réintégré dans une perception diffuse du monde par le corps tout entier, comme si le voir perdait son autonomie, devenant un des modes du sentir, du sentir premier, direct, par la peau, par toute la surface du corps. Et ce sentir lui-même se trouve tout à coup quasi aboli, ou plutôt résorbé dans un sentir antérieur à tous les organes des sens, absolument originel, principe de toutes les différenciations des organes concrets : Werther en effet ne dit pas qu’il sent tout ce monde multiple d’herbes et d’insectes tout contre son corps, ni même tout contre lui, ni même tout contre sa poitrine, mais, par un glissement aussi hardi qu’il est naturel : qu’il "les sent tout contre son cœur". Et dans le même instant, par une rupture de construction de la phrase allemande qui la rend grammaticalement incorrecte, juxtaposant le verbe sentir au verbe sentir de sorte que le second prenne appui sur le premier (ce que le français ne permet pas de rendre ; voir ligne 11 de notre traduction de la lettre du 10 mai), Gœthe, dans la droite ligne de ce qui précède, mais dans un mouvement plus audacieux encore, vaste et souverain, outrepassant toutes les limitations, s’élance de la perception immédiate de l’invisible dans le visible, de l’infini dans le fini, jusqu’à la perception de l’Infini lui-même. A ce point d’apogée du texte, le regard, sous l’intensité d’une émotion de contact direct avec la force qui crée, qui porte et maintient le tout, se brouille, et, devenu tout à fait superflu, s’efface entièrement : "quand alors mes yeux s’obscurcissent…", écrit Werther. Et le cœur, dans ce texte consacré à la nature, et descriptif, reste le véritable et finalement le seul organe du sentir, source de tous les modes du sentir et leur réceptacle ultime, centre brûlant de l’espace intérieur désigné à plusieurs reprises dans cette lettre par le mot "âme".
Le texte se compose d’un prélude en quatre phrases...
3 – Lettre du 18 août (Première partie du roman)
"Un rideau s’est comme tiré devant mon âme, et la scène où se déployait la vie infinie se transforme devant moi en l’abîme de la tombe éternellement ouverte. Peux-tu dire : ceci est, alors que tout passe, alors que tout se perd à la vitesse de l’orage, épuisant si rarement la force entière de son être, alors que tout est emporté par le courant, englouti et fracassé contre le roc ? Pas un instant qui ne te dévore et ne dévore les tiens autour de toi, pas un instant où toi-même ne détruise et ne puisse faire autrement que de détruire ; la promenade la plus innocente coûte la vie à mille malheureux vermisseaux, un seul pas dévaste les constructions laborieuses des fourmis et précipite un petit univers dans une tombe indigne. Ah ! ce qui me touche, ce ne sont pas les grands et rares malheurs du monde, ces inondations qui emportent vos villages, ces tremblements de terre qui engloutissent vos villes ; ce qui me ronge le cœur, c’est la force dévorante cachée dans le grand tout de la nature ; qui n’a rien formé qui ne détruise son voisin, qui ne se détruise soi-même. Je vais saisi de vertige et plein d’angoisse. Autour de moi le ciel et la terre et leurs forces sans cesse agissantes : je ne vois rien qu’un monstre éternellement occupé à dévorer, à broyer éternellement."
Il a donc fallu à Gœthe-Werther l’expérience de l’amour refusé, de l’amour infini refusé, pour que devienne sensible à son cœur le double aspect contradictoire, créateur-destructeur, de la création charnelle. Il a fallu que les énergies archétypales se prennent et le prennent au piège des liens de l’existence terrestre pour qu’il découvre le Destructeur dans le Créateur, l’indifférence parfaite et donc parfaitement cruelle de la nature au plan charnel. On voit ici plus clairement que jamais que le Werther n’est pas à proprement parler un roman d’amour, puisque l’amour est ici non pas un sentiment d’où naît une histoire, un destin personnel, il est le lieu où surgit de façon non intellectuelle, mais existentielle, brûlante, la question de la finalité de la nature. Comment l’image d’une nature toute caressante et nourricière, comment l’image d’un Père tout-aimant, comment le sentiment de confiance filiale envers l’origine pourraient-ils subsister après l’expérience du refus opposé à l’élan des énergies les plus profondes, les plus puissantes, éveillées dans une extase d’amour ? La destruction engloutit la création comme si elle en était la négation : elle engloutit le sens qui paraissait inhérent à la création, le sens s’avère une illusion de sens. L’être est "saisi de vertige et plein d’angoisse" : car si le ciel et la terre sont bien toujours là, entrelaçant leurs forces dans une perpétuelle activité, le lien au Père et à la Mère, le lien à l’origine est rompu, il s’est révélé un mensonge. Il n’y a pas de Père ni de Mère au plan de la création charnelle. Celle-ci se montre doublement destructrice pour l’être humain, l’on peut même dire : triplement destructrice. En effet, lorsque l’être humain entre en rapport (non pas en relation !) – ce que ne fait pas l’animal – avec les énergies archétypales, celles-ci constituent pour lui, même dans leur aspect créateur, vivifiant, un danger psychique d’implosion ou d’écrasement, ainsi que le montre la lettre du 10 mai ; et lorsqu’il voit la puissance de ces énergies, brutalement arrêtées dans leur élan vers la vie, refluer sur lui en destruction, l’effet dévastateur s’augmente de toute la douleur d’une perte totale de confiance et de sens, d’un total déracinement et esseulement affectif et moral. L’immaturité de Werther, c’est au début du roman le déséquilibre provoqué en lui par le pressentiment d’abord, puis par le contact de l’infini dans l’expérience de l’origine ; puis, vers la fin du premier livre, c’est le déracinement et l’esseulement produits par la rupture de l’illusion de lien confiant à l’origine. Cette immaturité n’est pas la conséquence d’une enfance difficile qui a laissé l’être infantile et fragile ; elle est au contraire la conséquence directe et inévitable, chez un être particulièrement libre et différencié, du surgissement massif d’énergies très puissantes et brutalement arrêtées dans leur cours : la personnalité consciente n’est pas et ne peut jamais être en état de faire face, telle qu’elle est au moment où il se produit, à un phénomène psychique d’une telle ampleur et d’une telle violence. Ce phénomène ne peut que l’arracher à la forme et au sol qui étaient les siens jusque là. Les énergies montées de la profondeur et contrariées dans leur poussée vers l’existence terrestre ne sont d’ailleurs pas intégrables, si peu que ce soit, dans cet état brut de forces élémentaires. Tant la personnalité consciente que les énergies archétypales ne peuvent entrer en relation que par et dans l’expérience du symbole, qui implique justement la transformation tant de la première que des secondes. Alors seulement la personnalité consciente recouvre une stabilité et une forme, car l’expérience du symbole signifie le lien rétabli à l’origine, une confiance nouvelle fondée au plus intime par le mystère vécu de la transformation, c’est-à-dire par la révélation de la capacité créatrice de la nature à un plan jusque là insoupçonné et comme inexistant, où les contradictions effrayantes et psychiquement dévastatrices de la création charnelle deviennent – si elles sont supportées et portées – la condition de la naissance d’un mouvement de structuration et de croissance intérieures, qui est le processus de l’incarnation : le processus d’individuation. Cette expérience signifie l’enracinement de la personnalité dans le sens, dans l’origine en tant que capable de créer par le sens, d’être Père et Mère dans et par le sens, dans et par le symbole. Ce lien rétabli à l’origine n’est pas un retour, car il ne peut y avoir de retour qu’à l’origine contingente, concrète, aux parents réels et aux figures archétypales telles qu’elles transparaissent – parfois horriblement dénaturées par le sacrifice – à travers eux. Ce lien rétabli à l’origine n’est pas non plus le contact direct avec les forces de la vie infinie, tel que Gœthe-Werther le décrit dans la lettre du 10 mai et dans Ganymède : car ce contact direct, pour "mystique" qu’il soit, ne sort pas, comme nous l’avons vu, de la sphère de la création charnelle, et c’est bien pour cette raison qu’il s’inverse en son contraire et se nie par là lui-même, destructeur d’une illusion de sens et d’une confiance mal placée, comme le montre la lettre du 18 août. Il n’y a de sens solide et de confiance juste qu’au plan du symbole. Le lien retrouvé à l’origine s’établit au plan de la création pneumatique, c’est un lien à l’origine en tant qu’elle est capable du mystère transformant, créatrice du symbole et du sens. Gœthe-Werther se trouve, dans une urgence, une violence, avec une brutalité qui justifie peut-être l’emploi d’un terme aussi cru, acculé au passage au symbole, sans même savoir que ce passage existe. Comment, dans le vertige et l’angoisse où il se trouve – et qu’il paraît maintenant si mesquin et presque ridicule de désigner comme son "immaturité" – ne crierait-il pas du plus profond de lui-même, au moment où il va se tuer, vers un Père ("Père que je ne connais pas, qui as détourné de moi ton visage, appelle-moi à toi. Ne garde pas plus longtemps le silence…" Lettre du 30 novembre, Livre II), comment surtout ne chercherait-il pas dans la femme aimée la mère véritable, la Mère symbolique, le symbole de la Nature-Mère dont tout son être pressent aussi intensément qu’obscurément l’immense besoin qu’il en a ? Comment la mère de la bien-aimée, morte et montée par là au séjour des archétypes, ne deviendrait-elle pas l’image vers laquelle il se tourne d’une façon qui n’est si sentimentale que parce que ni le sentiment ni la pensée en lui ne sont encore capables de concevoir ce qu’il en attend véritablement.