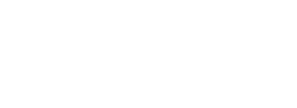- Nos projets & actions en cours
L’association Adéquations agit en matière d’information, formation, projets en croisant les enjeux d’égalité femmes-hommes, de transition écologique et climat, de solidarité internationale et droits humains
- Nos formations et accompagnements
- Evénements & webinaires
Adéquations
- Transition écologique et égalité femmes-hommes
- Education non sexiste et Droits de l’enfant
- Solidarité internationale et coopération
- Egalité femmes-hommes & genre
Etudes et archives
- Actions collectives & partenariats
- Démocratie &
veilles citoyennes - Développement humain durable
Expertises, méthodes
- Membres et partenaires
|
Accueil > Membres et partenaires > Anna Griève > Etude sur Goethe > Le Processus d’individuation chez Gœthe |

Le Processus d’individuation chez Gœthe
Extraits d’une étude non publiée d’Anna Griève
2008, par
Rapprochant Goethe et Jung, ce texte décrit le parcours de Goethe comme un "processus d’individuation". Il montre que la pensée de Goethe présente une première élaboration, dans un langage différent, moins psychologique, de cette notion jungienne fondamentale. Partant du premier grand texte de Goethe, "Les Souffrances du jeune Werther" (1774), Anna Griève commente dans la perspective de ce processus la plupart des oeuvres majeures, poèmes, théâtre (Iphigénie en Tauride, Faust) et romans (Les Années d’apprentissage de Wilhem Meister, Les Affinités électives, Les Années de voyage de Wilhelm Meister).
A noter qu’Anna Griève revient sur la pensée et l’oeuvre de Goethe dans la conclusion de son récent ouvrage Les Trois corbeaux, ou la science du mal dans les contes merveilleux, éditions Imago, février 2010.
- Les Souffrances du jeune Werther, p1
- La "Bildung" selon Gœthe, p4
- Les figures féminines dans l’œuvre de Gœthe, p4
- Les Années d’apprentissage de Wilhelm Meister, p4
- Les Affinités électives, p5
- Les Années de voyage de Wilhelm Meister, p6
- La figure de Méphistophélès dans Faust, p8
- Gœthe, la quête et l’enquête, Jung, p9
4 - Dans la première lettre du deuxième livre, datée du 20 octobre 71, et qui suit immédiatement la séparation que Werther s’est imposée en acceptant un poste dans une autre ville, il exprime à la fois la plus juste compréhension et la plus totale incompréhension de la situation intérieure qui est la sienne : "Quoi ! alors que d’autres paradent devant moi, étalant avec complaisance le peu qu’ils ont de force et de talent, je désespère de ma force, de mes dons ? Dieu bon, qui m’a donné tout cela, pourquoi n’en as-tu pas gardé la moitié et ne m’as-tu pas donné confiance en moi et modération des désirs ?" Werther voit bien sa fragilité, il en voit bien la cause, qui est sa soif d’infini, mais s’il est bien conscient de la dimension non commune de son être, il ne voit pourtant pas du tout ce qu’il peut en advenir de bon, et ne sait qu’aspirer, de façon aussi sincère qu’insincère, vaine de toute manière, à être justement ce qu’il n’est pas. Totalement orphelin de tout sens depuis qu’il sait que Charlotte ne répond pas à son amour, brisé dans le sentiment de sa valeur depuis qu’il sait que tout ce qu’il est n’est rien pour elle, vulnérable comme jamais, entièrement à la merci des marques d’estime ou de mépris de ceux qui l’entourent, tour à tour empli par les premières d’une joie délirante et d’une amertume corrosive et meurtrière par les secondes, Werther donne dans toute la première partie du deuxième livre du roman, c’est-à-dire pendant les dix mois qui s’écoulent avant qu’il ne retourne près de Charlotte, l’impression d’un enfant complètement dépendant de l’attention, de l’indifférence, du jugement d’autrui, toujours en situation de réaction, dominé par une émotivité dont il finit par apparaître comme le jouet. Ce n’est pas pourtant que les choses qui le jettent dans ces états extrêmes soient sans portée ou mal interprétées par lui. Werther ne sent ni petit ni faux. Il sent juste, mais de façon destructrice. L’incident très pénible qui l’amène à donner sa démission illustre bien ce que nous voulons dire. Un jour, Werther, qui n’est pas noble, se trouve, sans l’avoir voulu et sans y prendre garde, mais sans avoir prévu ce qui était très prévisible, encore présent en un lieu où ne sont conviés, à partir d’une certaine heure, que des aristocrates. Les préjugés de classe commencent à rendre l’atmosphère très électrique, sans que Werther, pris par une conversation, s’en aperçoive. L’hôte, qui estime et aime Werther, agit envers lui de la façon la plus obligeante et prudente à la fois, et tout serait bien, si les mauvaises langues ne répandaient le bruit que Werther a été chassé. Or Werther n’a certes rien d’un révolutionnaire : il est capable d’écrire (24 décembre, livre II) qu’il sait aussi bien que n’importe qui que la distinction de la noblesse et du tiers-état est nécessaire et qu’il en tire lui-même des avantages. Ceci cependant est une concession préalable au portrait d’une aristocrate très désagréable. Et dans toute cette partie du roman prévalent un sentiment et un comportement qui soulignent une égalité entre les hommes si naturelle et évidente, si établie, au delà de toute possibilité de la moindre discussion, que ces pages mériteraient autant et plus que beaucoup d’autres, celles-là françaises et polémiques, d’être citées en relation avec la Révolution française et la suppression des privilèges. Mais le sentiment si noble de l’universellement humain qui est comme l’élément même où se meut Gœthe-Werther se tourne chez Werther, dès lors qu’il est blessé, en poison brûlant. Werther voudrait que quelqu’un vienne l’insulter en face, pour pouvoir lui passer l’épée au travers du corps (lettre du 16 mars) ; il voudrait voir du sang, il s’en trouverait mieux ; il a déjà mille fois saisi un couteau, "pour donner de l’air à ce cœur oppressé". "On dit qu’il existe une noble race de chevaux, qui, lorsqu’ils sont terriblement échauffés…, se déchirent d’instinct eux-mêmes une veine, pour recouvrer la respiration. Je suis souvent ainsi, je voudrais m’ouvrir une veine, et trouver la liberté éternelle."
Cette vulnérabilité exacerbée n’est pas faiblesse de caractère : Werther n’est pas faible, il est confronté à des énergies très puissantes qu’il ne sait comment affronter et auxquelles il ne peut faire autrement que de s’identifier. Ce n’est pas non plus susceptibilité maladive, ou du moins la maladie ne doit pas être considérée comme un état chronique, mais comme une crise où l’être ou bien succombe ou d’où il sort transformé. Il n’est pas facile d’avoir une lecture juste du Werther ; ni l’adhésion immédiate de l’époque à l’expression impétueuse des sentiments les plus passionnés, les plus extrêmes, ni le recul comme instinctif d’aujourd’hui non seulement devant cette expression ardente, mais devant la seule existence de tels sentiments, ne sont propres à comprendre avec justesse le personnage de Werther. Cela ne se peut, ainsi qu’il a été dit plus haut, qu’en replaçant le roman, au lieu de le réduire à lui-même, dans la crise d’individuation – la première et la plus terrible – traversée alors par Gœthe. Mais cette mise en perspective ne peut se faire et n’a de sens qu’à partir de l’expérience personnelle du symbole, ou du moins à partir d’une intuition des processus de la création pneumatique. La juste compréhension tant du personnage de Werther que du roman requiert du lecteur non seulement une réceptivité particulièrement élevée à ce plan de l’être, mais un travail actif sur les textes écrits par Gœthe avant et après cette crise, pour y saisir les manifestations d’une transformation intérieure qui n’est décrite comme telle nulle part. Dans d’autres œuvres de Gœthe, le mystère transformant est parfois le sujet même de l’œuvre, ou d’une partie de l’œuvre : c’est le cas pour Iphigénie en Tauride, pour les "Confessions d’une belle âme", pour Les Affinités électives. Il n’en va pas de même pour le Werther. Dans ce roman, Gœthe ne décrit pas un processus de transformation dont il serait, pour l’avoir déjà vécu antérieurement, le témoin en même temps que l’acteur, qu’il pourrait donc représenter en tant que tel, de façon synthétique, à partir d’un lieu en lui situé hors de la zone des tempêtes, justement parce qu’il saurait désormais que le processus de la transformation existe, que le sens est en train de naître. Lorsqu’il écrit le Werther, l’être de Gœthe est tout entier dans la tempête. On ne peut dire exactement qu’il est immergé dans le processus, puisqu’en écrivant le roman, il se trouve dans une position qui justement lui permet de se désidentifier de Werther. Mais Gœthe ne sait pas encore ce qui est en train d’advenir, de lui advenir. Il découvre cette position qui permet à la fois de vivre la tempête et de n’en être pas le jouet, de la traverser et de renaître d’elle plus vrai, plus ferme, plus vivant, car à la fois plus total et plus différencié. Parce que Gœthe en écrivant le Werther a fait l’expérience de la crise transformante, de la crise d’individuation, mais sans être en mesure de se représenter lui-même à côté de Werther, par un autre personnage vivant la transformation – puisqu’il était justement en train d’acquérir l’assise et la distance qui lui permettront, plus tard, de décrire synthétiquement le processus – c’est le lecteur lui-même qui se trouve requis d’être à la fois assez réceptif et actif pour se former cette vision synthétique. Gœthe ici ne peut le guider, puisqu’il ne peut encore lui offrir, comme dans ses œuvres ultérieures, cette vision synthétique. Et dans cette vision, le personnage de Werther n’apparaît ni faible ni infantile ni morbide, il apparaît tragique. Au prix de ce tragique, Gœthe connaît le salut.