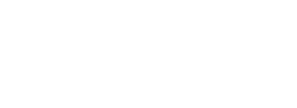- Nos projets & actions en cours
L’association Adéquations agit en matière d’information, formation, projets en croisant les enjeux d’égalité femmes-hommes, de transition écologique et climat, de solidarité internationale et droits humains
- Nos formations et accompagnements
- Evénements & webinaires
Adéquations
- Féministes pour des Alternatives Climat Environnement
- Transition écologique et égalité femmes-hommes
- Education non sexiste et Droits de l’enfant
- Solidarité internationale et coopération
- Egalité femmes-hommes & genre
Etudes et archives
- Actions collectives & partenariats
- Démocratie &
veilles citoyennes - Développement humain durable
Expertises, méthodes
- Membres et partenaires
|
Accueil > Membres et partenaires > Anna Griève > Les trois corbeaux, ou la science (...) > Les contes de libération - Le sacrifice et l’inceste |
Les trois corbeaux, ou la science du mal dans les contes merveilleux
Les contes de libération - Le sacrifice et l’inceste
février 2010, par
(...)
Une troisième forme de sacrifice
(...)
C’est lorsque la volonté d’inceste ne se rapporte pas à une jeune
fille, mais à une toute jeune enfant, voire, comme dans le conte que
nous allons analyser, Les Douze Frères, à une fille non encore née,
que l’inceste se révèle pleinement et peut exercer chez l’enfant tous
ses ravages. Ici, ce n’est pas à la faveur de la convoitise charnelle que
le mal radical se glisse dans le réel. La sexualité du père en effet, dans
son exercice apparemment normal, n’est qu’un fonctionnement, une
activité indigente, qui ne met pas en jeu les énergies profondes de la
personnalit é . Mais celles-ci, prisonnières de fantasmes infantiles, se
projettent massivement sur le jeune enfant et même sur l’enfant
encore à naître. Ces fantasmes infantiles ne signifient pas seulement
un retard dans le développement, car si ce développement n’a pu avoir
lieu, c’est justement qu’il y a eu déformation et perversion des contenus
auxquels se rapportent ces fantasmes. La projection massive de
ces fantasmes sur l’enfant signifie sa prise de possession, en vue d’un
assouvissement, par un legs généalogique extrêmement lourd, dont le
père est lui-même la victime, mais dont il se fait, en s’y abandonnant entièrement par le passage à l’acte, le serviteur, devenant par là l’instrument
du mal radical.
L’extrême virulence de ces fantasmes une fois devenus actifs tient
au fait que c’est justement parce que l’enfant est l’enfant du père qu’ils
se sont éveillés et fixés sur lui. C’est parce que l’enfant est un autre luimême
devant lui que les fantasmes du père adhèrent à l’enfant avec
une telle intensité, situation d’autant plus effrayante que l’enfant est là
dans sa toute-faiblesse, dans un espace muré à tout regard extérieur.
L’enfant est donc la matière, livrée sans témoin, dans laquelle le parent
agit par ses manipulations la réalisation inversée de lui-même, c’est-àdire
sa propre décréation. Car les énergies du Soi, une fois mises en
branle par les projections attirées par l’enfant et fixées sur lui, ne peuvent
plus n’être pas vécues : si elles ne sont pas prises en charge par
une responsabilité qui travaille à leur libération et à la création intérieure,
alors à travers le consentement aux gestes criminels elles se pervertissent
irrémédiablement et se renversent en forces de décréation.
L’enfant est la matière psychique du père, dans laquelle les énergies
du Soi, devenues celles du mal radical, oeuvrent à l’avilissement de
l’essence humaine. Elles oeuvrent avec un instinct de destruction très
sûr, ce qui n’a rien qui doive étonner, puisqu’il s’agit d’un instinct de
création inversé : la victime est bien avilie dans ce qu’elle a de plus
intimement créateur, de plus fortement et tendrement vivant, charnellement
et symboliquement fécond, dans les organes en elle de la procréation,
qui se trouve donc tournée en simulacre. La jouissance
sensuelle éprouvée ici par le sacrificateur n’est que la manifestation
corporelle de l’intensité de la jouissance d’avilissement de soi à travers
l’avilissement de l’enfant, à travers la jouissance de sa réduction à de
la chose-humaine, c’est-à-dire à travers la jouissance prise à sa décomposition
en tant qu’être humain. Tout est là — intensité de jouissance
dont la pointe la plus aiguë est pour le manipulateur le sentiment de
puissance absolue que donne l’agir de la décréation la plus centrale, la
plus directe, la plus parfaite, puisqu’elle détruit plus que la vie : le sens
de la vie, le symbole, la capacité au symbole, essence de l’humain, à la
fois fondement archétypal de l’existence concrète et voie d’accès à la
création continuée, au plan de la vie pneumatique. Ainsi l’inceste estil
la forme la plus achevée du sacrifice, puisqu’il fait subir à l’enfant,
par celui ou celle-là mêmes qui lui ont donné la vie, la pire des morts,
la mort intérieure, la mort du symbole. C’est la source même de la vie
qui s’inverse en acharnement décréateur où les archétypes parentaux
se défigurent en masques terrifiants.
(...)
La généalogie du mal
Le début de ce conte a déjà été évoqué, il est nécessaire de le rappeler
ici. Un roi et une reine, qui « vivaient en paix l’un avec l’autre »,
avaient douze enfants, mais tous des garçons. Lorsque la reine se
trouva enceinte à nouveau, le roi lui dit : « Si le treizième enfant, que
tu portes, est une fille, les garçons mourront, afin que la richesse de
cette fille soit grande et qu’elle devienne seule héritière du royaume. »
« Et il fit faire à l’avance les douze cercueils, et les fit garnir intérieurement
d’un coussin dans chacun à la place où serait posée la tête, et il
fit placer les douze cercueils dans une pièce fermée à clé, dont il confia
la clé à la reine en lui ordonnant un silence absolu. »
Tous les contes, dès les premières phrases, vont droit à l’essentiel,
exposant avec la même simplicité imperturbable les situations les plus
lourdes comme les plus ouvertes et pleines de promesses. Rares pourtant
sont les débuts de conte aussi abrupts dans l’horreur, et aussi précisément
évocateurs de la perversion radicale du sentiment. L’ antinomie
entre cette « paix » qui est dite régner entre les époux et la déclaration
immédiatement juxtaposée du roi est, sous l’égalité du ton, tellement
stridente, tellement effarante, que la pensée en est d’abord comme
désemparée. Cette mention au début du récit de la paix, ou de la discorde,
entre le roi et la reine n’est nullement habituelle : il faut donc lui donner tout son poids. Ce roi et cette reine « vivaient en paix l’un avec
l’autre ». Quelle paix ?
Évidemment celle d’une sorte de mécanisme humain, coupé, tant au
plan biologique qu’au plan correspondant du sentiment, des énergies
profondes de l’être, et qui donne ainsi l’illusion rassurante d’une personnalité
et d’une existence saines, alors qu’il n’y a là, tout au
contraire, que la normalité la plus malsaine, la plus trompeuse et la
plus inquiétante : ce que le conte indique symboliquement par l’image
des douze fils. La fertilité extérieure dissimule et révèle à la fois une
totale stérilité intérieure, puisque la totalité issue de l’union du roi et
de la reine est une caricature de totalité. Le masculin reste, malgré les
apparences, enfermé dans la répétition de lui-même, absolument séparé
du féminin, qui n’apparaît pas dans la descendance : les fils s’ajoutent
aux fils, le même s’additionne au même. Le conte suggère ainsi le vide
et la fausseté du lien entre le roi et la reine, qui n’est qu’une caricature
d’union.
Le principe féminin n’a aucune existence autonome pour le roi, ni en
lui-même ni hors de lui-même. La reine près de lui, pareille à un mannequin,
ne fait qu’en masquer et marquer à la fois l’absence. Le féminin
est chez le roi dans la plus totale indifférenciation avec lui-même, avec
ce masculin qu’il est d’abord, si bien qu’il n’y a chez lui, sous la normalité
superficielle, que de la matière psychique non identifiée, non
identifiable, si inconsistante que le sentiment d’être n’a pas où se
prendre au plus intime. Les énergies du masculin, inemployées et
comme dormantes, depuis de longues années attendent, attendent
l’heure de la seule passion que le roi puisse éprouver, du seul féminin qui
puisse éveiller son ardeur : sa fille, enfant encore à naître et déjà possédée.
Sa fille, c’est-à-dire lui-même, sous forme féminine issue de luimême,
autre pour lui adorablement le même et adorablement en son
pouvoir. Sa fille-idole à qui il puisse, s’idolâtrant sans fin lui-même dans
le simulacre de l’autre, offrir le hideux sacrifice de toutes les énergies du
masculin en lui, comme en témoigne sa volonté non pas barbare — c e
mot fait référence à la cruauté sacrificielle d’avant l’expérience fondatrice — mais perverse, d’anéantissement, à travers les fils issus de lui, de
toute virilité en lui-même et en elle. Sacrifice intégral de l’un des
contraires à l’autre, par où ce dernier, monstrueusement dénaturé, est
arraché justement à sa réalité et à son rôle psychiques de contraire, arraché
à l’incarnation, pétrifié en absolu chez lequel plus rien ne subsiste
d’une puissance créatrice et dispensatrice, puisqu’il est déifié ici, de
façon la plus purement sacrificielle, par la passion d’aveulissement et d’avilissement [1] à laquelle le roi s’abandonne : on assiste, au début de ce
récit, à l’érection, dans la sphère de la psyché personnelle qui est celle
des contes, de ce que nous avons appelé l’idole du second degré, quand
la volonté d’inconscience, d’indifférenciation et d’irresponsabilité scelle
par et dans le crime son refus de l’essence humaine [2].
Si le mot de « passion » est employé ici, ce n’est évidemment pas dans
le sens où le roi aurait une passion pour sa fille — non encore née. Dans
Peau de mille bêtes, on pourrait à la rigueur parler d’une passion du roi
pour sa fille soudain découverte dans l’éblouissement de sa beauté naissante.
Mais l’ardeur que réveille chez le père des douze frères la pensée
de ce féminin issu de lui, et encore à naître, se situe en deçà de toute virilité,
aussi restrictive qu’en soit la définition. C’est une ardeur immonde,
où toutes les énergies du développement affectif et de l’accomplissement
intérieur ont été tournées en gâtisme du sentiment et en impuissance spirituelle,
où toute la force de l’être a dégénéré en violence. Une violence
absolument veule, qui veut avidement le NON-sens [3].
L’obsession du roi, c’est d’éprouver l’intensité du sentiment d’être
à travers la jouissance de la décréation de lui-même, de la destructuration
entière de lui-même. Il veut s’abîmer dans la flasque intensité de
sa propre dissolution : le flasque et l’intense ne sont nullement exclusifs
l’un de l’autre, leur identité caractérise au contraire la pure jouissance
de la décréation de soi, du sentiment d’être inversé en sentiment
de NON-être, de NON-sens. Par la décision de tuer ses fils et par la
préparation maniaque qu’il fait de leurs obsèques, le roi s’identifie
entièrement et à jamais à cela qui tenait déjà très profondément sa psyché
sous emprise, c’est-à-dire qu’il s’identifie au mal radical, de telle
sorte que le culte qu’il se voue à lui-même dans l’image de sa fille ne
se distingue pas du culte du mal radical : ce n’est pas, en effet, telle ou
telle qualité ou degré de puissance qu’il idolâtre en lui, mais bien un
des contraires constitutifs de son être, afin de pouvoir lui sacrifier
l’autre. Comme tous les sacrificateurs — mais c’est ici particulièrement
lisible, à la fois direct et massif — ce qu’il sacrifie à travers les victimes concrètement vivantes —, et c’est évidemment aussi bien sa
fille que ses fils, même si les formes du sacrifice sont différentes —ce
sont les contraires en lui, dont l’un est dénaturé en idole et l’autre supplicié.
A travers le sacrifice du vivant extérieur — sacrifice psychique
de la fille, sacrifice physique des fils — c’est le tissu de son être intérieur
que le roi s’acharne à détruire.
Dans aucun conte n’apparaît aussi clairement la nature du sacrifice
comme négation de la conscience, négation de la dimension proprement
humaine de l’être humain, finalité de destruction intérieure du
sacrificateur qui dicte le sacrifice du vivant extérieur. Dans aucun
conte n’apparaît aussi clairement l’entreprise de désintégration de l’archétype
du Soi, fondement de toute vie en tant que tension entre les
contraires, et de toute vie au plan de la création pneumatique par la
mise en relation consciente des contraires. Le type d’inceste décrit par
ce conte permet la mise à nu du sacrifice, dont aucun intérêt, convoitise,
jalousie, sentiments humains trop humains ne viennent obscurcir
et comme estomper la perception aiguë.
Il est d’ailleurs frappant de noter à quel point la déclaration du roi à
la reine — « Si le treizième enfant, que tu portes, est une fille, les garçons
mourront » — est impersonnelle, dépourvue de la moindre trace
d’un sentiment quelconque, fût-ce de haine. Tranquille énonciation de
l’horreur, qui la rend au sens propre du terme plus affolante encore,
puisque l’horreur est présentée comme la simple conséquence, quasi
anodine, d’un principe évident, non formulé, s’imposant par lui-même.
Si le roi n’ajoutait pas, en remettant à la reine la clé de la salle des cercueils,
qu’elle doit garder le secret absolu, on pourrait penser qu’il a
perdu le sens de la réalité, qu’il a été happé par son fantasme. Mais il
n’en est rien : le roi n’est pas fou. Il a atteint le degré parfait de la perversion,
au-delà de toute mauvaise foi. Là où la destruction intérieure
est achevée, il n’est plus besoin d’adresse ou de mensonge justificateurs
pour étouffer la dernière lueur de conscience : la volonté s’est comme
incorporé la mauvaise foi, qui n’est plus perceptible en tant que telle.
L’insensibilité à l’autre en tant qu’Autre est installée, et le sacrifice a le
caractère, si visible dans le nazisme, et si net dans ce conte, d’un fonctionnement
bien organisé, où l’horreur prend l’apparence du normal.
La « passion » qui meut le roi pour sa fille à naître n’est que l’avers
d’une même insensibilité à l’Autre, qui fait de l’enfant à venir une victime
sacrificielle sur le plan psychique, comme elle fait des douze fils
des victimes sacrificielles sur le plan physique. Ce qui est à l’oeuvre chez
le roi est la haine de la personne impliquée par la volonté absolue d’indifférenciation. C’est la haine du mal radical lui-même pour la personne,
que ce soit celle du sacrificateur ou celle de ses victimes, et le roi n’est
plus que le vecteur de cette haine, véritablement impersonnelle aux deux
sens que l’on peut donner à ce terme. C’est la « passion » métaphysique
de l’indifférenciation, qui implique la haine métaphysique de la personne : obsession maniaque plutôt que passion. La manie décréatrice
peut avoir les apparences de la passion, alors qu’elle ressortit au mal
radical, contrairement à la passion, qui ressortit au mal transformable.
Dans le système dont le roi est déjà prisonnier et que, par sa décision,
il achève de mettre en place, la reine n’est rien d’autre que, d’une
part, le moyen de « produire », à travers la fille-idole, ce même dans le
simulacre de l’autre que le roi attend obscurément depuis son mariage,
et avant même son mariage et, d’autre part, la garante de la « normalité
» dont le roi a besoin pour dérober aux regards son délire criminel.
Mais en confiant à la reine son projet criminel, en lui remettant la clé
de la salle des cercueils, le roi fait preuve de cette cécité si caractéristique
du mal radical : comme la sorcière dans Hänsel et Gretel, il a la
vue basse. Il ne voit rien, il ne perçoit rien, du moins chez les êtres qui
sont en rapport étroit avec lui, qui ne soit leur place et leur fonction
dans le système dément où il s’enferme lui-même.
(...)
Notes
[1] Il y a une jouissance d’avilissement et une jouissance d’aveulissement. Ce sont des jouissances différentes, même si elles peuvent parfois coexister. Celui qui jouit de s’avilir perçoit encore le respect qu’il se doit, puisqu’il jouit précisément d’attenter à ce respect. Il y a donc en lui une perception de la structure, nécessaire à sa jouissance. Celui qui jouit de s’aveulir jouit de sentir se dissoudre en lui toute structure, de s’abîmer dans l’indifférenciation, de s’y vider de sa substance. On pourrait dire que l’avilissement ressortit directement au domaine de l’éthique, tandis que l’aveulissement ressortit d’abord à l’ontologique, et par là, de façon indirecte quoique fondamentale, au domaine de l’éthique.
[2] Cf. Introduction, p. 31 et p. 37.
[3] Ibid., p. 35.