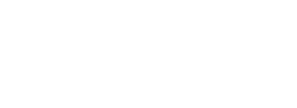- Nos projets & actions en cours
L’association Adéquations agit en matière d’information, formation, projets en croisant les enjeux d’égalité femmes-hommes, de transition écologique et climat, de solidarité internationale et droits humains
- Nos formations et accompagnements
- Evénements & webinaires
Adéquations
- Féministes pour des Alternatives Climat Environnement
- Transition écologique et égalité femmes-hommes
- Education non sexiste et Droits de l’enfant
- Solidarité internationale et coopération
- Egalité femmes-hommes & genre
Etudes et archives
- Actions collectives & partenariats
- Démocratie &
veilles citoyennes - Développement humain durable
Expertises, méthodes
- Membres et partenaires
|
Accueil > Membres et partenaires > Anna Griève > Les trois corbeaux, ou la science (...) > Conclusion |
Les trois corbeaux, ou la science du mal dans les contes merveilleux
Conclusion
février 2010, par
(...)
Au XVIIIe siècle, les contes merveilleux ainsi que l’alchimie cessèrent
d’être vivants. L’affirmation de plus en plus marquée du rationalisme
et de la pensée scientifique rendait impossible d’entrer de
plain-pied dans un monde tout peuplé de figures étrangères à la réalité
tangible, et où l’enchaînement des événements ignore la causalité. Ces
récits furent dès lors éprouvés comme ressortissant au domaine du
« purement imaginaire », dénué de substance, et la mentalité générale
les estima tout juste bons à enchanter les enfants et les coeurs « naïfs »,
c’est-à-dire puérils. Ils devinrent, comme l’alchimie, les vestiges d’un
état révolu de la psyché et, s’il est vrai qu’ils suscitèrent en tant que
tels, dans certains mouvements et cercles littéraires, un regain d’intérêt,
qui poussa heureusement à les recueillir, cet intérêt ne s’accompagna
que rarement d’une appréhension juste de leur nature, d’une
compréhension de leur objet véritable, et ne pouvait de toute façon leur
rendre une vie qui se retirait d’eux. Les contes, comme l’alchimie,
avaient cessé d’être ce que, selon Jung, ils avaient été pendant des
siècles : des manifestations de l’esprit compensatrices de l’unilatéralité
lumineuse du christianisme historique, restauratrices, par la réintégration
du « quatrième [1] » du jeu naturel des contraires dans la psyché, et
par là des vecteurs du processus d’individuation.
Or, à la fin du XVIIIe siècle, en 1796, parut le roman de Goethe, Les
Années d’apprentissage de Wilhelm Meister, que Frédéric Schlegel
(Fragments 1797-1798) déclare égal en importance à la Révolution française,
non sans exprimer clairement son mépris pour ceux qui ne sont
capables de concevoir une révolution que « bruyante et matérielle » .
Et en effet, ce roman marque un moment capital dans l’histoire de
l’individuation et, par là, dans l’histoire de la psyché occidentale. Non
qu’il doive être considéré isolément, en dehors du contexte où il est né.
Tout au contraire, il est le témoignage le plus achevé du grand mouvement
spirituel qui se produisit, très approximativement entre 1770
e t 1820, dans l’Allemagne d’alors, et dans la seule Allemagne. Délaissant
ses propres formes mourantes ou déjà mortes, parfois depuis longtemps
(la légende du Graal s’était éteinte quelques décennies après son
apparition), le processus d’individuation « émigra » en quelque sorte
et se régénéra en investissant spontanément, de façon évidemment progressive
mais qui parut soudain au grand jour, le nouvel état de la psyché
et ses productions vivantes. Après des siècles d’introspection et
après tant d’oeuvres littéraires, surtout théâtrales, mais déjà aussi romanesques, qui avaient présenté depuis la Renaissance, dans toute
l’Europe, tant de peintures de la psyché, le processus d’individuation
se saisit pour la première fois, dans Les Années d’apprentissage de
Wilhelm Meister, très au-delà d’un projet précis ou d’une volonté délibérée
de l’auteur, de sa matière propre, c’est-à-dire de la matière psychique
enfin pleinement constituée comme telle, dans toute sa densité,
sa complexité, dans la variété et la force de tous les liens terrestres,
dans l’étoffe même de l’existence quotidienne. Et ce faisant, il se saisit
ipso facto de la forme qui lui est consubstantielle, c’est-à-dire de la
forme du roman. Pénétrant plus avant qu’il ne l’avait jamais fait dans
l’épaisseur psychique et terrestre, le processus d’individuation réalisait
ainsi une nouvelle incarnation de lui-même, il parvenait à un degré
plus profond d’incarnation.
Les Années d’apprentissage de Wilhelm Meister sont, en effet, l’équivalent
romanesque d’un conte de quête, qui y reste lisible en filigrane
dans la riche peinture psychologique et sociale de personnages qui ne
sont plus les différents aspects d’une même psyché, mais des êtres
concrètement réels. En premier lieu, l’histoire garde toutes les caractéristiques
du récit type d’un conte de quête : situation initiale de manque,
d’absence, de stagnation ; éloignement de la maison familiale ; entrée
dans le vaste monde ; orientation du désir et, de plus en plus nettement,
de tous les événements vers une figure d’anima lointaine, qui n’est
rejointe qu’à la fin du récit ; épreuves, errances, erreurs, tours et détours
qui mènent finalement à la réalisation de l’union amoureuse. En second
lieu, si la figure d’anima (qui, comme c’est le cas dans certains contes,
n’apparaît que dans le cours du récit) se révèle progressivement être une
femme bien réelle, clairement située dans un milieu social et dans tout
un réseau de parenté et d’amitiés, elle n’est cependant d’abord pour
Wilhelm qu’une vision fugace et insaisissable, qui, dans l’état de semi-inconscience
où il vient de sombrer après avoir été dangereusement
blessé, lui semble quasi surnaturelle, et c’est bien en tant que vision infiniment
lointaine qu’elle cristallise ce même désir qui, dans un conte de
quête, jette le porteur de conscience vers l’inconnu et le guide comme un
talisman jusqu’à l’inaccessible. Parce que cette figure d’anima reste longtemps
comme flottante à l’horizon du récit et ne s’incarne vraiment que
dans sa toute dernière partie, elle exerce pendant tout son déroulement sur
le coeur de Wilhelm et sur l’enchaînement des événements cette même
action d’aimant qui est celle de la figure d’anima dans les contes de quête.
Enfin et surtout, lorsque, dans les dernières pages du roman, il n’y
a plus d’inconnu autour de cette figure, lorsqu’elle est présente en personne et se comporte à chaque instant avec le plus grand naturel, elle
n’en reste pas moins étrangement indéfinissable, pareille à une eau
dont on ne sait pas l’origine et dont la transparence est justement le
mystère, un mystère agissant, dont on ne cesse de ressentir l’effet vivifiant.
Ce mystère est d’autant plus fortement ressenti que rien n’est
caché. Ainsi le roman préserve-t-il, dans une matière désormais dense
et toute terrestre, le caractère « merveilleux » de la figure d’anima des
contes de quête, c’est-à-dire sa dimension archétypale, ce qui maintient
cette figure, et de tous les personnages du récit elle seule de façon
évidente, dans une double appartenance indécidable, appartenance à la
fois à la réalité extérieure, concrète, et à la psyché de Wilhelm.
Au-delà de l’insistance sur le caractère archétypal de la figure
d’anima, c’est beaucoup plus profondément que ce roman est « merveilleux
», au sens où le sont les contes ainsi appelés et qui a été défini
plus haut dans ce travail. En effet, la figure d’anima n’y est pas seulement
perçue dans sa dimension archétypale (rappelons que cette perception
est commune aux contes merveilleux et aux contes et légendes
d’échec), mais, à travers et au-delà de sa qualité propre d’archétype de
l’Amante-épouse, comme porteuse de l’archétype du Soi. C’est-à-dire
qu’elle éveille le désir non en tant que simple aspiration à la possession
et au bonheur, mais en tant que dynamisme de la réalisation intérieure
par la mise en relation et l’union des opposés psychiques, elle
suscite la quête, elle ouvre la voie de l’individuation. Cette qualité
d’anima porteuse du Soi est suggérée par Goethe en touches successives, d’une délicatesse pleine d’amour.
C’est ainsi que la femme apparue à Wilhelm est d’abord évoquée à
travers ce que rapportent ses proches de l’enfant qu’elle a été. Elle est
décrite, dès ses jeunes années, comme établie par naissance « au-delà
du bien et du mal » en quelque sorte, au-delà des contraires, dans une
adéquation immédiate à ce que la vie requiert à chaque instant,
l’éthique étant tellement devenue un instinct, une nature, qu’elle n’est
même plus discernable en tant que telle. C’est cette qualité d’être que
saisit et qui saisit Wilhelm dès la première apparition de la figure
d’anima, c’est ce qui cristallise son désir, sa Sehnsucht. Et cette
Sehnsucht, comme dans un conte de quête, de façon moins évidemment
« miraculeuse », mais d’autant plus persuasive, régit les événements et
les fait peu à peu converger, par des voies attendues et inattendues, vers
celle qui est à la fois l’horizon et le centre discret du récit. Ainsi le
roman se meut-il lui aussi dans cet unus mundus qui est proprement le
« merveilleux » des contes ainsi désignés, leur élément même. Une finalité organique est à l’oeuvre, qui se réalise très en deçà ou au-delà de
toute volonté ou action conscientes, qui tisse les uns aux autres événements
et rencontres selon un motif imprévisible et si plein de sens que
le hasard, sans cesser de se présenter comme un hasard, est nécessairement
perçu comme « synchronicité », c’est-à-dire comme « coïncidence
signifiante », voire comme aide magique. Un dessein agit mystérieusement,
qui tourne à son accomplissement l’erreur même qui semble
devoir le ruiner. Il est possible de l’entrevoir à de rares instants, qui en
sont comme les signes, possible même parfois de le favoriser en allant
dans la direction indiquée par ces signes, mais c’est rétrospectivement
seulement qu’on peut en lire, l’esprit confondu, le coeur pénétré d’une
gratitude sans objet, l’invraisemblable continuité et cohérence. C’est là
l’expérience du Soi, ou du sens, c’est là le mystère transformant qui fait
passer Wilhelm, à la fin du roman, du plan de la perception charnelle au
plan de la perception pneumatique. Et ce mystère est d’autant plus intimement
et fortement ressenti comme merveilleux qu’il ne se présente
justement pas comme tel.
La Sehnsucht imprègne la littérature allemande de l’époque, aussi
bien certaines oeuvres du Sturm und Drang, au premier rang desquelles
Werther, que des oeuvres dites « classiques » — comme Les Années
d’apprentissage de Wilhelm Meister — ou « romantiques » — comme
Henri d’Ofterdingen de Novalis ou Le Vase d’or de Hoffmann (la distinction
entre classicisme et romantisme recouvrant en littérature allemande
et en littérature française quelque chose de fondamentalement
différent). Dans son essai Sur le caractère grec, Wilhelm von Humboldt
définit la Sehnsucht [2] en l’opposant au Streben. Le Streben, écrit-il,
« part d’un concept clair et se dirige vers un but précis, peut se trouver
affaibli et même ruiné par les difficultés et les obstacles » ; la
Senhsucht implique, au contraire, tant « le caractère incompréhensible
de sa propre origine » que « le caractère inaccessible de son objet » et
« devant elle, comme devant une magie qui lui est inhérente, toute
chaîne tombe brisée sur le sol ». On ne saurait mieux définir à la fois
le sentiment et le mouvement qui portent, dans les contes de quête
comme dans le roman de Goethe, le personnage principal et le récit luimême,
ni mieux saisir la contradiction dont vit la Sehnsucht, orientation
de tout l’être vers un inaccessible finalement atteint, mais selon un
accomplissement avant tout intérieur, entre réalisation concrète et réalité
archétypale, un entre-deux qui est justement l’espace du symbole.
L’approfondissement d’incarnation du processus d’individuation que
constitue, jusque dans ses égarements, sa réception dans la littérature et
la pensée allemandes de l’époque, reste, dans le renouvellement de la
sensibilité et des formes, en continuité directe avec les vecteurs précédents
du même processus, dont il recueille et accomplit l’héritage. La
légende du Graal, l’alchimie et les contes merveilleux avaient, en marge
de la doctrine régnante du christianisme historique et en opposition
implicite au dogme du péché originel, oeuvré à la sauvegarde ou à la
réhabilitation du « quatrième » condamné et rejeté, et travaillé par là à la
restauration de la fécondité pneumatique de la psyché à travers le jeu
naturel des contraires [3]. Or, à ce tournant des XVIIIe et XIXe siècles, c’est,
dans les lettres allemandes, à une véritable assomption de ce quatrième
que l’on assiste, et non à son assomption en tant que seulement luimême,
mais en tant que porteur du Soi, c’est-à-dire de l’énergie et du
mouvement de l’individuation. La nature n’est plus ressentie comme
opposée à l’esprit, mais au contraire comme la source de l’esprit. To u t
ce qui lui était intimement associé dans la souillure et le péché, c’est-àdire
le féminin, l’éros, la saisie sensuelle du monde, est désormais ressenti
comme la voie d’initiation à l’expérience pneumatique, et c’est la
femme qui est l’initiatrice : c’est l’anima soeur-amante du poème
Pourquoi nous donnas-tu ce regard profond, où Goethe condense l’expérience
de son amour pour madame de Stein, c’est la Sophie de
Novalis, dont la mort lui ouvre l’accès à la vie dans le symbole, passage
intérieur que traduisent les Hymnes à la nuit ; c’est la Serpentina du Vase d’or, dont l’apparition à Anselme, à travers les branches du sureau,
l’inonde de langues de feu en une véritable pentecôte païenne et chthonienne .
La Sehnsucht est le sentiment amoureux total, sans séparation de
l’âme et du corps. Les premières pages du Werther, qui semblent écrites
à partir de la sensibilité d’un organe antérieur à la différenciation du
coeur et des sens, en témoignent, comme aussi le rêve initial du roman
de Novalis, quand Henri, se baignant dans l’eau dorée de la vasque
naturellement creusée dans la roche souterraine, s’abandonne à la délicatesse
d’une sensualité toute pénétrée de pneuma. On peut certes
objecter qu’il y a, dans toute la littérature européenne de l’époque, une
véritable explosion du sentiment amoureux et de sa réalité charnelle.
Mais ceci montre seulement que la matière psychique est désormais
pleinement constituée comme telle, dans toute son épaisseur terrestre. Ce qui distingue la littérature allemande d’alors et ce qui fait du mot
Sehnsucht un intraduisible, c’est que le sentiment amoureux, et le sentiment
amoureux le plus incarné, y est ressenti comme le porteur de
l’individuation, comme la voie d’initiation au symbole. Rien de tel, par
exemple, dans le roman de Rousseau, La Nouvelle Héloïse. L’ amour
chanté et glorifié y reste, heureux ou malheureux, étroitement enfermé
en lui-même. Il n’est habité d’aucune finalité qui le dépasse, il n’y a pas
trace en lui d’une virtualité pneumatique. Il faut même aller plus loin et
dire qu’il est caractérisé par une véritable impuissance spirituelle, ce qui
n’a rien de surprenant, puisque toute la « vertu » de Julie consiste à se
laisser détruire par une soumission sacrificielle à la volonté paternelle,
ce qui est justement l’inverse du mouvement individuant, le contraire
de la Sehnsucht.
(...)
(...)
Jung, qui a porté la quête à son plus haut degré de réflexion sur
elle-même, reste, deux siècles après Goethe, comme Goethe, un alchimiste.
Par l’élaboration de la « psychologie des profondeurs », par la
pensée de ce qu’il appelle l’« inconscient collectif », qui ouvre à l’interprétation
des rêves toute sa dimension et son efficace, par ses études sur
l’alchimie enfin, il a traduit la quête dans le langage le plus actuel et lui
a donné, sous le nom de processus d’individuation, une visibilité qu’elle
n’avait jamais eue. Mais il est tellement saisi par elle, entraîné dans son
mouvement, qu’il reste comme immergé en elle. Dans de nombreux passages
de ses oeuvres parues après la Seconde Guerre mondiale et jusqu’à
sa mort règnent pourtant une tonalité très sombre, un ton très lourd qu’on
sent en relation évidente avec la pleine révélation de l’horreur au cours
de ces années. Mais il a beau parler de mal absolu, nulle part Jung ne rompt avec le schéma explicatif du phénomène nazi exposé, en 1936 ,
dans son article Wotan. Le nazisme y est compris comme une régression
barbare, c’est-à-dire comme l’irruption dévastatrice d’énergies inconscientes
trop longtemps rejetées, réprimées comme entièrement mauvaises
et, donc, non entrées dans la transformation.
Jung prend ici pour la réalité du nazisme ce qui en est le masque.
C’est en effet sous le masque du barbare splendide, de l’aryen au sang
pur, fidèle à l’origine, fidèle à la nature, que le mal radical, qui a toujours
besoin d’un mensonge de justification morale qui l’érige en
valeur absolue, a pris possession, dans l’Allemagne d’Hitler, de psychés
fragilisées et menacées dans leur identité [4]. Jamais Jung, chez qui
l’on sent pourtant, dans certaines pages, toute la pression qu’exerce sur
son esprit la découverte des crimes nazis, ne parvient à libérer cette
pression par la naissance du concept dont elle est porteuse. Jamais il ne
parvient à distinguer, à côté de l’ombre, à côté d’un mal qui est le négatif
d’un positif, qui se situe dans le jeu des contraires et qui est donc
susceptible d’entrer dans la transformation, un mal radical qui consiste
justement, par l’élimination de l’autre en tant qu’Autre, à rendre
impossible le jeu des contraires, c’est-à-dire à substituer à la transformation
créatrice un système de décréation. Lorsque, dans Les Racines
de la conscience, Jung parle longuement de la Passion du Christ, il
emploie de façon totalement indifférenciée les mots « supplice » et
« sacrifice » et confond ainsi ce qu’il importe au plus haut point de distinguer
: d’une part, le supplice-symbole de la transformation intérieure
par l’écartèlement et la suspension entre les contraires, dont la
crucifixion est l’image, d’autre part, le sacrifice, concret et sanglant
(même dans le cas où on ne le considère pas comme historiquement
advenu) de la victime émissaire, qui ressortit au mal radical.
C’est pourtant justement au cours de ces années où Jung restait
enfermé dans sa vision de la quête que la pensée du mal radical commençait
à émerger dans le conscient collectif, à mesure que l’on
découvrait, d’abord concrètement, puis à travers des documents et à
travers les témoignages des survivants des camps et de la Shoah, non
seulement l’ampleur, mais la nature des crimes du nazisme, à mesure
aussi que s’engageait et se développait, particulièrement dans les travaux
d’Hannah Arendt, la réflexion sur cette découverte, qui ne cessa
plus ensuite d’être relayée jusqu’à la fin du XXe siècle : crimes du totalitarisme soviétique, de la Révolution culturelle en Chine, de la révolution
cambodgienne, entreprises génocidaires dans l’ancienne
Yougoslavie, au Rwanda… Sans ignorer les singularités de chacun de
ces phénomènes, on les sent tous intimement apparentés. Il a fallu
attendre l’époque actuelle, ses capacités techniques, avant tout ses
moyens de communication, qui permettent aussi bien l’organisation à
grande échelle des projets et des systèmes d’éradication que la diffusion
universelle de la connaissance qu’on en a (parfois dans le temps
même du crime, parfois quelques années plus tard), pour que s’imposent
à l’esprit une différenciation à l’intérieur de la notion de « mal »,
et donc la pensée d’un mal dont l’horreur réside d’abord dans sa finalité,
qui le désigne justement comme radical.
Il n’est pas étonnant qu’il ait fallu, pour que se produise cette prise
de conscience collective, qui en est encore à son commencement, des
événements aussi massifs, avérés, documentés, irréfutables, portés à la
connaissance de tous. Le mal radical est, en effet, si pétrifiant pour le
coeur et l’esprit, sa dimension métaphysique, puisqu’il est une entreprise
d’anéantissement de l’autre en tant qu’Autre, et donc une entreprise
de décréation de l’humain en l’homme, excède à tel point les
mobiles passionnels ou les motifs d’intérêt, qui peuvent certes lui être
associés mais ne l’expliquent pas, qu’on reste devant lui stupide autant
qu’horrifié. Pour beaucoup de gens, le mal radical, malgré l’accumulation
des preuves les plus certaines, reste irréel. Il ne s’agit pas de
révisionnisme, lequel témoigne d’une inhumanisation de la psyché. Il
s’agit de l’effet de sidération que produit le mal radical sur la sensibilité
et la pensée, qu’il frappe d’impuissance.
Ainsi, alors qu’à la fin du XVIIIe siècle l’évolution de la sensibilité et,
plus généralement, du rapport au monde au cours des siècles précédents
avait permis la réception et la fructification du legs spirituel de
l’alchimie et des contes de quête, la science du mal radical que recèlent
les contes de libération ou d’enquête resta, au contraire, comme en
suspens et sans efficace, et c’est aujourd’hui seulement que leur fécondité
peut se manifester. Il a fallu pour cela que s’impose, dans la
seconde moitié du XXe siècle, à travers le caractère massif des crimes
organisés par des régimes totalitaires ou génocidaires, et en raison des
similitudes frappantes de tous ces crimes, la notion d’un mal radical,
de nature sacrificielle, les traits constants du sacrifice de la victime
émissaire y étant chaque fois reconnaissables de façon évidente :
imposture de justification morale par l’absolutisation d’une pureté fantasmatique
(celle du sang ou de l’idéologie), identification du groupe supérieur en nombre ou en puissance à cette pureté du Même, avilissement
et anéantissement de l’autre en tant qu’Autre, déclaré porteur
du mal absolu. Mais dès lors que la notion de mal radical est présente
dans le conscient collectif, dès lors que la dimension décréatrice et le
caractère de démence éthique de ce mal sont généralement pressentis
et déjà pensés dans une certaine mesure, la connaissance qu’on en a se
différencie et s’étend : elle ne se limite plus aux phénomènes sacrificiels
à grande échelle, d’importance historique, dans lesquels l’État,
toute une société ou des groupes sociaux numériquement considérables
se trouvent impliqués. Une clairvoyance est née, qui sait reconnaître,
loin de la sphère publique, loin des regards, dans la vie
quotidienne et tout particulièrement au sein de la famille, des processus
qui, dans des contextes très différents et sous des formes moins
aisément repérables, sont de même nature, c’est-à-dire des processus
sacrificiels, des entreprises de décréation.
Ce n’est évidemment pas par hasard, en effet, si, dans le dernier tiers
du XXe siècle, depuis vingt à trente ans environ, viennent à la lumière,
dans la presse, dans tous les médias, et sont portées devant les tribunaux
toutes les formes de la maltraitance de l’enfant, dont le caractère
systématique, dès qu’il est avéré, est la signature du mal radical. Cette
prise de conscience marque d’autant plus profondément l’esprit que le
mal radical n’apparaît plus alors comme quelque chose d’extraordinaire
et d’exceptionnel, lié à de grands événements, mais au contraire
comme quelque chose de très commun, présent au milieu de nous sans
que nous le percevions la plupart du temps. Et l’on est alors extrêmement
surpris de découvrir que cette clairvoyance nouvelle était en réalité
déjà là depuis toujours, depuis le « il était une fois » des contes
merveilleux, que les contes de libération et d’enquête savaient déjà
tout du sacrifice de l’enfant, qu’ils mettent à nu le mal radical, exposant
par images, beaucoup plus immédiates, fortes et riches de sens
que les concepts, sa nature et ses formes (peu variées), ses stratégies,
ses ravages dans la psyché de la victime. Et c’est avec un étonnement
toujours croissant qu’on se plonge dans leur lecture et qu’on se trouve
placé par eux au plus près de la décréation. Ainsi ces contes, dont un
organe quasi nouveau, une profondeur de regard ouverte dans l’humanité
actuelle par les crimes sacrificiels massifs du XXe siècle permettent
enfin la réception, deviennent aujourd’hui féconds et s’intègrent, non
pas de façon naturelle et fluide, mais de façon réflexive, à la sensibilité
et à la pensée actuelles.
FIN
Notes
[1] Voir Introduction, pp. 20-24.
[2] Voir p. 106.
[3] Cf. Introduction, notamment pp. 10-20.
[4] Parler, comme on le fait si souvent aujourd’hui encore, de « barbarie nazie », c’est se laisser prendre au piège de ce masque, et c’est une véritable défaite de la pensée, qui nuit à la capacité d’action contre ce mal. Voir Introduction, pp. 29-30.