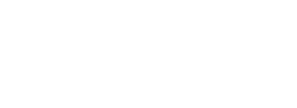- Nos projets & actions en cours
L’association Adéquations agit en matière d’information, formation, projets en croisant les enjeux d’égalité femmes-hommes, de transition écologique et climat, de solidarité internationale et droits humains
- Nos formations et accompagnements
- Evénements & webinaires
Adéquations
- Féministes pour des Alternatives Climat Environnement
- Transition écologique et égalité femmes-hommes
- Education non sexiste et Droits de l’enfant
- Solidarité internationale et coopération
- Egalité femmes-hommes & genre
Etudes et archives
- Actions collectives & partenariats
- Démocratie &
veilles citoyennes - Développement humain durable
Expertises, méthodes
- Membres et partenaires
|
Accueil > Membres et partenaires > Anna Griève > Les trois corbeaux, ou la science (...) > Chapitre 4 - Les contes de libération - Les pères (...) |
Les trois corbeaux, ou la science du mal dans les contes merveilleux
Chapitre 4 - Les contes de libération - Les pères sacrificateurs
février 2010, par
(...)
Les pères sacrificateurs et le diable
On suppose tout naturellement que l’impression constante d’absence
du père qui se dégage des contes où la mère-marâtre est la sacrificatrice
se limite forcément à ces mêmes contes, et que, lorsque le
père lui-même est le sacrificateur, il ne peut être que bien davantage
présent dans le cours du récit. Or, tout au contraire, c’est encore, dans
presque tous les contes dont il va être question, l’impression d’absence
du père qui prévaut — si l’on excepte, bien entendu, le tout début du
récit, où il joue évidemment, en tant que sacrificateur, le rôle capital.
Mais ce rôle est bref, et le père disparaît presque toujours très vite. Il
ne réapparaît que de façon rarissime dans le récit et se trouve, comme
nous l’avons vu plus haut, et sans exception à notre connaissance,
entièrement oublié à la fin, exactement comme s’il n’avait jamais
été — et cela alors que tout le récit découle de l’acte sacrificiel qu’il a
accompli au début.
Dans les deux contes La Jeune Fille sans mains et Le Roi de la montagne d’or, les deux pères, tombés dans la misère, rencontrent au début,
l’un « un vieil homme », l’autre « un petit homme noir », qui leur promet
de les rendre riches si le premier lui donne « ce qui est derrière la
maison », le second « ce qui, lorsqu’il rentrera chez lui, le touchera à la
jambe ». L’emploi du pronom neutre « ce » est extrêmement significatif,
en ce qu’il induit à penser qu’il s’agit d’une chose, et non d’un être
humain. Ce pronom trahit, au-delà des apparences, ou plutôt au-delà de
la normalité superficielle qui a jusque-là prévalu, non pas le sentiment,
mais le non-sentiment intime de ces pères quant à leur enfant, non-sentiment
que l’occasion offerte de sortir de la misère révèle au grand jour,
mais dont elle n’est pas la cause, car une telle occasion de devenir riche
au prix de la ruine de l’enfant ne serait pas prise en considération par un
père véritable. Il faut même dire que l’occasion n’existerait tout simplement
pas pour un père véritable, parce que la possibilité d’une telle
« solution » lui étant entièrement étrangère, l’occasion ne se constituerait
pas comme telle : il ne lui viendrait pas à l’idée de vendre son enfant
au diable, c’est-à-dire, par exemple, de le livrer, en échange de biens
matériels, à la prostitution, à un travail dégradant, à la servitude, à toute
forme de traitement inhumain, qui le détruirait intérieurement plus sûrement
encore que physiquement. C’est bien pourquoi apparaît dès le
début la figure de la décréation par excellence, le diable, qu’il faut évidemment
comprendre ici, sans aucune référence aux conceptions théologiques
chrétiennes, comme le mal radical tel que le conte le ressent.
L’abrupte sûreté de regard des contes se vérifie ici une fois de plus :
pourquoi ces pères, devant la proposition d’un marché aussi insolite,
aussi évidemment inquiétant, ne prennent-ils pas le plus bref instant de
réflexion, sinon parce que cet insolite et cet inquiétant ne sont perçus
par eux que de façon évasive, aussi évasive qu’est leur perception de
la personne de l’enfant, de l’enfant comme personne ? Il est tellement
tentant d’ignorer cet insolite, cet inquiétant, d’ignorer cette importune
et incommode intuition que l’enfant est une personne, de s’ignorer
ainsi soi-même comme personne. Il est tellement tentant de se soustraire
à la relation et à son insupportable exigence morale, de se laisser
glisser tranquillement dans le non-humain, là où il n’y a que des
besoins et des intérêts, en signant le papier par lequel l’enfant devient
définitivement un végétal, un pommier, tout juste bon à donner des
pommes, ou un animal, un chien, que l’on caresse et aux caresses
duquel on répond distraitement.
Il n’y a pas de retour en arrière possible : parce que le pacte avec le diable a été signé et scellé, bien sûr, mais cette image demande à être
comprise de façon tout intérieure, afin de ne pas se contenter de la surface
des mots. Ces pères ont reçu de la vie la faveur d’être placés en ce
point décisif où l’être humain accède à l’essence de l’humain en lui, ou
la renie. Certes, ils ne sont pas sans affection pour leur enfant. Mais la
conscience en eux, au lieu de s’arrêter sur l’insolite, de laisser monter
le malaise, de prendre la mesure de l’insuffisance de leur sentiment
envers l’enfant comme personne et de trouver ainsi en eux la ressource
de cette dimension archétypale qui seule permettrait de passer d’une
paternité factuelle à une paternité authentique, la conscience chez ces
pères se trouve annihilée par une opération magique de négation de ce
qui est en jeu ; ils croient éluder, mais c’est justement éluder, ici, qui
signifie le choix sans retour. Ils ont tendu au mal radical une main
oblique, mais ils lui ont bel et bien donné la main, et sont désormais
privés de la force d’accéder au plan de la personne, privés de la force
de voir en leur enfant autre chose qu’un bien destiné à leur usage et à
leur agrément, un pommier, un chien. L’un de ces pères a beau
entendre, sans la contredire, sa femme lui déclarer qu’il a vendu sa fille
au diable, et être manifestement peu fier de lui, le deuxième a beau être
épouvanté de voir que c’est son fils, et non son chien, qui dans un
transport de joie enfantine se jette sur lui quand il rentre et lui saisit les
deux jambes, le plus intime de l’être est maintenant, chez tous deux,
pourri irréversiblement. La preuve en est que l’or, qui soudain emplit
leur maison, ne leur fait pas horreur : passé le premier moment, ils
jouissent platement de cette facilité et de cette abondance, et certes, ils
sont tout à fait « gentils » envers leur victime pendant les trois ans qui
s’écoulent, dans La Jeune Fille sans mains, et les quelque huit ou dix
ans, dans Le Roi de la montagne d’or, avant que le diable vienne chercher son dû.
La Jeune fille sans Mains
Cette veulerie de coeur, cette pourriture au centre de l’être sont exposées
de façon insurpassable dans La Jeune Fille sans mains. La jeune
fille connaissait le marché signé par son père. Elle avait vécu pendant
les trois ans « dans la crainte de Dieu et sans péché ». Le jour où le
diable doit venir la prendre, elle se lave tout entière et se place au centre
d’un cercle qu’elle trace à la craie autour d’elle. Le diable veut la
prendre par la main pour la tirer hors du cercle, mais ses mains sont si
pures qu’il ne peut la toucher. Furieux, il ordonne au père de faire en sorte qu’elle n’ait pas d’eau pure pour se laver. Le père a peur et obéit.
Le lendemain, le diable revient, mais elle a tant pleuré sur ses mains
qu’elles sont toutes pures et que, de nouveau, il ne peut la saisir pour la
tirer hors du cercle. Alors le diable ordonne au père de trancher les
mains de sa fille. Le père proteste, disant qu’il ne peut tout de même pas
trancher les mains de sa propre enfant. Mais le diable le menace, s’il ne
le fait pas, de l’emmener à la place de sa fille. « Alors le meunier eut
peur et lui promit d’obéir. Il alla à sa fille et lui dit : “Mon enfant, si je
ne te coupe pas les deux mains, le diable m’emportera, et dans ma peur
je le lui ai promis. Viens à mon secours dans ma détresse et pardonnemoi
le mal que je te fais.” » Elle répond : « Cher père, je suis votre
enfant, faites de moi ce que vous voulez » et tend les mains, et le père
les lui coupe. Mais lorsque le diable revient le lendemain, pour la troisième
fois, elle a tant pleuré sur ses moignons qu’ils sont purs et que,
de nouveau, il ne peut les saisir. Ainsi perd-il tout droit sur elle. Alors
le père dit à sa fille ces paroles que leur criante vérité rend parfaitement
vertigineuses, comme si le sol se retirait et comme si le regard plongeait
soudain jusqu’au fond du Non-sens : « J’ai acquis grâce à toi tant de
biens, je t’entretiendrai toute ta vie dans le luxe le plus précieux. » A
quoi la jeune fille répond sans mots superflus : « Je ne peux rester ici ;
je partirai, des gens au coeur charitable me donneront l’indispensable. »
Et elle s’en va, les bras, à sa demande, attachés sur le dos.
Elle a donc échappé au diable, c’est-à-dire qu’elle s’est, grâce au
cercle tracé autour d’elle et grâce à l’obstination de ses larmes, grâce
à la résistance passive seule possible mais entière, intense, qu’elle lui
a opposée, soustraite à l’emprise du mal radical sur son être et toute sa
personne. Elle s’est maintenue en elle-même, en son centre. Mais si le
centre est intact, la mutilation, psychique et physique, est terrible, la
détresse extrême. Et ce qui est frappant, c’est que pareil malheur
puisse être infligé non par la malveillance, non par la méchanceté
acharnée à détruire, mais au contraire par une inconsistance teintée
d’affection, non dénuée de pitié, à laquelle ne manque pas même un
certain degré de conscience du caractère monstrueux du geste
consenti : « Comment pourrais-je couper les mains de ma propre
fille ? » C’est comme si tout l’humain était là, tout ce qu’on peut appeler
« l’humain charnel ». Cet « humain charnel » n’est nullement perverti
chez ce père, comme il l’est chez les mères-marâtres, dévorées
par la haine, le désir de détruire, de faire souffrir. C’est chose presque
inconcevable, que cet « humain charnel » si normal, justement si peu
monstrueux, si peu inhumain, s’abandonne, à contrecoeur d’ailleurs, au plus monstrueux, au plus inhumain, jusqu’à s’en faire l’agent quand
« il le faut » absolument. « Si je ne te tranche pas les mains, le diable
m’emportera, pardonne-moi donc et viens à mon secours dans ma
détresse. » Il ne manque à ce père qu’une chose, mais c’est celle qui
fonde l’humain véritable, et sans laquelle « l’humain charnel » n’est
rien, et, même plus grave que rien, une surface trompeuse : il lui
manque la responsabilité éthique — non pas morale — c’est-à-dire la
capacité de se faire face à lui-même, la capacité de relation à lui-même,
et donc à l’autre, le lien de la personne à la personne.
Ce lien est également absent chez la mère-marâtre, et, chez elle, la
responsabilité éthique est tout aussi inexistante. Mais cette absence du
fondement humain n’apparaît pas aussi « purement » que chez le père
dans ce conte, et dans la plupart des contes où le père est le sacrificateur.
Car il y a chez la mère-marâtre une telle inversion et perversion
du sentiment « humain charnel » qu’il paraît à la fois superflu et incongru
de parler d’une incapacité à la responsabilité éthique et à la relation.
Les mères sacrificatrices ne donnent jamais une impression de
faiblesse, d’inconsistance, d’absence. Leur méchanceté a la dureté du
roc ou du fer, et leur mauvaise foi, dans les contes où ce thème apparaît,
comme dans La Vraie Fiancée, conte de Grimm dont il sera dit
quelques mots plus loin, est sans limite et sans faille.
Le père sacrificateur au contraire non seulement manifeste, mais
avoue, dans La Jeune Fille sans mains, une faiblesse infantile, une
impuissance si lamentable et reconnue qu’il va se placer sans honte
sous la protection de sa fille comme si elle était sa mère, alors même
qu’il lui coupe les mains. Il est au-delà ou en deçà, on ne sait ce qu’il
faut dire, de la mauvaise foi, dans un consentement écoeurant à sa
propre débilité, dans la naïveté imbécile et la conviction monstrueuse
que lui seul compte, que seuls importent son bien-être à lui, la tranquillité
de sa vie, et que les autres, et sa fille même, cela dût-il signifier
leur perte, leur malheur le plus extrême, ne peuvent pas ne pas se rendre
à cette évidence. Voilà chez le père, marque du pacte signé avec le mal
radical, l’informe hideux sous « l’humain charnel ».
Cet informe avoué signe la dérobade intime devant la relation : mauvaise
foi dans l’aveu même, qui n’est destiné qu’à permettre le parachèvement de l’horreur. Or, le mal radical est justement la négation de la
relation, le refus de toute mise en relation, au profit de l’adhérence au
même. À un tel degré de destructuration psychique, il n’y a plus de différence
entre les contraires, il n’y a tout simplement plus de contraires.
Ainsi le père, pour échapper au diable, se loge-t-il dans la volonté du diable. Car, s’il rompait son engagement envers le diable, il le paierait
très cher, de la vie sans doute : il a accepté l’or, depuis des années.
Concrètement, il a sans doute vendu sa fille à quelque homme sans
scrupule et puissant qui a payé d’avance : on ne sort pas impunément
d’un tel engrenage. C’est cela, pour lui, le diable, et pour se protéger
de ce diable, pour se protéger de la relation à sa fille, qui le livrerait à
ce diable, il s’efface dans la volonté du NON-sens et se dissout en elle.
Il n’apparaîtra plus.
Mais le NON-sens auquel il a livré passage va poursuivre avec
acharnement celle qui lui a échappé, essayant de la tuer corps et coeur.
Toutefois, il n’a aucune prise sur son être profond, car elle l’a vu. Elle
« ne peut pas » rester dans la maison paternelle : là où il n’y a pas de
relation, il n’y a pas non plus de pain quotidien, ni de gîte, ni de luxe,
il n’y a que le vide. Pour s’éloigner de ce vide, elle part seule, mutilée
dans sa chair et son âme, vers une pauvreté plus affreuse que tout ce
que son père a jamais pu craindre pour lui-même. Ainsi le diable—non
ambivalent — se charge-t-il ici directement de l’acharnement persécuteur
qui est sa nature même.
Le père sacrificateur, dans les contes, livre passage au mal radical et
laisse ensuite, sans plus s’en soucier, libre cours à l’acharnement de la
figure de la décréation. À la différence de la mère sacrificatrice qui
assume elle-même, obsessionnellement, l’acharnement du mal radical.
Ainsi, l’impression d’absence du père que laissent les contes où la
mère-marâtre est la sacrificatrice ne s’atténue en rien, mais se confirme
au contraire à la lecture des récits où le père est le sacrificateur. Son
absence s’y fait dense, lourde, essentielle. C’est une effrayante présence
du vide, qui permet de saisir la nature du mal radical, ou peut-être l’élément
où il se meut, hors duquel il ne peut jamais se manifester : le néant
de la relation à jamais, c’est-à-dire le NON-sens en lui-même,
l’Absence. Car l’humain est le lieu de la relation. Hors de la relation, il
sombre dans le néant avide où la décréation est à l’oeuvre.
L’absence de la relation à l’enfant est évidemment la même dans les
contes où la mère-marâtre est la sacrificatrice. Cependant comme le
mode du sacrifice n’y est pas la démission, n’y est pas la trahison de
l’enfant aux puissances du mal radical, comme le sacrifice au contraire
y prend la forme de la haine maniaque sans cesse occupée de se satisfaire,
de s’assouvir, il ne se dégage pas du conte une impression d’absence
de la mère, mais plutôt une impression de présence implacable,
étouffante, qui ne laisse pas d’issue — sauf celle dont elle est porteuse :
la mort. C’est pourquoi les contes où le père est le sacrificateur— ceux du moins dont il est question ici, nous en verrons d’autres— révèlent
mieux, rendent plus sensibles la nature et l’élément du mal radical, ce
néant de la relation, l’Absence elle-même, alors que les contes où la
mère marâtre est la sacrificatrice rendent plus sensibles en quelque sorte
la qualité énergétique de cette Absence, son avidité démentielle de destruction.
Père et mère sacrificateurs, il s’agit d’un seul et même NON-sens.
L’inexistence de la relation avec le père et la méchanceté maniaque de
la mère sont tout aussi douloureusement incompréhensibles et produisent
des effets également destructeurs ; il faut encore préciser que
l’acharnement du mal radical, pour être, dans les contes où le père est
le sacrificateur, très vite entièrement transféré à la figure de la décréation
elle-même, n’en est pas moins effrayant. Cette différence entre
pères sacrificateurs et mères sacrificatrices n’est encore qu’approchée,
le coeur même de la différence n’est pas encore atteint. L’étude d’autres
contes permettra d’y parvenir, sans que cette étude se concentre pour
autant entièrement sur ce point.
(...)