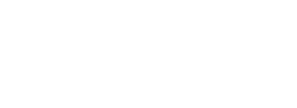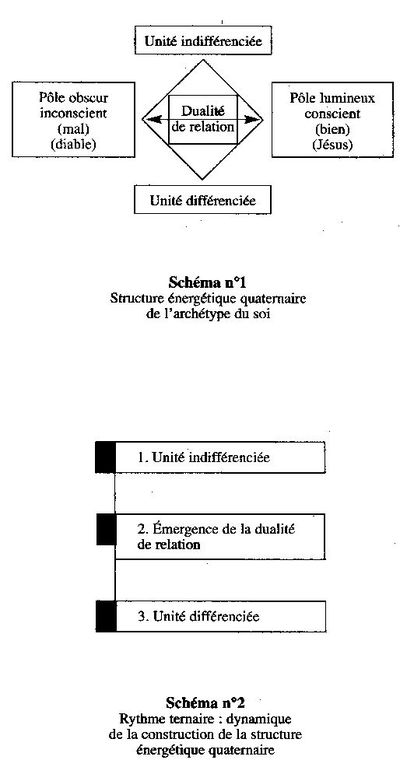- Nos projets & actions en cours
L’association Adéquations agit en matière d’information, formation, projets en croisant les enjeux d’égalité femmes-hommes, de transition écologique et climat, de solidarité internationale et droits humains
- Nos formations et accompagnements
- Evénements & webinaires
Adéquations
- Féministes pour des Alternatives Climat Environnement
- Transition écologique et égalité femmes-hommes
- Education non sexiste et Droits de l’enfant
- Solidarité internationale et coopération
- Egalité femmes-hommes & genre
Etudes et archives
- Actions collectives & partenariats
- Démocratie &
veilles citoyennes - Développement humain durable
Expertises, méthodes
- Membres et partenaires
|
Accueil > Membres et partenaires > Anna Griève > Les trois corbeaux, ou la science (...) > Introduction - La double nature du mal |
Les trois corbeaux, ou la science du mal dans les contes merveilleux
Introduction - La double nature du mal
février 2010, par
Cette étude sur les contes merveilleux n’a pas son origine dans une réflexion sur les contes eux-mêmes, mais dans une méditation beaucoup plus générale, née de la jonction entre deux expériences vécues d’abord séparément, et qui restèrent longtemps tout à fait séparées. Ce fut d’une part, dans les années de l’adolescence, à travers la lecture de divers ouvrages, la révélation des crimes nazis, du système des camps, de la Shoah, c’est-à-dire d’un mal si paralysant pour le sentiment et l’esprit, et par là même si obsédant, qu’il n’était plus possible de continuer à vivre comme s’il n’existait pas, et qu’il devenait vital de ne jamais renoncer à tenter au moins de penser l’impensable. Ce fut d’autre part, dans les années de la maturité, la rencontre avec l’oeuvre de Carl Gustav Jung et l’assimilation progressive de sa pensée à travers la réalité vécue du processus d’individuation, dont toute son oeuvre est la description. Ces deux expériences ne pouvaient à la longue rester étrangères l’une à l’autre. En effet, le processus d’individuation impliquant une certaine conception du mal, nous devions nécessairement nous trouver confrontée un jour à la question de savoir si le mal dont le nazisme nous avait révélé l’existence et qu’Hannah Arendt avait qualifié de « mal radical », pouvait être pensé dans le cadre de la vision jungienne de la psyché, dans une quelconque relation au moins à cette vision, ou s’il en rendait au contraire manifeste l’insuffisance.
Au terme d’un long travail d’approfondissement, il apparut qu’il
était possible, en prenant appui sur les acquis de la réflexion de Jung,
mais à condition d’en développer des potentialités que lui-même
n’avait pas explorées, de découvrir entre sa description du dynamisme
psychique et la spécificité du mal à l’oeuvre dans le nazisme (et autres
entreprises analogues) une articulation permettant de rendre compte de
la double nature du mal, et non seulement de caractériser le mal radical,
mais de le penser profondément. C’est alors que nous eûmes l’idée
d’appliquer aux contes merveilleux les conclusions de notre recherche :
nous vîmes avec surprise s’ordonner soudain leur foisonnement, en
même temps que notre regard nous sembla pénétrer beaucoup plus
avant dans leur compréhension — ce qui corroborait en retour ces
mêmes conclusions. Ainsi naquit le projet d’écrire le présent ouvrage.
Marie-Louise von Franz, la principale collaboratrice de Jung, a
offert de nombreux exemples d’interprétation jungienne de contes
merveilleux. Certaines de ces interprétations nous paraissent tout à fait
remarquables. Nous pensons ici à trois de ses ouvrages : L’Âne d’or,
interprétation d’un conte [1], La Voie de l’individuation dans les contes de fées [2] et L’Interprétation des contes de fées [3]. Les contes dont il s’agit dans ces trois ouvrages sont de ceux que la description jungienne du processus d’individuation permet d’interpréter de façon aussi subtile que profonde, c’est-à-dire que ce sont des contes où le mal radical n’est pas à l’oeuvre. Mais quand, dans d’autres ouvrages, La Femme dans les contes de fées ou L’Ombre et le Mal dans les contes de fées [4], Marie-Louise von Franz commente des contes où le mal radical est à l’oeuvre, alors les interprétations deviennent extrêmement insatisfaisantes : superficielles et souvent confuses, elles restent sans prise sur les récits. La description du processus d’individuation donnée par Jung et reprise par Marie-Louise von Franz n’est plus adéquate, elle ne permet pas de saisir l’enjeu de ces contes.
C’est qu’il y a dans la pensée de Jung, et justement dans sa conception
du mal, une « tache aveugle ». Jung, comme d’ailleurs aussi la
doctrine chrétienne— mais d’une autre façon, comme nous le verrons
plus loin —, considère le mal (nous ne parlons ici évidemment que du
mal moral) comme un, et il le caractérise comme « de l’ombre ». Dans
cette « ombre », il distingue certes deux niveaux, l’ombre personnelle
d’une part, et d’autre part, selon les passages pris en considération,
« l’ombre de l’archétype », ou « l’archétype de l’ombre », ou « l’ombre
de l’archétype du Soi », sans que ces trois expressions ne soient jamais
clairement et distinctement définies. On a l’impression ici d’un grand
flou de la pensée — et nous ne sommes pourtant pas de ceux pour qui
les concepts et conceptions de Jung ne sont que brouillards et fumées, et qui parlent de lui avec condescendance, faute, à notre avis, de saisir
l’objet véritable de son oeuvre. Le flou qui nous gêne est, si l’on peut
ainsi s’exprimer, bien délimité, mais il concerne une question évidemment essentielle. Autant la conception du mal impliquée par le terme
« ombre » (sur lequel nous allons revenir) nous paraît juste et féconde
dans la plupart des cas, autant elle nous paraît inadéquate, dénuée de la
moindre pertinence et même déplacée lorsqu’il s’agit, par exemple, de
la Shoah ou des camps nazis décrits par Robert Antelme et Primo Lévi.
En effet Jung, même dans les textes où il a manifestement présents à
l’esprit les crimes du nazisme, persiste imperturbablement et presque
inexplicablement dans sa conception du mal.
C’est en réfléchissant sur cette zone de flou dans sa pensée que nous
sommes parvenue à la conclusion de la double nature du mal, de l’existence
d’un mal radical, déjà caractérisé par Hannah Arendt. Il nous est
alors apparu que le processus d’individuation décrit par Jung se présentait
avec deux modalités différentes selon que l’individu avait
affaire en lui-même à l’une ou l’autre nature du mal, et que les contes
merveilleux avaient la connaissance de l’une et de l’autre voie, de la
différence entre elles aussi bien que de leur unité profonde.
Le terme « ombre » employé par Jung pour désigner le mal en implique déjà une définition. L’ombre en effet n’est pas seulement de
l’obscurité, elle ne s’oppose pas simplement à la lumière, puisqu’elle
apparaît grâce à la lumière, étant une zone sombre créée par un corps
opaque lorsqu’il est éclairé, et pouvant être comprise aussi comme la
partie non éclairée de ce corps, « laissée dans l’ombre ». Désigner le mal
comme ombre signifie donc qu’il a son origine dans l’état d’inconscience
où se trouvent certains contenus psychiques, et non dans ces
contenus eux-mêmes. Le mal naît de ce que certains contenus psychiques
n’ont pas accès à la conscience, soit que celle-ci les refoule, soit
que l’occasion d’établir avec eux une relation ne se soit pas encore présentée.
Si le mal réside non dans les contenus psychiques en eux-mêmes,
mais dans leur état d’inconscience, le poids et la responsabilité du mal
se portent dès lors sur l’incapacité ou le refus du conscient à entrer en
relation avec ces contenus. C’est la non-participation de ces contenus à
l’existence consciente qui les abîme, les déforme ou les pervertit, soit en
les maintenant dans un état archaïque, sous-développé, soit en les obligeant
à régresser jusqu’à cet état, soit en réduisant leurs énergies inemployées
à se manifester par des explosions destructrices ou par des
stratégies perverses, ce qui mène à des impasses vitales où la personnalité
tout entière et même parfois la vie se trouvent en grand danger. Cette
conception du mal suppose que l’établissement du lien à la conscience
transforme ces contenus et réoriente leurs énergies — comme il transforme aussi le conscient lui-même en l’assouplissant et en l’élargissant. La désignation du mal comme « ombre » implique nécessairement que le mal est toujours, virtuellement du moins, transformable, qu’il est, jusque dans la noirceur la plus noire, en attente de ce lien à la conscience qui le révélera comme une richesse indispensable à la synthèse de la personnalité, c’est-à-dire porteuse de cette « totalité » psychique qui est la finalité de l’individuation et signifie, tant pour la psyché que pour l’existence, une fécondité renouvelée. En définitive, ce sont l’étroitesse et la rigidité du conscient, sa peur du nouveau, de l’inconnu, de l’obscur, son mépris de l’étranger, de l’a-normal, bref, tout ce que Jung entend par l ’ « unilatéralité du conscient », qui expliquent que certains contenus psychiques restent enfermés dans ce qui nous apparaît sous les différents aspects et dans les différentes manifestations du mal.
Nous adhérons parfaitement à cette conception jungienne d’un mal
transformable. Elle nous paraît juste… à condition pourtant qu’elle s’applique
au mal véritablement transformable. Car ne pas différencier mal
transformable et mal radical s’avère lourd de conséquences, tant dans le
travail psychothérapeutique que dans le domaine pratique de l’attitude à
adopter et de l’action à mener face à la réalité concrète du mal.
Il est maintenant nécessaire de tenter une présentation, aussi succincte
que possible, du processus d’individuation [5] décrit par Jung, car
notre réflexion sur le mal radical qui, à la différence de celle d’Hannah
Arendt, envisage ce mal d’un point de vue psychique et ontologique,
est entièrement adossée à la pensée de Jung, dont elle n’est qu’un
développement et un prolongement, et en dehors de laquelle il est
impossible de l’exposer.
Le processus d’individuation, dynamisme spontané de la psyché, naît
d’une mise en rapport des opposés psychiques (conscient / inconscient , bien / mal, beau / laid, masculin / féminin, amour / justice etc.) sous le
regard de la conscience. Cette mise en rapport des contraires requiert
pour pouvoir se produire une situation particulière, celle où l’être se
trouve pris en étau dans une contradiction existentielle si forte que la
décision dans un sens ou dans l’autre, loin d’être une résolution du
conflit, serait un acte de violence entraînant une mutilation de la personnalité,
car l’un des contraires se trouverait alors sacrifié à l’autre, c’està-
dire exclu de toute participation à la vie consciente, tant psychique que
concrète. Si, dans une telle situation, la conscience refuse la mutilation,
refuse donc de décider là où elle s’éprouve impuissante à le faire en
vérité, c’est-à-dire d’une façon qui satisfasse le coeur et l’esprit, une
structure psychique nouvelle commence à apparaître. La conscience,
cessant d’adhérer à ses propres contenus conscients sans pour autant se
soumettre à la puissance des contenus inconscients, acquiert une auton
o m i e — même si c’est une autonomie impuissante — par laquelle elle
devient enfin pleinement ce qu’elle est selon son essence : un regard, et
elle trouve sa juste place dans la psyché, qui est d’être un centre entre les
contraires. Si la conscience persiste dans cette position centrale, dans cet
écartèlement entre les contraires, souvent très long et très douloureux,
dans cet état de mort, de suspension tant de la vie psychique que du cours
de l’existence, alors les énergies de la tension entre les opposés, au lieu
de se perdre en mouvements désordonnés ou en luttes vaines, se concentrent
en ce point de conscience.
Parvenue à son plus haut degré, la tension se résout en un dynamisme
puissant né de l’union des énergies contraires, qui se transforment
dans le processus, perdant ce qui les rendait incapables d’oeuvrer
ensemble, sans pour autant cesser de se différencier qualitativement.
Ce processus est vécu comme une renaissance intérieure. La contradiction
existentielle de départ n’a pas pour autant disparu, et elle peut
rester difficile à porter et à supporter. Elle n’a pas été simplement
dépassée au sens ordinaire de « la vie continue », « la vie reprend toujours
le dessus ». Elle a bien été dépassée, mais dans un tout autre sens,
par un changement de plan. Sa charge énergétique était, en effet, la
marque de la présence en elle d’une dimension de l’être qui, prisonnière
des contenus inconscients, ne pouvait manifester sa puissance
que par une violence inquiétante et destructrice. En devenant le support
de cette charge énergétique, la conscience permet à l’union des
contraires d’advenir, elle offre à ce processus de transformation et de
création le point d’ancrage psychique sans lequel il resterait à l’état de
virtualité. L’être se trouve ainsi relié par la conscience à la dimension créatrice qui le féconde et l’oriente, à laquelle il peut s’accorder sans
être jamais en mesure de la prévoir, de la contrôler, de la maîtriser. La
personnalité devient une totalité centrée, fondée sur la relation entre la
conscience et la dimension créatrice ainsi révélée. C’est l’établissement
de cette relation qu’on appelle l’intégration.
Cette intégration se produit à travers l’émergence de ce que Jung
désigne comme un symbole. Par analogie avec un transformateur électrique,
il entend par là une sorte de convertisseur d’énergie psychique.
Ce n’est là, bien sûr, qu’une métaphore, mais elle rend sensible que le
symbole est agissant, parce qu’il se définit avant tout par son efficace :
non seulement il met un terme à la stagnation psychique, permet à
l’énergie de s’écouler à nouveau, et avec beaucoup plus de puissance,
non seulement il la réoriente, mais il la fait passer à un autre plan, à un
autre degré de l’être. Le symbole peut être une image, mais il peut tout
aussi bien être une rencontre ou l’éveil d’un talent. Si c’est une image,
ce peut être aussi bien une image nouvelle, surgie dans un rêve ou dans
une sorte de vision, qu’une image ancienne dont le pouvoir transformant
soudain se révèle. Ce pouvoir transformant et fécondant du symbole
tient à ce qu’il ouvre dans l’être un nouveau plan, où les opposés
psychiques, inconciliables au plan de réalité où la conscience était
rivée jusque-là, s’unissent dans une oeuvre commune de renouvellement
et de croissance psychique. C’est cette émergence du symbole
que Jung désigne comme expérience du sens, ou expérience du Soi.
L’expression « expérience du sens » est claire d’emblée, puisque la
stagnation dans une contradiction existentielle est une perte du sens. On peut en donner brièvement deux exemples. Ainsi le personnage de
Werther dans le roman de Goethe, Les Souffrances du jeune Werther, se trouve piégé dans le non-sens d’une nature qui ne crée que pour détruire, qui n’éveille l’amour que pour le saccager en lui fermant toute possibilité de réalisation, pour le muer ainsi en un désir de meurtre (de l’aimée ou du rival). Rejetant avec mépris une résignation respectueuse à la fois de la réalité et des personnes, Werther succombe à un amour devenu meurtrier, à ceci près pourtant que, pour éviter de devenir le meurtrier d’autrui, il se fait le meurtrier de lui-même. Ce sont là les contradictions inhérentes à ce que nous appelons la création charnelle, expression sur laquelle nous allons revenir un peu plus loin.
Un exemple inverse serait celui de la princesse de Clèves dans le
roman du même nom. Prise entre son amour pour le duc de Nemours et
son idéal moral, son image morale d’elle-même, la princesse choisit de
sacrifier l’amour, et la fin du texte nous fait assister à son dessèchement progressif, à sa mort psychique — là où Werther reste certes fidèle à la
fois à son amour et jusqu’à un certain point à son sens moral (puisqu’il
ne tue pas), mais au prix du meurtre de lui-même, ce qui met un terme
à la contradiction, mais ne la résout pas. Werther et madame de Clèves
sont tous deux prisonniers du plan de réalité qui est celui de la création
charnelle [6]. Madame de Clèves, pour obéir à un idéal moral, n’est pas
moins que Werther prisonnière de ce plan de réalité. Les règles morales
et les idéaux éthiques nous paraissent en effet, tout autant que les pulsions, désirs, peurs, etc., ressortir à la création charnelle. L’éthique véritable est d’un autre ordre, comme nous le verrons plus loin.
L’expression « expérience du Soi », c’est-à-dire « expérience de
l’archétype du Soi », conduit au coeur de la pensée de Jung puisque
l’archétype du Soi régit le processus d’individuation et que l’expérience
du Soi signifie l’établissement de la relation entre la conscience
et cet archétype à travers l’émergence du symbole. Il est sans doute
nécessaire de rappeler ici ce que Jung entend par « archétype ». Les
archétypes, explique-t-il, sont comme des sillons tracés dans la psyché
de tous les hommes par la répétition, génération après génération, des
mêmes expériences fondamentales, dont chacune est qualitativement
spécifique, et l’énergie psychique qui coule dans ces sillons a la qualité
de l’expérience correspondante. (Parce que ces archétypes sont à
l’oeuvre dans toute psyché humaine et parce que la plupart des hommes
sont inconscients de leur présence et de leur action, Jung les désigne
comme « l’inconscient collectif », expression que nous ne trouvons pas
très judicieusement choisie.) On peut parler d’images archétypales (ou
archétypiques), de représentations archétypales, mais les archétypes ne
se réduisent évidemment pas à des images. A un même archétype peuvent
correspondre bien des images différentes, selon l’état de la psyché
concernée à un moment donné. L’archétype du Père par exemple
pourra prendre forme animale ou humaine, celle d’un homme fort ou
d’un vieillard plein d’expérience…
Les archétypes fondamentaux sont ceux du Père, de la Mère, de
l’Animus (représentation de l’amant-époux dans la psyché féminine), de
l’Anima (représentation de l’amante-épouse dans la psyché masculine)
et l’archétype du Soi. Dans les contes merveilleux, ces cinq archétypes sont constamment à l’oeuvre, les quatre premiers selon qu’ils sont ou non
concernés par le type de difficulté ou de recherche du « héros » ou de
« l’héroïne » du conte. Quant à l’archétype du Soi, très nombreuses sont
ses images. Mais comme nous allons le voir, il faut se garder d’établir
une séparation nette entre l’archétype du Soi et les autres archétypes. Ce
qu’il importe avant tout de saisir à propos des archétypes, c’est en premier
lieu que leurs énergies sont le dynamisme créateur de la Vie ellemême,
qui ne s’épuise jamais, et en particulier le dynamisme structurant
de la psyché. En second lieu, ce dynamisme a une dimension et une puissance
incommensurables à ceux de la volonté humaine.
L’archétype du Soi désigne ce dynamisme créateur lui-même en tant
qu’il est à l’oeuvre dans la psyché. C’est donc l’archétype qui régit
dans la psyché le jeu des contraires, tissage de toute vie, et en particulier
le mouvement des autres archétypes. C’est justement pour cette
raison qu’il est souvent impossible de le distinguer des autres archétypes
dans les images ou les figures que les contes mettent en scène.
Ainsi, comme la plus grande partie des contes se terminent par l’union
amoureuse, laquelle, étant une image de l’union des contraires, est en
même temps une image du Soi, la figure d’animus ou d’anima qui est
l’objet du désir et de la recherche est nécessairement une figure d’animus
porteur du Soi ou d’anima porteuse du Soi. Une figure de vieux
sage ou de « vieille femme qui sait » est une figure de père porteur du
Soi ou de mère porteuse du Soi.
Quant aux images de l’archétype du Soi, elles sont innombrables, et
en rapport avec des situations psychiques spécifiques. Les images de la
balle, du cerceau, de l’anneau suggèrent l’aspect de totalité centrée
d’une psyché parvenue à la réalisation d’elle-même, et c’est là justement
ce que désigne le mot « S o i » : la personnalité in-dividuée, indivise,
unifiée. L’image du tapis précieux suggère la subtilité de ce
maître tisserand, l’archétype du Soi, capable d’entrelacer tous les fils de
la vie en un dessin infiniment complexe et pourtant simple et un quand
il s’offre au regard dans son ensemble. Le mandala, sur lequel Jung a
beaucoup écrit, réunit les aspects de totalité centrée et de simplicité
complexe. L’image de l’enfant exprime l’action du Soi comme jaillissement
spontané et renaissance. L’image de l’union amoureuse (on la
retrouve comme fin de l’opus, souvent sous la forme du rebis, dans les
traités alchimiques) est celle qui caractérise le mieux l’action du Soi,
qui oeuvre à et par l’union (non la fusion) des contraires (pleinement
différenciés), assurant ainsi une fécondité sans cesse renouvelée.
L’expérience du Soi est justement la prise de conscience de ce dynamisme créateur qui, né de la tension centrée entre les contraires, unit
leurs énergies dans une oeuvre commune de croissance psychique, c’està-
dire de structuration toujours plus fine et plus forte de la psyché. Mais
l’expression « prise de conscience » est ici mal choisie, elle induit en
erreur. Car il ne s’agit pas, dans ce cas, de la prise de conscience d’un
processus qui existerait par lui-même, d’abord sans relation à la
conscience, et dont on viendrait à prendre conscience. Tout au contraire,
l’attitude de la conscience est ici la condition sine qua non de l’avènement
du processus. Par la reconnaissance de ses limites, c’est-à-dire de
son incapacité à décider en vérité, par sa persévérance dans l’écartèlement
entre les contraires, la conscience, à la fois détachée de ses propres
contenus conscients et refusant d’aliéner sa liberté et son jugement à la
puissance d’un contenu inconscient, s’affirme comme pure présence. A
sa juste place, non agissante mais intensément présente, espérant sans
espérance, attendant contre toute attente, la conscience, par cette tension
centrée entre les contraires qu’elle produit sans le vouloir ni le savoir,
participe intrinsèquement au processus créateur en lequel cette tension
va se résoudre. Par ce dressement d’elle-même au centre des contraires,
forte de sa seule impuissance, la conscience permet au processus de
création de changer de plan, de se continuer au niveau spécifiquement
psychique, par une mutation de la psyché elle-même. Plus que la partenaire
de l’archétype du Soi, la conscience devient alors partie intégrante
de la constellation psychique qui constitue cet archétype.
Tant que ses énergies ne sont pas reliées à la conscience, c’est à
peine si on peut véritablement parler d’un archétype du Soi. Aussi
longtemps en effet que ces énergies restent inconscientes, c’est-à-dire
emprisonnées dans les contradictions de la création charnelle, elles
ont certes la puissance qui est par nature la leur, mais parce qu’elles
sont sans point d’ancrage dans la psyché, elles sont sans orientation,
ag issant tantôt de façon créatrice, tantôt de façon destructrice, et ne
peuvent donc aucunement exprimer leur capacité de création spécifiquement
psychique. C’est-à-dire qu’elles ne peuvent opérer cette
mutation de la psyché que signifie l’émergence du symbole. Cette
émergence du symbole est véritablement l’acte de naissance de l’archétype
du Soi, lequel n’était jusqu’alors qu’une virtualité. De quel
Soi, en effet, parlerait-on si cette finalité rectrice du jeu des opposés
psychiques n’était pas présente à la conscience ? C’est pourquoi nous
appelons Conscience archétypale la conscience dressée au centre des
contraires et partie intégrante de la constellation psychique de l’archétype
du Soi plutôt que reliée à cet archétype.
L’expression « processus d’individuation », employée par Jung, souligne
que la personne entrée dans ce processus devient de plus en plus
une totalité organique, c’est-à-dire un tout différencié, structuré et centré,
ou axé, in-divis, un in-dividu justement. Son sentiment d’identité, fondé
dans la relation entre la conscience et l’archétype du Soi, ne dépend plus
d’un lien extérieur ou de l’appartenance à un groupe, ce qui ne veut pas
dire que cette personne soit sans lien et sans appartenances, et cela ne
veut même pas dire qu’elle ne vive pas elle aussi à travers des projections.
En effet, comme de nouveaux contenus inconscients se trouvent
activés dès que d’autres ont été intégrés — puisque les contenus inconscients
sont la matière du processus d’individuation, lequel n’est jamais
t e r m i n é — et comme tout contenu inconscient activé donne lieu à une
projection sur un objet extérieur, où la conscience entre pour la première
fois en rapport (mais pas en relation) avec ce contenu, cette personne vit
nécessairement elle aussi parmi ses projections. Mais comme l’émergence
du symbole signifie déjà par elle-même le retrait d’une projection
de l’archétype du Soi, ou d’un autre archétype, porteur du Soi (retrait évidemment
partiel, car l’archétype est inépuisable en contenus et en énergie),
la personne en voie d’individuation a déjà l’expérience d’un retrait
de projection, c’est-à-dire de cet élargissement du champ de conscience
qui va de pair avec le retour à la psyché d’un contenu psychique éprouvé
jusque-là comme appartenant à un objet extérieur. C’est pourquoi, avertie
désormais du danger d’emprisonnement dans ses propres projections,
cette personne guette les signes indicateurs de la projection, ces décalages
en général ignorés, négligés ou niés entre l’image qu’on a d’un
objet extérieur et cet objet tel qu’il est réellement. Elle n’adhère plus
aveuglément à ses projections. Déjà fondée intérieurement dans la diff érenciation
entre la conscience et l’archétype, dans la relation ainsi rendue
possible entre ces deux pôles, elle cherche aussi à sortir de la fusion
et de la confusion avec les objets extérieurs, et cela par le retrait des projections,
c’est-à-dire par l’intégration de ses propres contenus psychiques
d’abord projetés sur ces objets. C’est ce mouvement de
d i fférenciation croissante d’avec l’extérieur, par la dissolution de l’inconscience
des contenus psychiques correspondants, que Jung appelle
l’individuation, qu’il conçoit comme une synthèse, une structuration, un
affermissement et une autonomie grandissante de la personnalité.
Ce processus d’individuation, nous l’appelons aussi processus d’incarnation, car il s’agit, par la relation qui s’établit dans la psyché entre
la conscience et l’archétype du Soi, d’une intégration de la dimension
et de l’énergie archétypales dans la création charnelle, laquelle passe ainsi au plan pneumatique et y trouve son accomplissement. Le symbole,
au sens où il a été défini plus haut d’union des contraires, ici
union du charnel et de l’archétypal, est le « lieu » de la création pneumatique. La vie pneumatique est la vie dans le symbole. L’archétypal
n’est pas, par opposition au charnel, « l’esprit ». L’esprit, le pneuma,
c’est au contraire le symbole, c’est-à-dire la création charnelle informée
et transformée par la présence consciente en elle de la dimension
archétypale qui de toute façon l’habite, qu’elle le sache ou non, qu’elle
le veuille ou non. L’esprit n’existe que s’il est incarné. S’il n’est pas
incarné, il n’est qu’énergie égarée et virtualité ignorée. L’esprit naît
quand cette énergie et cette virtualité archétypales se trouvent reliées à
la conscience, à la Conscience archétypale justement, et non à la
conscience ordinaire, toujours plus ou moins asservie à ses propres
contenus. Seule la création pneumatique donne un sens plénier à
l’existence de l’individu. Par la naissance de l’esprit et la naissance à
l’esprit se résout en effet l’opposition création-destruction, indépassable
au plan de la création charnelle, où elle est si souvent ressentie
comme un cruel non-sens.
Enfin nous désignons aussi le processus d’individuation par l’expression
processus d’humanisation. En effet, la tension centrée entre
les opposés psychiques sous le regard de la conscience, d’où naît le
processus d’individuation, implique la prise en considération du
contenu inconscient, une attitude au moins d’ouverture à son égard,
c’est-à-dire une prise en considération de l’autre. L’expérience du Soi
consistant en l’établissement de la relation entre les deux pôles psychiques
différenciés et interdépendants que sont la conscience et l’archétype
du Soi, il s’ensuit que le processus d’individuation implique
la pleine reconnaissance, par la personnalité consciente, de l’autre
dans sa propre psyché. Cette reconnaissance de l’autre à l’intérieur est
inséparable de la reconnaissance de l’autre à l’extérieur, puisque le
retrait de la projection différencie ce qui appartient à l’intérieur de ce
qui appartient à l’extérieur, comme elle différencie, à l’intérieur, la
conscience et l’archétype [7]. Or, la reconnaissance de l’autre dans sa
réalité propre permet seule d’entrer avec lui dans ce rapport juste qui
est la relation, puisque tout autre rapport, positif ou négatif, étant de
nature projectionnelle et donc fusionnelle, n’est en réalité qu’un rapport à soi-même, dans lequel autrui se trouve instrumentalisé au lieu
d’être reconnu en lui-même et pour lui-même. Ainsi, le processus
d’individuation, qui requiert la reconnaissance de l’autre et qui, là où
il n’y avait que du lien (positif ou négatif), établit la relation, est-il la
voie de l’humanisation de l’être humain. Et de même que nous désignons
ce processus aussi par l’expression « processus d’incarnation de
l’archétype du Soi », qui va de pair avec la pensée de la création pneumatique,
de même nous le désignons également par l’expression
« processus d’humanisation », qui va de pair avec la pensée de la création éthique.
Cette pensée de la création éthique est le prodrome et même déjà le
commencement d’une véritable mutation de la psyché. Il ne s’agit de
rien moins en effet que de l’acquisition d’un instinct éthique, d’un instinct
de responsabilité éthique. Bien sûr, ce n’est au départ qu’une
semence, mais c’est une semence puissante, qui germe et grandit et ne
se laisse pas étouffer. Cependant, le mot « éthique » n’est pas entendu
ici dans son acception habituelle. Si nous reprenons les exemples littéraires
cités plus haut, on ne saurait dire ni de Werther ni de la princesse
de Clèves qu’ils manquent de sens moral. Si madame de Clèves résiste
à son amour, ce n’est pas, ou en tout cas pas seulement, par un respect
conventionnel des règles établies, car elle obéit à un idéal de droiture
et de cohérence avec elle-même. Quant à Werther, toute sa personnalité
est d’une grande élévation morale, et c’est finalement parce qu’il
ne supporte pas de voir son amour dégradé en désir de meurtre qu’il se
tue lui-même. Et pourtant, aussi bien Werther que madame de Clèves
manquent de responsabilité éthique au sens où nous l’entendons.
Madame de Clèves en effet condamne à mort une partie d’elle-même,
la partie la plus vivante d’elle-même, et finalement se condamne à un
étiolement qui est un véritable meurtre psychique. Et Werther, qui
refuse ce meurtre psychique en refusant de se résigner, manque de la
force nécessaire pour soutenir la contradiction entre un amour véritablement
aimant et un amour devenu meurtrier. Son amour reste dans
l’indifférenciation du passionnel, et par son suicide, il devient le jouet
de cette contradiction insoluble au plan de la création charnelle.
Goethe au contraire, qui en créant le personnage de Werther se
sépare en lui-même de l’attitude werthérienne, se tient au centre de la
contradiction, et c’est justement de cette tension que naît le dynamisme
de l’écriture du roman, qui signifie l’entrée de l’écrivain dans le processus
d’individuation et prépare l’avènement en lui du symbole.
L’attitude de Goethe dans la crise existentielle qui est celle de Werther rend sensible la responsabilité éthique au sens où nous l’entendons,
dont la portée est ontologique. La responsabilité éthique, en effet, ne
consiste pas à être fidèle à un impératif moral — ce qui ne signifie surtout
pas une dévalorisation de l’impératif moral, car une forte distinction
du bien et du mal et un degré élevé de conscience morale sont
indispensables à une forte tension entre les opposés psychiques et donc
à l’émergence du symbole. La responsabilité éthique consiste à prendre
en considération extrême les catégories du bien et du mal sans pour
autant les faire coïncider entièrement avec les contenus des opposés
psychiques. C’est-à-dire qu’elle consiste précisément pour la conscience
à envisager l’ensemble de la situation psychique, et, ce qui va beaucoup
plus loin, à prendre en charge, par la reconnaissance de son impuissance
à décider avec justesse et équité, la psyché tout entière, la totalité de
l’être. La Conscience archétypale qui en résulte devient par là un appel
qui s’ignore lui-même, mais dont l’intensité augmente avec la tension
dont elle est le centre, et l’émergence du symbole est à la fois résolution
de la tension et réponse à cet appel. Le symbole est la réponse de la vie
elle-même à ces contradictions qui sont, en effet, une impasse où, prisonnières
de la création charnelle, ses énergies s’épuisent. Le processus
créateur ne peut, à ce plan, que se répéter et produire des variantes du
même. Seule la Conscience archétypale lui permet de passer au plan où
il manifestera à nouveau sa puissance de mutation, c’est-à-dire sa puissance
proprement créatrice. Et cette mutation est justement l’apparition
d’une psyché humaine spontanément et fondamentalement éthique,
éthique par instinct, et non plus déchirée entre exigences morales et
désirs, convoitises ou peurs et lâchetés.
Nous appelons création continuée cette mutation de la création
charnelle en création pneumatique et éthique. L’être humain qui, jusqu’à
cette mutation psychique, reste le produit de forces qui le laissent,
malgré tous les progrès culturels, fondamentalement semblable à luimême,
une juxtaposition et une opposition de culture et de nature
brute, joue ici au contraire, par la qualité ontologique de la Conscience
archétypale, un rôle essentiel dans le processus de création lui-même.
La Conscience archétypale, dans un non-agir absolu, par la seule présence
d’un regard au centre, est la cheville ouvrière de l’accomplissement
de la nature dans la psyché humaine. C’est là le mouvement
véritablement civilisateur (et non plus seulement culturel), qui, par sa
dimension ontologique, met un terme à la séparation entre nature et
conscience : il réintègre la conscience, à la place à la fois modeste et
immense qui est la sienne, dans le jeu des énergies de la nature. Avant cette mutation, la conscience, au mieux, est réflexive, c’est-à-dire
qu’elle confère à celui qui l’exerce une lucidité impuissante à transformer
ce qu’elle éclaire. C’est en ce sens que l’on emploie habituellement
l’expression « être conscient de… » La Conscience archétypale
ne renie pas cette lucidité. Mais elle est tout autre chose : une présence
au centre des contradictions, dans cette faille de l’humain que tout
choix de l’un ou l’autre des contraires ne ferait qu’ignorer ou nier. Elle
veille dans cette faille.
Un grand nombre de contes ont leur point de départ dans une crise
existentielle qui semble ne jamais pouvoir être résolue, tant ce qui est
déclaré nécessaire à sa résolution paraît hors d’atteinte. Et pourtant le
jeune prince (par exemple) se met en chemin vers l’inaccessible. Il en
va de même de la Conscience archétypale, qui attend l’inespéré. Et
l’inaccessible est atteint, l’inespéré advient : c’est l’expérience du Soi,
l’émergence du symbole.
Jung parle souvent de « l’unilatéralité de la figure du Christ » dans
les différentes confessions chrétiennes. Alors que le supplice de la
croix, image de la présence au centre dans l’écartèlement des
contraires, fait de cette figure une image de l’archétype du Soi, l’aspect
sombre, explique-t-il, en a été totalement effacé au profit de l’aspect
lumineux, tout de pureté, sans aucune trace d’obscurité ni de mal,
ce qui a pour conséquence de rejeter le mal hors de l’archétype du Soi
et de le considérer uniquement comme devant être combattu et vaincu
avec l’aide de la grâce divine. C’est ce que Jung, en référence à la
conception trinitaire de la divinité, Père, Fils et Esprit saint, désigne
comme l’exclusion du quatrième, c’est-à-dire de Satan, qui s’appelle
pourtant aussi Lucifer, le porteur de lumière, nom qui semble bien
l’associer à l’oeuvre de conscience.
Si l’on tente de traduire en termes psychologiques ces notions théologiques,
on pourrait dire qu’il y a au départ une totalité indifférenciée,
un état psychique de masse confuse, où tout est mêlé à tout. Puis la
conscience distingue des opposés psychiques, et la Conscience archétypale
se tient entre eux, les différenciant fortement et concentrant leur
tension. Enfin, le symbole rétablit la totalité, mais une totalité organique,
une unité structurée, où la transformation des contraires, c’està-
dire leur juste différenciation, met un terme à leur opposition
irréconciliable et permet leur conjonction dans l’oeuvre commune de la création pneumatique. Comme le symbole ne saurait naître sans la tension
centrée entre un pôle clair et un pôle obscur, qui est déjà une mise
en relation, il s’ensuit que la structure de l’archétype du Soi, du moins
si on la considère du point de vue de sa dynamique interne, est quaternaire (Voir schéma N° 1, plus bas). Aussi peut-on parler d’une quaternité énergétique. L’expression
ne se trouve pas chez Jung, mais ne fait que rendre sa pensée.
C’est-à-dire que l’archétype du Soi ne peut manifester sa puissance de
création pneumatique que si le quatrième, le pôle obscur, effrayant,
ressenti comme le mal, est inclus dans l’expérience intérieure à égalité
avec le pôle lumineux. Si, au contraire, l’expérience intérieure tente de
le réduire ou requiert son extinction, sa quasi-élimination, alors elle
perd sa fécondité, la psyché en détresse se trouvant paralysée, et c’est
cette détresse d’une psyché devenue stérile que traduit, selon Jung, la
figure du Roi Pêcheur dans la légende du Graal.
Avec le « quatrième » s’est trouvé exclu de l’expérience intérieure tout ce que la doctrine chrétienne a longtemps considéré comme plus particulièrement lié au mal, comme plus particulièrement marqué par le péché originel : le corps, la chair, l’éros, le féminin, et finalement la « nature » humaine. Jung voit dans l’apparition, en Occident, au XIIe siècle, de l’alchimie et de la légende du Graal (on peut ajouter la poésie courtoise), la naissance d’un mouvement non seulement complémentaire, mais compensateur de l’unilatéralité lumineuse du christianisme, et qui vise à réintroduire dans l’expérience intérieure ce que cette unilatéralité en exclut. Les contes, qui viennent de plus loin, lui semblent participer du même mouvement compensateur. Et, en effet, si dans l’alchimie les images de l’union amoureuse sont fréquentes (le Rosarium philosophicum commenté par Jung dans La Psychologie du transfert consiste même en une série de telles images), si dans Le Conte du Graal de Chrétien de Troyes, dans toutes ses Continuations et dans le Parzifal de Wolfram von Eschenbach, le thème de l’union amoureuse est fondamental, ce thème est, dans presque tous les contes qui ne se rapportent pas exclusivement à de tout jeunes enfants, plus que fondamental : c’est le thème unique. L’union amoureuse est le seul thème de tous les contes merveilleux, dans la mesure où tous les autres thèmes n’apparaissent qu’en fonction de celui-ci, car le désir amoureux y est justement le porteur du processus d’individuation, et tout se subordonne organiquement à cette finalité.
Il est intéressant de s’arrêter sur la présence fréquente, dans les
contes, du chiffre trois. En particulier, les épreuves qu’il faut affronter
pour accéder à l’union amoureuse sont toujours au nombre de trois, et
ce trois est en relation avec le rythme ternaire du processus d’individuation 1. Si, en effet, la dynamique interne de ce processus peut se décrire comme une quaternité énergétique, le processus lui-même se
déroule en trois temps, celui de l’unité indifférenciée, de la dualité de
relation, et de l’unité différenciée. Il n’est donc pas surprenant que les
épreuves qui rythment le récit soient au nombre de trois. Cela ne signifie
évidemment pas que chacune d’elles corresponde à un des trois
temps qui viennent d’être caractérisés. Quand le conte commence, le
premier temps, celui de l’unité ou de la totalité indifférenciées, est déjà
terminé ou sur le point de se terminer. La psyché a déjà pris conscience
du manque, de la stérilité, du malaise, et la décision d’y remédier à
quelque prix que ce soit est prise dès les toutes premières lignes. En
outre, le chiffre trois est le nouveau qui naît de l’union des opposés,
comme l’enfant naît de l’union des parents. Il est donc par excellence
le chiffre dynamique et créateur. C’est pour cette raison sans doute qu’il
n’apparaît pas seulement en relation avec les épreuves, mais également
avec des personnes, des animaux, des objets : les trois frères, les trois
corneilles, les trois corbeaux, les trois plumes. Même si cela n’est pas
d’abord évident, il serait possible d’établir, dans chaque cas, un rapport
avec le mouvement qui porte le conte.
Bien qu’il s’agisse toujours de trois épreuves, présentées comme
trois, il n’est pas rare qu’il y en ait, en fait, une quatrième (par exemple
dans Les Trois Plumes ou dans L’Oiseau d’or). De façon remarquable
cependant, cette quatrième épreuve a lieu quand tout semble déjà gagné,
dans les contes qui parlent aussi du retour à l’endroit d’où l’on est parti.
Le conte souligne alors la difficulté de l’inscription dans la réalité
concrète d’un accomplissement intérieur déjà présent, mais qui pourrait
être perdu à cause d’une faiblesse de la personnalité consciente, d’une
trop grande naïveté souvent. Le triomphe dans la quatrième épreuve
signifie alors l’incarnation réalisée, le quatre étant synonyme de l’assise
solide du carré. Il en va de même pour certains contes qui se terminent
par un double mariage. La quaternité donne ici à sentir la fermeté du fondement
établi en même temps que sa structuration très différenciée .
C’est dans l’alchimie, dans cette projection du travail d’individuation
sur la matière, dans cette pensée toute en images, que Jung a trouvé la forme historique la plus aboutie de sa propre expérience individuante,
qu’il formulait dans un langage non plus imagé, mais
conceptuel. Ses études des traités alchimiques lui ont permis à la fois
de s’ancrer dans le passé, d’éclairer l’alchimie par sa propre pensée et
d’en être éclairé en retour. Jung s’est reconnu dans l’alchimie, il est
tout entier un alchimiste, selon une modalité nouvelle évidemment,
mais totalement et exclusivement un alchimiste. Or, le maître mot, le
mot-clé de l’alchimie est celui de transformation, ou plutôt de transmutation,
terme qui traduit parfaitement ce saut qualitatif de l’émergence
du symbole, ce passage que l’on peut vivre, mais qu’on ne peut
jamais ni provoquer, ni calculer, ni expliquer causalement, du plan de
la création charnelle au plan de la création pneumatique, et qui reste
donc l’expérience d’un mystère de la psyché.
Comme l’alchimie, et dans la même opposition que l’alchimie à l’unilatéralité
lumineuse de la doctrine chrétienne, Jung considère, ainsi que
nous l’avons déjà indiqué au début de cette introduction quand il a été
question de l’ombre, tout le mal comme transformable. Tout le mal est
inclus dans ce « quatrième » que la doctrine chrétienne au contraire
exclut de la participation à la fécondité pneumatique, puisque l’expérience
intérieure se constitue contre lui. L’alchimie et Jung inversent
donc la doctrine chrétienne en réintégrant le mal dans la dynamique de
l’expérience intérieure, mais, comme la doctrine chrétienne, l’alchimie
et Jung considèrent le mal comme un dans sa nature. Jung, ainsi que
nous l’avons vu plus haut, parle bien, ici ou là, d’un mal absolu, mais
sans jamais préciser en quoi ce mal absolu consiste. Marie-Louise von
Franz, dans son commentaire de l’Aurora consurgens, fait une brève
allusion à un mal intransformable. Il s’agit d’une note de bas de page
dans le chapitre qui se rapporte à la première parabole du texte de
l ’Aurora. Dans ce texte, la Sagesse met l’alchimiste en garde : s’il abandonne
sa loi et ne marche pas dans ses voies, il ne pourra mener l’opus
à terme. Il sera saisi par « le froid de la neige » qui, explique Marie-
Louise von Franz, est chez les Pères de l’Église « un symbole de la damnation
éternelle ». « Le diable, ajoute-t-elle, principe du mal, principe
destructeur qui menace l’individuation, envahirait donc l’opus. » C’est
ici que se place la note : « Il s’agit sans doute, écrit Marie-Louise von
Franz, de ce mal ultime que l’homme ne peut pas intégrer, et non de
“l’ombre inférieure”, de “l’Éthiopien”, le mal qui peut être intégré. »
Mais Marie-Louise von Franz ne s’étend pas davantage et ne précise pas
en quoi consisterait ce « mal ultime ». Elle reste en cela tout à fait « jungienne
». Ainsi, bien que l’on perçoive, tant chez Jung que chez Marie-Louise von Franz, un pressentiment de l’insuffisance de leur pensée et
un effort tâtonnant pour aller plus loin, ils restent finalement prisonniers
de cette image de l’ombre par laquelle ils appréhendent le mal.
Les conceptions chrétienne et alchimique du mal, qui ont en commun
de le considérer comme un, mais qui sont par ailleurs totalement opposées
puisque l’une l’exclut de la dynamique de la fécondité pneumatique
alors que l’autre l’y inclut, impliquent nécessairement deux visions totalement
opposées de la finalité de l’expérience intérieure. La conception
chrétienne vise, même si elle n’espère pas la réaliser jamais, la perfection,
voire la pureté. La conception alchimique vise une totalité centrée
qui se structure par le jeu des contraires, et dont la structuration n’est évidemment
jamais achevée. Tout ce qui sépare la conception chrétienne et
la conception alchimique du mal et de l’expérience intérieure se ramène
à ce point fondamental du jeu des contraires au sein de la psyché.
La pensée de la double nature du mal qui, à côté du mal transformable,
reconnaît l’existence d’un mal radical, intransformable, pose en
particulier la question de savoir comment le mal radical, d’un point de
vue énergétique, se situe par rapport au jeu des contraires et d’où il tire
les énergies dont il dispose.
Quand on lit un grand nombre de contes merveilleux, une distinction
finit par s’imposer du point de vue du mal. Si, laissant provisoirement
de côté les contes qui mettent en scène de tout jeunes enfants (jusqu’à
l’âge de dix ans environ), on s’attache à ceux qui mettent en scène un
jeune homme ou une jeune fille et qui finissent, pour l’immense majorité
d’entre eux, par l’union amoureuse, on s’aperçoit que dans certains
de ces récits la réalisation de l’union amoureuse requiert uniquement
que soient surmontées plusieurs épreuves (en général, trois ou, comme
nous l’avons vu, parfois quatre), alors que dans d’autres récits la disparition
et en général la mort violente, voire le terrible supplice de l’une
des figures du conte est le préalable indispensable soit à la réalisation
de l’union amoureuse, soit à son rétablissement quand, ayant été réalisée
dans un premier temps, elle s’est ensuite profondément dégradée.
Les figures dont l’élimination semble indispensable à la réalisation ou
au rétablissement de l’union amoureuse sont toujours celles qui poursuivent
d’un acharnement sans mesure le jeune homme ou la jeune fille,
et qui par la mort ou par la torture tant physique que morale veulent sa
destruction et celle de son désir. Or, de telles figures n’ont pas d’équivalent dans les premiers récits, ceux où l’union amoureuse ne requiert
que de triompher dans les épreuves imposées. Il ne s’agit donc pas
d’une disposition d’esprit plus ou moins cruelle qui s’exprimerait dans
certains contes et qui serait absente dans d’autres, mais d’une différe nce
de fond quant à la nature des obstacles auxquels se heurte le désir du
jeune homme ou de la jeune fille. C’est en prenant conscience de cette
différence qu’il nous est venu à l’esprit d’appliquer aux contes merveilleux
la pensée de la double nature du mal.
Ce qui nous a également paru très frappant, c’est que ces figures de
l’acharnement destructeur ont toujours forme humaine, même quand il
s’agit du diable ou d’un géant. Elles peuvent certes changer leur aspect
pour accomplir leurs noirs desseins, comme la reine-sorcière de Blanche-
Neige, qui se transforme en vieille femme, mais il s’agit encore d’un
aspect humain. Jamais, à notre connaissance, elles ne prennent forme
animale ni végétale, alors que toutes les autres figures des contes peuvent
prendre forme animale (rarement végétale) soit pour réussir une épreuve
imposée, soit pour échapper à un danger, soit parce qu’elles sont ensorcelées.
Ceci nous semble indiquer que les contes les ressentent comme
ne ressortissant pas à l’ordre de la nature, ce qui s’accorde bien à la
nécessité de leur élimination pour la réalisation de l’union amoureuse.
La métamorphose la plus intéressante pour notre propos est celle de
l’animal (grenouille, crapaud, renard, serpent, mixte d’animal et
d’homme) en être humain. Cette métamorphose peut intervenir dans les
deux types de récits, mais elle est plus fréquente dans ceux du premier
type, c’est-à-dire dans les récits d’où toute figure de l’acharnement est
absente et qui progressent par intégrations successives de contenus
inconscients. Le caractère inconscient se marque de diverses manières,
soit par l’inaccessibilité d’une figure, soit par son caractère animal
quoique bienveillant, soit par son aspect inquiétant, son attitude hostile
ou destructrice. L’établissement du lien avec le porteur de la conscience
a lieu selon diverses modalités, qui vont de l’amitié à la confrontation
violente. La métamorphose de l’animal en être humain, dont il vient
d’être question, n’est qu’une façon parmi d’autres de dire la transformation
du contenu inconscient par son entrée en relation avec le porteur
de la conscience. Les énergies liées à ces contenus jusque-là
autonomes rejoignent le mouvement qui porte le conte, et qui trouve
son terme dans l’union amoureuse entre un conscient plus souple, plus
ferme, plus vaste et la figure d’anima (ou d’animus) devenue accessible.
C’est-à-dire que le mouvement mène à l’établissement de la totalité
psychique et à l’expérience de sa fécondité (« Ils eurent beaucoup d’enfants »). De tels récits sont autant de variantes du processus d’individuation
tel que Jung le décrit. Sa pensée du jeu des contraires, et
donc du mal transformable, les éclaire de façon remarquable aussi bien
dans le détail que dans leur dynamique et leur structure.
Il n’en va pas de même pour les récits où apparaît une figure de
l’acharnement destructeur. Non seulement cette figure elle-même ne se
transforme jamais et doit être éliminée à la fin, mais toute transformation
dépend de sa mise en échec momentanée, et n’est véritablement acquise
que lors de son élimination définitive. De façon significative, les métamorphoses
d’un animal en être humain sont rares dans ces récits, où la
libération est la condition de la transformation, et où tout se joue beaucoup
plus entre des figures humaines ou d’apparence humaine. La pensée
de l’existence d’un mal radical, intransformable, et l’appréhension de
la nature de ce mal permettent de saisir la spécificité de ces contes, d’unir
leurs caractères particuliers en une vision d’ensemble, de comprendre
comment ils s’articulent aux contes du premier type — et de mesurer
ainsi la profondeur de la science du mal dans les contes merveilleux.
Si l’on écarte la définition du mal moral comme péché, comme
offense à la sainteté divine, on peut le définir de façon très générale
comme l’acte — ou l’omission — qui porte atteinte à autrui, qui viole
ou néglige ses droits en tant que personne. Mais il y a deux modalités de
cette insensibilité à la personne de l’autre. Dans l’une de ces modalités,
autrui est traité comme un simple instrument de la satisfaction d’intérêts,
de convoitises, de pulsions, de désirs, ou comme un obstacle à leur
satisfaction. Dans la seconde de ces modalités, même si autrui peut également
se trouver instrumentalisé en vue de quelque satisfaction, l’enjeu
est fondamentalement d’un autre ordre. Il s’agit d’un enjeu identitaire.
Autrui est nié en tant qu’il est autre, et, là encore, selon deux modalités
différentes. Ou bien autrui est ressenti comme le différent, l’étranger,
celui qui ne participe pas du même — de la même famille, tribu, nation,
race, religion, communauté en général, et finalement pas de la même
humanité — et se trouve alors exclu en tant qu’il est différent. Ou bien,
inversement, autrui est tellement considéré comme inclus — dans la
famille, tribu etc. — que le terme « autrui » perd tout son sens, car il n’y
a que du même, seul le groupe existe, et aucun « autre » n’est toléré,
aucune altérité n’est même concevable. Chacun n’est reconnu qu’en tant
qu’il est participant de l’identité du groupe. Les deux modalités sont comme l’avers et l’envers d’une même médaille, qui est l’identité. Il
s’agit d’une identité grégaire, signe de l’inexistence ou de l’extrême faiblesse
de l’identité individuelle. L’identité grégaire protège du risque
qu’il y aurait à devenir un individu, elle berce chacun dans l’inconscience
de lui-même, dans l’indifférenciation et dans l’irresponsabilité.
L’identité grégaire est de la masse humaine sans visage, mue par une
énergie unique, née de toutes les énergies que chacun renonce ou se
refuse à assumer. Elle ne se constitue et ne se maintient que par un resserrement
sur elle-même qui, à la fois, la démarque de l’autre à l’extérieur, et étouffe toute velléité d’altérité à l’intérieur.
Le même et l’autre ne sont pas seulement ici des opposés psychiques.
Ils sont des êtres humains concrètement réels, vivants. Et puisque le
même, le connu, se trouve (dans l’immense majorité des cas) assimilé au
Bien, tandis que l’autre, l’étranger, se trouve assimilé au Mal, ce sont des
êtres humains qui sont ainsi désignés (et d’ailleurs autodésignés) comme
porteurs du Bien, et des êtres humains aussi qui se trouvent ressentis et
désignés comme porteurs du Mal. Et ceux-ci étant par définition en position
d’isolement ou d’infériorité (numérique, économique, politique),
donc de faiblesse, leur sort dépend finalement en grande partie des aléas
du sentiment collectif d’identité des représentants du même.
Le même et l’autre sont un des couples de contraires dont se tisse la
réalité. Un certain degré d’adhérence du même au même, et donc d’insensibilité
à l’autre en tant qu’Autre existe nécessairement, comme,
tout aussi nécessairement, la demande de reconnaissance de l’autre, sa
rancune ou sa révolte. Mais cette adhérence et cette insensibilité ont
ceci de particulier qu’elles peuvent être très fortes sans se manifester
par des actes clairement repérables, même par celui qui les commet, et
donc coexister avec une parfaite bonne conscience et une honorabilité
irréprochable. Un profond mépris de l’autre en tant qu’Autre peut très
bien, aussi longtemps que cet autre reste à la bonne distance ou aussi
longtemps qu’il n’y a pas de crise de l’identité collective, ne se traduire
que par quelques jugements sans conséquences concrètes, par de
simples regards, par des réactions infimes qui, dans le milieu où elles
se produisent, paraissent toutes naturelles. C’est seulement quand
l’autre vient trop près, ou quand une crise générale menace l’identité
collective, que cette insensibilité et ce rejet se traduisent par des actes,
par un mal effectif—il n’y a de mal qu’effectif, le fantasme d’un acte
mauvais incline au mal, mais il n’est pas encore du mal — et que se
pose la question de la responsabilité morale, car l’acte offre la possibilité
de la prise de conscience. Dans une telle situation, la fermeture à l’autre en tant qu’Autre, l’indifférence, le mépris ou la répugnance à
son égard peuvent s’exacerber en répulsion et en haine actives. L’autre
se trouve non seulement ressenti mais désigné publiquement comme
LE porteur du Mal, et alors se met en place le processus désormais
bien repéré et bien étudié du sacrifice de la victime émissaire.
Or, bien que de tels crimes soient communément qualifiés de barbares
— ne parle-t-on pas sans cesse de la barbarie nazie ?— ces processus
sacrificiels ne sont absolument pas en continuité avec les
processus sacrificiels des temps que nous nommerons barbares. Alors,
en effet le sacrifice humain — car c’est bien de cela qu’il s’agit — le
sacrifice d’offrande à la divinité (celui, par exemple, du fils premier-né)
ou d’une victime déclarée porteuse des souillures de la communauté,
était l’acte principal d’un culte organisé à un niveau de
conscience antérieur à l’émergence de la personne, et qui était donc de
nature magique. Le rite magique, « barbare » aux deux sens du terme,
est en effet le seul mode de rapport entre une identité collective et la
divinité correspondante, origine de cette identité, source de tout bien et
de tout mal, et donc, nécessairement, idole.
La fin (évidemment très progressive) des temps barbares, au sens où
nous entendons l’expression, est marquée symboliquement par ce que
nous appelons l’expérience fondatrice — fondatrice de l’humain en
l’homme. De cette expérience témoignent, dans l’héritage judéo-chrétien,
un récit du livre de la Genèse, placé au début de l’Ancien
Testament, et dans l’héritage grec, le mythe de Tantale. Bien que l’on
parle toujours du récit du sacrifice d’Isaac, il s’agit au contraire du non-sacrifice
d’Isaac, auquel Dieu substitue un bélier. Dans le mythe grec,
Tantale est puni par les dieux pour leur avoir offert en festin la chair de
son fils Pélops : les dieux horrifiés ressuscitent l’enfant. Les deux histoires
marquent la rupture que signifie, à travers le refus du sacrifice de
l’enfant, l’émergence du sentiment de la personne, avec tout ce qu’implique
une telle prise de conscience, saut qualitatif au sein de la psyché,
par lequel se trouve posé le fondement de l’humain en l’homme [8]. C’est,
au plan des principes évidemment (mais l’affirmation du principe est le
premier temps de sa réalisation), la fin de l’indifférenciation dans le sein
de l’identité collective et donc le début de la responsabilité individuelle.
Les notions du bien et du mal se dégagent de ce qui est bon ou mauvais pour la communauté, celle de faute, ou du moins de péché, se substitue
à celle de la souillure et le transfert magique du mal sur une victime
émissaire humaine devient impossible au niveau du rite, c’est-à-dire au
niveau de la conscience. La perception de la divinité change, elle cesse
d’être une idole, et le rapport magique à la divinité se trouve condamné
au profit de la relation. Le sacrifice — le sacrifice humain— ne peut plus
être organisé au plan de la conscience, et l’énergie psychique, qui par ce
sacrifice ne cessait de se réengloutir toujours à nouveau dans son origine,
se libère et s’oriente vers un devenir. Le temps s’ouvre et c’est cela aussi
que signifie le refus du sacrifice de l’enfant. Par ce refus, l’humanité
entre dans son histoire, qui est avant tout celle de l’immense travail de
conscience qu’elle s’est assignée à elle-même : un travail d’humanisation,
qui est un travail d’individuation, inscrit dans l’expérience fondatrice,
mais dont elle ne fait que poser le principe. L’incarnation de ce
principe d’individuation est infiniment lente et ses reculs sont souvent
plus importants que ses avancées. On a souvent l’impression que l’épopée
de l’humanisation, après plusieurs millénaires, en est encore à son
commencement, et qu’elle est menacée d’anéantissement.
L’expérience fondatrice marque pourtant un point de non-retour, et
c’est pourquoi nous avons parlé de saut qualitatif. Le sacrifice humain
persiste, certes, mais il ne peut plus se perpétuer tel qu’il était. Banni
du culte reconnu de la divinité, le sacrifice humain postérieur à l’expérience
fondatrice n’est plus celui des temps barbares, et ne peut le
redevenir. Il n’est pas une régression barbare, mais le refus absolu de
l’expérience fondatrice, pure négation de l’avènement de la
conscience, c’est-à-dire de l’humain en l’homme, et donc inversion du
mouvement vers l’humanisation [9].
Contraint de s’organiser à partir de l’inconscient, le sacrifice change
de nature : il devient la consécration que la psyché fait d’elle-même à
l’indifférenciation, ce qui constitue précisément le mal radical. Le sacrifice
reste un acte magique, dont la finalité est la réaffirmation et le renforcement
du sentiment d’identité collective, à cette différence près
qu’il ne se produit plus que dans les situations où cette identité se sent
menacée. Mais comme ceux qui participent au sacrifice ont dépassé le
niveau de conscience qui permettait de l’accomplir comme un acte
allant de soi, dont la cruauté même était innocente, ils ne peuvent agir
que s’ils s’abusent eux-mêmes sur ce qu’ils sont en train de faire, c’est-à-dire sur l’immolation d’un être humain, un être humain que seule son
altérité désigne comme victime, à la volonté d’adhérence du même au
même qui est celle de l’identité collective. C’est cet état d’esprit
empreint de mauvaise foi que nous appelons volonté sacrificielle ou
volonté d’inconscience, d’indifférenciation et d’irresponsabilité. Cette
volonté ne peut se réaliser que si elle intègre mensongèrement les
acquis de la conscience, de sorte que ceux qui l’accomplissent se sentent
pleinement justifiés. Cette intégration mensongère, que nous allons
décrire, est une imposture inhérente à la volonté sacrificielle, c’est-à-dire
au processus sacrificiel postérieur à l’expérience fondatrice. Ce
n’est pas une imposture volontaire (même si certains hommes politiques
peuvent jouer cyniquement du sacrifice pour augmenter leur
pouvoir), car la lucidité dissoudrait la volonté sacrificielle, dont la violence
tient justement au fait qu’elle se contracte convulsivement sur son
inconscience. L’imposture n’est pas ici un vêtement dont se couvrirait
la volonté sacrificielle, elle est le sentiment impudent et la haute opinion
que cette volonté a d’elle-même, la façon dont elle s’éprouve chez
ceux qui en sont les instruments dociles ou les agents zélés.
Il s’agit, si l’on peut ainsi s’exprimer, d’une imposture du Bien. Car
la volonté sacrificielle est le spasme paroxystique de l’adhérence du
même au même. Elle porte à son comble, elle porte à l’absolu l’insensibilité
à l’autre en tant qu’Autre, analysée un peu plus haut. C’est-àdire
qu’elle porte à l’absolu l’identification du même au Bien et de
l’Autre au Mal, mais le Bien et le Mal, le Même et l’Autre ne sont pas
ici simplement des catégories de la pensée. Ce qui se trouve porté à
l’absolu, c’est la coïncidence avec le Bien du porteur concret du
Même, et la coïncidence avec le Mal du porteur concret de l’Autre. Ce
sont des êtres vivants, c’est le réel vivant, tissage de contraires, dont la
structure même se trouve ainsi déchirée. Peu importe de quelle façon
le Bien absolu et le Mal absolu sont définis. Ce Bien peut être celui de
la morale commune ou au contraire, comme dans le nazisme, prendre
le contre-pied de la morale commune, selon le fameux « renversement
des valeurs ». Quand il ne correspond pas à celui de la morale commune,
ce Bien absolu apparaît sous la forme de la Pureté absolue, qui
peut être d’origine ethnique ou d’ordre idéologique, religieux et donc
traditionnel, ou au contraire révolutionnaire aussi bien d’ailleurs que
contre-révolutionnaire. Ceux que nous appellerons désormais les sacrificateurs
se sentent au service du Bien et s’éprouvent comme des justiciers,
ou au service de la Pureté, et ils s’éprouvent alors comme les
purificateurs et les régénérateurs de l’humanité.
C’est donc sous l’étendard de cette imposture de conscience, toujours
théâtralement mise en scène, pour en imposer justement, que le processus
sacrificiel se déclenche et que la volonté sacrificielle se réalise dans
le crime commis sur l’autre en tant qu’Autre — qui est en même temps
le pire et le plus dangereux attentat contre la conscience, dont tous les
acquis se trouvent ainsi vidés de leur substance et réduits à des simulacres.
Mais par là, le sacrifice d’après l’expérience fondatrice perd
entièrement l’innocence qui est la marque du sacrifice barbare. Le sacrifice
devient un meurtre sacrificiel mensongèrement transfiguré en acte
de conscience. Sa finalité de renforcement de l’identité collective par
l’adhérence absolue du même au même se révèle par là être une finalité
de perversion du mouvement vers la conscience, vers l’individuation et
donc vers l’humanisation de l’être humain. La volonté sacrificielle est
une volonté de perversion de la poussée civilisatrice (au sens le plus profond
et le plus fort de ce mot). Le sacrifice déniant l’expérience fondatrice
n’est pas un sacrifice barbare, c’est un sacrifice pervers, qui scelle
dans le sang et l’avilissement, par le mensonge le plus perfide et le plus
fondamental, le refus de la conscience, la volonté d’anéantissement de
l’humain en l’homme. Par ce sacrifice pervers, l’insensibilité à l’autre en
tant qu’Autre franchit un seuil, franchissement par lequel s’opère un
changement de nature, une véritable mutation. De mal transformable
qu’elle était encore avant le sacrifice, participant au jeu des contraires en
tant que négatif d’un positif — puisque l’identité, comme toute chose,
est un jeu de contraires — elle devient intrinsèquement refus de la
conscience, et par là mal intransformable : elle devient mal radical. C’est
ce « saut qualitatif » inverse de celui de l’expérience fondatrice que la
description psychique du processus permet de mieux appréhender.
Comme rien ne peut subsister en dehors de l’absolu, et comme il ne
peut y avoir deux absolus, l’absolutisation des contraires implique la
disparition de l’un d’eux. (Ainsi l’absolutisation du Bien a-t-elle pu
conduire à définir le mal comme privatio boni, ce qui revient à le
déréaliser). Or, la volonté sacrificielle non seulement absolutise le
Bien et le Mal, non seulement assimile le Même au Bien et l’Autre au
Mal, non seulement fait coïncider ces contraires, ainsi que nous
l’avons vu plus haut, avec les êtres humains concrets qu’elle désigne
comme leurs porteurs, ce qui implique l’élimination du porteur de
l’Autre, mais son acharnement destructeur contre l’Autre a un caractère
spécifique. La volonté sacrificielle en effet n’est pas dirigée contre
un ennemi, même pas contre un ennemi ressenti comme l’Autre, à
détruire donc par tous les moyens. Elle est dirigée contre une victime, en position de faiblesse et que cette position de faiblesse a justement
désignée comme victime. S’il y a un ennemi, il y a lutte, et quel que
soit des deux côtés l’acharnement contre l’autre en tant qu’Autre, il y
a nécessairement prise en considération de cet autre. C’est toujours le
jeu des contraires, qui restent des contraires par la tension entre eux, et
constitutifs, comme tels, de la réalité, du tissu de la réalité. La violence
sacrificielle au contraire, en substituant à la tension entre les contraires
le rapport du bourreau à la victime, accomplit, à travers l’anéantissement
sans risque de l’autre en tant qu’Autre, sa finalité d’anéantissement
de l’Autre au profit du Même. Ce qu’opère la volonté
sacrificielle, c’est la fin du jeu des contraires, c’est l’élimination, l’extirpation
de l’Autre, de sorte que seul subsiste le Même. Elle réduit la
réalité à du Même, et c’est pourquoi on se trouve transféré, là où elle
s’effectue, dans une irréalité démente, que rend avec une telle force la
description des camps nazis par Robert Antelme. Il s’agit d’un processus de décréation. La volonté sacrificielle est une volonté de décréation.
Le mal radical est ce processus de décréation, et le sacrifice, en
tant qu’il est justement ce processus de décréation, est le mal radical.
Bien que la volonté sacrificielle d’anéantissement de l’autre en tant
qu’Autre mène en général au meurtre de la victime, ou à l’extermination,
voire à l’éradication du groupe désigné comme victime, l’élimination
physique, qui fixe sur elle l’attention, n’est pas par elle-même la
finalité du processus, mais seulement son aboutissement logique. La
finalité véritable réside dans l’avilissement de l’autre en tant qu’Autre,
dans le déni de son appartenance à l’humanité. C’est la signification de
toutes les marques d’infamie, de toutes les humiliations imposées à la
victime, dont le caractère systématique est la signature du processus
sacrificiel. Même là où l’élimination physique est rapide, et où l’humiliation
est donc moins visible, elle n’en est pas moins présente, car elle
est le moteur du processus. Il s’agit de défigurer l’humain chez le porteur
de l’Autre, d’imprimer sur lui, et plus encore d’inscrire en lui
l’image qu’ont de l’Autre les porteurs du Même, de l’obliger par tous
les moyens, tourments physiques et moraux, à correspondre à cette
image, extérieurement de toute façon, mais plus encore, si c’est possible,
intérieurement. Il s’agit de dégrader l’humain en lui de telle façon
que l’humanité n’y soit plus reconnaissable. Et cela non pas, ou du
moins pas directement dans le but de préparer et de justifier l’élimination
physique du porteur de l’Autre, mais de justifier et de renforcer,
chez les porteurs du Même, le mépris, le dégoût ou la haine qu’ils ont
de l’Autre, de telle sorte que l’identité collective du Même constitue à elle seule l’image de l’humain, à l’exclusion totale de l’Autre. La défiguration
et l’avilissement de l’humain chez le porteur de l’Autre apportent
la démonstration de l’impossibilité de la relation entre le Même et
l’Autre, puisqu’il ne saurait y avoir de relation entre l’humain et ce qui
n’est pas de l’humain, qui n’est pas non plus de l’animal, mais le produit
d’une sorte de « raté » de la nature, qui par là n’appartient même
plus à la nature, et n’a donc plus de lieu dans la réalité. Ainsi les porteurs
du Même se sentent-ils pleinement légitimés et confortés dans leur
évitement quasi instinctif [10] et leur négation absolue de la relation.
Ce qu’ils veulent en dernière analyse, c’est revenir, avec bonne
conscience, à l’identité collective des temps barbares. Mais il n’est pas
de restauration possible de ce psychisme indifférencié. La violence
sacrificielle s’acharne sur l’acquis de l’expérience fondatrice, elle
s’acharne, par l’avilissement de l’Autre, à défaire cette structuration de
la psyché et de la réalité humaine que signifient l’émergence de la personne
et l’avènement de la relation. Et bien loin de rétablir un état psychique
et social antérieur, cruel mais riche d’avenir et de devenir, elle
n’aboutit qu’à une déréalisation de la réalité humaine et de la psyché,
déréalisation pour laquelle il n’existe pas encore de mot, tant la prise de
conscience de l’existence et de la nature du mal radical est récente.
C’est en réalité à leur propre destructuration psychique que travaillent, à travers le processus sacrificiel, les porteurs du Même. A travers l’avilissement de l’être humain porteur de l’Autre et désigné pour cette raison comme porteur du Mal, à travers l’élimination physique de celui qui est déclaré non-participant de l’humanité, la volonté sacrificielle opère ce qui est sa finalité invisible et ultime : l’éradication du sentiment de l’Autre dans la psyché des porteurs du Même. Car cet Autre psychique, qui est l’inconnu de leur propre psyché, l’étranger en eux, qui est là, tout près, et dont la présence muette est à elle seule une demande, les dérange, les effraie, leur est insupportable, ce qui a pour effet de le marquer du signe du mal. Porté à l’absolu en cas de crise de l’identité collective, ce Mal se trouve alors projeté sur le porteur extérieur de l’Autre et le processus sacrificiel consiste en l’éradication intérieure de l’altérité à travers l’éradication du porteur extérieur de cette altérité. Dans ce processus, la conscience se renie elle-même. Elle se couche dans ses propres contenus et se réduit alors à un rôle purement fonctionnel, à un rôle d’outil d’adaptation aux besoins et d’agent du progrès technique.
Or, par cette désertion de la conscience et par l’éradication ainsi rendue
possible de l’altérité intérieure, le champ même de l’action de l’archétype
du Soi disparaît, puisque l’action de l’archétype du Soi consiste
à régir le jeu des opposés psychiques. Mais si ce champ d’action disparaît,
les énergies de l’archétype du Soi, elles, ne disparaissent pas : l’effacement
de la conscience les met au service du Même. Il s’agit alors
de la plus fondamentale des destructurations psychiques, de la destruction
radicale du fondement de l’humain en l’homme. Ce sont les mêmes
énergies, les énergies mêmes de la puissance créatrice de l’archétype du
Soi, qui, désormais au service du Même, se trouvent perverties, et s’inversent
en puissance de décréation. D’où la violence littéralement
impensable du processus sacrificiel : la décréation est violence pure,
violence totalement destructurée, qui est à elle-même sa propre fin. En
ruinant chez les porteurs du Même la base psychique de l’individuation,
du plus léger commencement d’individuation, elle inverse en NON -
sens le sens de l’aventure humaine, qui est la poussée vers l’individuation,
c’est-à-dire vers la relation et l’humanisation. Le NON-sens n’est
pas le non-sens. Le non-sens, ainsi que nous l’avons vu plus haut, est le
sentiment qui naît de l’emprisonnement dans les contradictions de la
création charnelle. Si le NON-sens, autre nom du mal radical, est si difficile
à définir autrement que négativement, c’est qu’étant une puissance
de destructuration il n’a pas de nature, pas d’essence, pas d’être.
Il n’est pas, mais il existe, car il est efficace. N’étant rien par lui-même,
il peut être appréhendé uniquement comme énergie, comme énergie
orientée vers la décréation, cette orientation de l’énergie dépendant uniquement
de l’attitude de la conscience. Par lui-même, il est néant, mais
un néant avide, qui se renforce de ce qu’il anéantit.
C’est bien à tort que l’on s’étonne de la banalité du mal radical, de
ce qu’il est le fait de personnes par ailleurs tout à fait « normales ». Au
contraire, on peut affirmer que plus le mal radical est en quelque sorte
« à l’état pur », c’est-à-dire sans mélange de mal transformable, plus
ceux qui le cautionnent ou le commettent sont des gens « ordinaires »,
de « braves gens », particulièrement éloignés de toute transgression, ou
du moins de toute transgression grave de la loi, ce qui se comprend très
bien, puisque la finalité du sacrifice est justement de préserver et de
renforcer la tranquille adhérence des porteurs du Même à l’identité collective, dans sa bonne conscience absolue. Le sacrifice a deux
faces. L’une tournée vers l’intérieur, vers le Même, est parfaitement
rassurante. Elle peut même présenter, outre les traits de la moralité,
ceux de l’intellectualité et de la culture. L’autre face, tournée vers l’extérieur,
vers l’Autre, est l’horreur sacrificielle. Mais ces deux faces
appartiennent intrinsèquement à la même réalité sacrificielle. Le processus
d’éradication de l’altérité est la pire des démences en même
temps que le crime le plus radical — il détruit l’étoffe psychique, il
dénature la psyché en pur mécanisme. Cette démence n’est pas facilement
reconnaissable comme telle, car on conçoit habituellement la
démence comme un désordre psychique qui se traduit par une perception
fantasmatique de la réalité, et donc par une inadaptation à l’environnement.
Les porteurs du Même ont certes une perception
fantasmatique de la réalité, mais comme celle-ci est collective, elle ne
perturbe pas le corps social, elle est même le signe par excellence de
l’appartenance à ce corps et n’apparaît donc pas comme démence,
mais comme normalité, et cela d’autant plus que les porteurs du même
sont en général, nous venons de le voir, particulièrement bien adaptés
à leur milieu. Cette démence non repérée est une démence proprement
éthique, pour laquelle, là encore, il n’existe pas de mot, et les êtres qui,
par le crime sacrificiel, commis sur l’autre en tant qu’Autre, se sont
mutilés de l’Autre intérieur, sont des êtres sans ombre, au sens que
Jung donne à ce mot. C’est-à-dire qu’il n’y a plus chez eux cette part
d’inconnu, de mélange et donc aussi de mal transformable, qui permet
à un être de ne pas coïncider avec son image de lui-même et qui constitue,
pour parler avec les alchimistes, la materia prima du travail d’individuation.
Ce sont des psychés où le jeu des contraires est devenu
impossible, des psychés stériles et, quel que soit par ailleurs leur
niveau de moralité, spirituellement, c’est-à-dire éthiquement
mortes — ce dont cependant nul n’a le droit de juger, car ce sont les
actes qu’on juge.
Il semble tout d’abord qu’à la différence des temps barbares le sacrifice
humain organisé à partir de l’inconscient ne soit pas offert à une
idole puisque, à l’exception des processus sacrificiels liés à certains
fondamentalismes religieux, il n’y a pas d’image divine, pas de nom
divin, pas d’autel ni de culte institué. Cependant, l’idole a beau être
invisible, elle n’en est pas moins présente. C’est justement le Même,
érigé en Bien absolu ou en Pureté absolue. C’est par exemple l’aryen
précurseur de l’Homme nouveau, c’est le Parti, c’est la Nation, etc.
C’est à cette idole que l’on sacrifie, et le sacrifice humain reste bien un acte rituel, même si ce rite, organisé à partir de l’inconscient, n’a pas
de caractère cultuel. Cependant, pour bien comprendre ce que signifie
ici le service de l’idole, il faut faire une différenciation dans le concept
d’idolâtrie, car l’idolâtrie est double, ses deux formes étant en rapport
avec la double nature du mal.
Toute image divine, collective ou non, toute figure humaine, tout
idéal, collectif ou non, de quelque ordre qu’il soit, qui devient le support
d’une projection archétypale se trouve par là même en position
d’idole dans la psyché : son intense puissance énergétique lui assure la
place la plus haute. Mais sans projections, il n’est pas de vie psychique.
Seule la projection permet à la conscience d’entrer en rapport avec les
énergies et les contenus inconscients. Si dangereuses et souvent dévastatrices
qu’elles puissent être, les projections et, en particulier, les projections
archétypales, sont indispensables à la constitution des opposés
psychiques et donc la condition sine qua non de la naissance du processus
d’individuation, c’est-à-dire du dynamisme qui naît de la tension
centrée des contraires. Sans projection archétypale, il ne peut y avoir
d’émergence du symbole, puisque cette émergence implique le retrait
de la projection. Certes, moins la conscience joue son rôle propre, plus
elle adhère à une projection archétypale, plus l’énergie psychique se
fige, plus la psyché devient rigide, mais elle reste encore, plus ou moins
faiblement, structurée par la tension et le jeu des contraires. C’est ce
que nous appelons l’idolâtrie du premier degré, comparable à celle des
temps barbares en ce qu’elle est en accord avec le niveau de conscience
déjà atteint, et en ce que l’inconscience qui lui correspond est également
une inconscience du premier degré, c’est-à-dire originelle, qui recèle
par conséquent un potentiel d’évolution.
Mais si la conscience en vient à absolutiser une projection archétypale
de type collectif et à coïncider avec elle au point de s’identifier
entièrement à elle et d’exclure de la psyché, par l’élimination concrète
de l’autre en tant qu’Autre, c’est-à-dire par le sacrifice, l’Autre intérieur,
alors l’idolâtrie franchit un seuil, le seuil même dont le franchissement
définit le mal radical. C’est ce sacrifice de l’Autre à l’idole du
Même que nous appelons l’idolâtrie du second degré, et l’inconscience
qui lui correspond, étant un refus absolu de conscience, une
volonté d’aveuglement ou d’ignorance à n’importe quel prix, est donc
également une inconscience du second degré, sans aucune possibilité
de dynamisme, donc sans aucun potentiel d’évolution. Par le sacrifice
organisé à partir de l’inconscient, l’être humain verse les énergies de
l’archétype du Soi à la destructuration de la psyché, et par là au meurtre de l’humain en l’homme. Les fondamentalismes religieux qui
pratiquent le sacrifice humain défigurent et dénaturent la divinité
qu’ils prétendent servir en idole du NON-sens.
Puisque le mot de « transformation » est le mot-clé du processus
d’individuation tel que Jung le décrit, l’existence d’un mal radical,
c’est-à-dire d’un mal intransformable, conduit nécessairement à s’interroger
sur les conséquences qui en découlent pour le processus d’individuation.
Il est d’emblée évident que dans une psyché où, par la
participation au sacrifice, le mal radical a triomphé, l’adhérence absolue
du même au même et donc l’exclusion de l’un des opposés psychiques
rendent impossible la mise en tension des contraires, et, ipso
facto, impossible aussi le processus d’individuation. La question se
pose en revanche de savoir selon quelle modalité peut entrer en individuation
une psyché qui a été victime du mal radical. Une telle psyché
en effet a subi, en raison d’une volonté sacrificielle qui s’est
exercée sur elle, des mutilations qui l’ont empêchée de se structurer ou
l’ont destructurée en profondeur, de sorte que, les opposés psychiques
n’ayant pu se constituer comme tels, le jeu des contraires se trouve
dénaturé en programme sacrificiel d’éradication de l’Autre intérieur.
Cette psyché est devenue par là l’instrument involontaire de l’inversion
en elle des énergies de l’archétype du Soi et donc de sa propre
décréation, c’est-à-dire qu’elle obéit, même lorsque aucune volonté
sacrificielle ne s’exerce plus sur elle, au mécanisme d’anéantissement
inscrit en elle, ce qui l’expose au danger de reproduire sur un être
éventuellement sous son emprise le sacrifice qu’elle-même a subi.
Mais c’est aussi parfois la perception de ce danger, le pressentiment du
mécanisme d’auto-anéantissement, qui orientent une telle psyché vers
une recherche intérieure et qui préludent au travail d’individuation.
Le processus d’individuation naît toujours à partir d’un sentiment de
malaise, de manque, de stérilité, ou d’une situation de détresse, de
crise. Dans le cas d’une psyché qui n’a pas subi de violence sacrificielle,
ce sentiment ou cette situation sont la marque d’une perturbation
ou d’une déficience du jeu des contraires. Mais dans le cas d’une
psyché qui a subi une violence sacrificielle, ce sentiment ou cette situation
sont la marque d’une quasi-inexistence du jeu des contraires,
d’une quasi-inaptitude au jeu des contraires, auquel a été substitué,
comme par une malédiction opérante, le rapport intrapsychique sacrificateur-victime. A ces deux états de la psyché, extrêmement différents,
correspondent deux modalités très différentes du processus d’individuation.
Dans une psyché qui n’a pas subi de violence sacrificielle, le processus
naît, ainsi que l’a décrit Jung, de la tension centrée entre les
contraires, et mène à l’expérience de leur union et donc de leur complémentarité
dans l’oeuvre de la création pneumatique. Le maître mot
de cette modalité de l’individuation est bien le mot alchimique et jungien
de « transformation », et les différentes formes du mal affrontées
au cours de ce processus ressortissent au mal transformable.
Il en va tout autrement dans une psyché qui a subi une violence sacrificielle.
Le mal radical en effet n’ayant ni contenus ni énergies qui lui
soient propres, mais consistant uniquement en un mécanisme de captation
et d’inversion des énergies de l’archétype du Soi, qui se trouvent
ainsi mises au service de la décréation, il s’agit ici fondamentalement,
non de transformation, mais de libération. Il s’agit de soustraire cette
psyché à l’emprise du mal radical, et pour ce faire de traquer le fonctionnement
sacrificiel jusqu’au point par lequel il a pénétré en elle, ainsi
que dans les dévastations qu’il lui a fait subir et dans les perversions
qu’il y a inscrites, ce qui implique de ne jamais en confondre les manifestations
avec celles du mal transformable. Mais à mesure que se desserre
l’emprise du mal radical, les énergies de l’archétype du Soi se
trouvent rendues à leur mouvement naturel, en même temps que dévastations
et perversions, n’étant plus « habitées » par l’acharnement
décréateur, redeviennent du mal transformable. Les opposés psychiques
se constituent comme tels, le jeu des contraires est restauré, et cette restauration
obtenue par une libération est justement la modalité du processus
d’individuation dans une psyché victime de la violence
sacrificielle. Cette deuxième modalité du processus d’individuation,
celle de la « libération », par opposition à celle de la « transformation » ,
se différencie également de la première par une tonalité beaucoup plus
sombre. Elle a un caractère terrible que la première modalité, malgré la
même immensité de l’enjeu et des périls affrontés, n’a jamais.
Dans leur langage tout imagé, absolument non réflexif, les contes
merveilleux traduisent admirablement l’existence de ces deux modalités
du processus d’individuation et les différences entre elles, que nous
étudierons dans le corps de cet ouvrage. C’est justement la distinction
que les contes établissent entre ces deux modalités qui permet d’ordonner
leur foisonnement en même temps que de mesurer la profondeur
de leur connaissance du mal. Il y a, d’une part, les récits qui correspondent à des parcours d’individuation placés sous le signe de la
transformation et, d’autre part, les récits de parcours d’individuation
placés sous le signe de la libération. En référence à la quête du Graal
(elle-même un parcours d’individuation, mais dont les différentes versions
sont des textes d’auteurs et non des textes populaires), nous
appelons contes de quête les récits du premier type. Ils sont en parfait
accord avec la description donnée par Jung du processus d’individuation,
et Marie-Louise von Franz, dans plusieurs des ouvrages cités au
début de notre introduction, a écrit de remarquables interprétations et
commentaires de certains de ces contes. C’est pourquoi nous ne proposerons
pas (à une exception près cependant) d’interprétation d’un
conte de quête dans son entier. Nous nous attacherons seulement à certains
épisodes de divers contes, pour étudier, de façon transversale, la
transformation du mal transformable dans les contes de quête, conformément
à notre pensée directrice.
Par opposition aux contes de quête, nous appelons contes de libération ou contes d’enquête les récits du deuxième type. Ici, en revanche,
nous commenterons le plus souvent les contes dans leur entier, pour
bien montrer de quelle façon ils caractérisent cette modalité du processus
d’individuation, et exposent par là même la nature du mal radical.
Tant dans les contes de quête que dans les contes de libération ou
d’enquête, nous ferons ressortir la richesse de la connaissance du mal
transmise par les contes merveilleux, tellement profonde, vaste et subtile
que l’on peut vraiment parler d’une science du mal, mais d’une
science immédiate, tout enclose encore dans l’intuition et le sentiment,
et pour cette raison à la fois si naïve et si forte, de si peu d’apparence,
et d’une justesse si confondante.
Lorsque, plus haut dans notre introduction, nous avons évoqué le
mal radical, nous avons eu recours pour le caractériser aux manifestations
de ce mal que sont les processus sacrificiels collectifs de la victime
émissaire (organisés à partir de l’inconscient). Les contes de
libération ou d’enquête ne parlent évidemment pas de ces processus
collectifs. Ils ne parlent pas du mal radical au plan du groupe, c’est-à-dire
au plan d’une appartenance sociale. Ils ne sortent jamais de la
sphère privée, tout se passe au sein de la famille. Il est d’ailleurs frappant
de constater que, dans les contes de quête, la famille ou bien n’apparaît
pas, ou bien joue au début du conte seulement un rôle mineur,
qui éclaire l’état initial et la situation de départ de la psyché en question,
alors qu’elle joue au contraire dans les contes de libération ou
d’enquête le rôle principal, et cela non seulement dès les premières lignes, mais, à travers divers relais, dans toute la suite du récit jusqu’à
la fin. Lorsque ce rôle n’est pas marqué dès le début du conte, il est soit
nettement indiqué soit fortement suggéré dans le cours du récit par le
lien de parenté qui unit deux des figures.
Dans cette sphère privée, familiale, les contes parlent du mal radical
uniquement en relation avec l’enfant ou l’être jeune, lequel doit
certes être compris comme l’être concret qu’il est, mais tout autant,
selon sa signification symbolique, comme le porteur du nouveau et
donc de l’exigence la plus haute : celle de la relation, de la reconnaissance
de l’humain en lui, de la personne. L’enfant ou l’être jeune
appartient bien à la famille, il appartient au même, mais il est, au sein
de ce même, le porteur en devenir de l’autre en tant qu’Autre. C’est
pourquoi la volonté systématique d’anéantissement physique et/ou
psychique de l’enfant ou de l’être jeune mise en scène par les contes
de libération ou d’enquête est bien la volonté sacrificielle d’éradication
et d’avilissement de l’autre en tant qu’Autre. En montrant cette volonté
sacrificielle à l’oeuvre au sein de la famille, s’acharnant dès ses premières
années sur un être en état de faiblesse et de dépendance absolue,
les contes vont plus loin dans la connaissance du mal radical que
les études sur les processus sacrificiels collectifs de la victime émissaire.
Ils saisissent ce mal à son point d’insertion dans la psyché, ils en
mettent à nu la nature, ils en exposent les ravages chez l’être qui en est
la victime, en même temps qu’ils décrivent la voie de la libération et
donc de la restauration de l’intégrité psychique. Ils traduisent le mal
radical par des images simples, dont on risque toujours de ne pas saisir
la portée, soit en raison de leur évidence immédiate, soit en raison
de la profondeur d’intuition qui y est déposée. Ainsi le bloc formé par
la mère-marâtre avec sa propre fille, et souvent avec ses deux filles,
marque-t-il parfaitement l’origine identitaire du sacrifice, la volonté
d’anéantissement de l’Autre en vue d’une adhérence absolue du même
au même, un même qui est donc par nature collectif. Une autre forme
de l’adhérence à une identité collective se situe non plus dans le plan
horizontal d’un bloc de plusieurs membres d’une famille, mais dans le
plan vertical de la succession des générations, quand un père par
exemple veut reproduire avec sa fille l’état de fusion qu’il a vécu avec
son épouse ou, plus souvent, avec sa propre mère, prolongeant ainsi
une indifférenciation identitaire de type généalogique, ce que le conte
suggère par l’apparition dans le récit d’une mère qui tient son fils sous
son emprise — réapparition et répétition d’un passé non travaillé, non
résolu. Ainsi la volonté d’adhérence à une identité indifférenciée, donc par définition collective, apparaît-elle bien dans les contes de libération
ou d’enquête comme le moteur du processus sacrificiel, ce qui
montre la nature une et toujours la même du sacrifice à travers des
formes en apparence si différentes qu’elles paraissent d’abord irréductibles
l’une à l’autre.
Quand nous avons distingué entre l’insensibilité à l’autre considéré
et traité comme obstacle ou instrument, et l’insensibilité à l’autre en
tant qu’Autre, qui est une prédisposition sacrificielle plus ou moins
marquée selon les individus, nous avons brièvement noté qu’il existe
deux modalités d’anéantissement, une modalité par exclusion et une
modalité par inclusion. Dans la suite de notre introduction, nous avons
eu recours, pour caractériser le mal radical, à la seule modalité par
exclusion, qui est, dans l’espace collectif, le sacrifice de la victime
émissaire, lequel rend plus aisé de caractériser rapidement le processus
sacrificiel que la modalité par inclusion. Celle-ci se traduit dans l’espace
collectif par la violence de systèmes sociaux ou politiques qui
écrasent l’individu en réduisant le groupe à une masse indifférenciée.
Dans les contes merveilleux, plus précisément dans les contes de libération
ou d’enquête, cette modalité par inclusion, que nous caractérisons
comme incestuelle, parce qu’il s’agit non d’une élimination, mais
d’une assimilation sacrificielle de l’Autre, de sa réduction sacrificielle
au Même, est, comme nous le verrons, extrêmement présente [11].
La distinction fondamentale entre contes de quête, d’une part,
contes de libération ou d’enquête, d’autre part, ne doit pas faire oublier
leur unité essentielle. La libération et l’enquête visant en effet la restauration
des opposés psychiques et donc du jeu des contraires dans la
psyché, il est évident qu’elles sont une autre modalité du processus de
création pneumatique qui naît de la tension centrée des contraires,
c’est-à-dire une autre modalité du processus d’individuation, et donc,
finalement, une autre modalité de la quête. C’est pourquoi d’ailleurs la
transformation d’un contenu animal en être humain, si caractéristique de la quête, se rencontre aussi dans certains contes de libération ou
d’enquête, la restauration de l’opposé psychique, après un recul de
l’emprise du mal radical, s’exprimant alors à travers cette image. Si
tous les contes merveilleux sont des récits de crises individuantes ou
de parcours d’individuation, on peut dire que les contes de quête, dans
lesquels la psyché est en quelque sorte de plain-pied avec l’individuation,
ignorent le mal radical et donc aussi l’enquête et la lutte pour la
libération, tandis que les contes de libération et d’enquête sont toujours
en même temps des contes de quête, mais d’une quête qui aurait intégré
la connaissance du mal radical.
L’évidence immédiate de l’unité de ces deux types de récits, qui s’exprime à travers leur appellation commune de contes merveilleux, ne pouvait que détourner l’attention de ce qui à la fois les différencie et les articule les uns aux autres. Or, cette appellation de contes merveilleux, quand on y réfléchit plus attentivement, se révèle moins claire qu’elle ne le paraît d’abord. L’acception littéraire du « merveilleux » le définissant comme ce qui est inexplicable de façon naturelle, ces contes certes sont à bon droit désignés comme merveilleux, puisque nombre de leurs figures sont des apparitions surnaturelles et que tous les événements et enchaînements d’événements y sont étrangers à l’espace-temps et aux lois de la nature. Mais il existe d’autres récits, également d’origine populaire, où le merveilleux, au sens qui vient d’être rappelé, est tout aussi présent que dans les contes merveilleux, puisqu’un homme y épouse une femme d’origine inconnue, fée des eaux ou des forêts, qui le comble de bienfaits avant de disparaître mystérieusement après quelque temps de bonheur. Pourtant, ces contes ne sont pas au nombre des contes merveilleux, et on le comprend sans peine, puisque l’histoire finit mal, et c’est pourquoi nous les désignons comme contes et légendes d’échec. Il n’en reste pas moins que le merveilleux des contes merveilleux allie intimement, jusqu’à les fondre, deux notions qui correspondent aux deux sens, littéraire et commun, de l’adjectif « merveilleux », mais qui ne vont pas nécessairement ensemble : d’une part, un monde étranger à l’espace-temps, aux lois de la nature, et, d’autre part, un mouvement de l’histoire orienté de façon positive. À l’inverse, dans les contes et les légendes d’échec, le mouvement de l’histoire est orienté de façon négative, et le merveilleux se voit par là même restreint à la seule signification d’un ordre étranger à celui de la nature. La question se pose alors de savoir pourquoi l’orientation du mouvement dans les contes et légendes d’échec est inverse de celle des contes merveilleux. Avant d’aborder l’étude directe des contes merveilleux, nous consacrerons donc un bref chapitre à ces contes et légendes d’échec. Bien loin de nous éloigner de notre propos, cet apparent détour nous permettra, en distinguant deux expériences archétypales extrêmement différentes, de saisir la qualité propre du merveilleux dans les contes merveilleux, et d’éclairer ainsi, par opposition, leur singularité, qui est en même temps, au-delà des deux modalités de la quête et de la libération ou de l’enquête, leur unité essentielle. Et, en situant ainsi les uns par rapport aux autres, ces contes et légendes d’échec et les contes merveilleux, nous approfondirons notre réflexion sur la connaissance de la double nature du mal, qui est le thème central du présent travail.
Notes
[1] La Fontaine de pierre, Paris, 1978. Il est vrai qu’il s’agit ici non d’un conte merveilleux, mais du texte d’Apulée.
[2] La Fontaine de pierre, Paris, 1979.
[3] La Fontaine de pierre, Paris, 1978.
[4] La Fontaine de pierre, Paris, 1980.
[5] Cette présentation permettra en outre d’introduire un certain nombre d’expressions à travers lesquelles nous avons fait nôtre la pensée de Jung, et qui reviendront souvent dans cet ouvrage. Nous les distinguons de celles que Jung a lui-même forgées en les écrivant en italiques dans cette introduction. Mais lorsque, plus loin dans cette même introduction, nos analyses, sortant du champ jungien, aborderont le thème du sacrifice, les expressions en italiques correspondront à des concepts qui nous appartiennent en propre, et qui reviendront également constamment dans la suite de cette étude.
[6] Il est nécessaire de préciser comment nous entendons l’expression « création charnelle », de crainte que l’adjectif « charnel », à cause de son origine paulinienne, apparaisse connoté de mépris pour ce plan de l’être. Nous n’avons tout simplement pas trouvé de meilleur terme pour désigner sans périphrase ce qui se rapporte, ensemble ou séparément, au plan du corps, aux sens et à l’appareil psychique, c’est-à-dire à l’être humain en tant qu’il n’a pas accès au plan de la réalité symbolique.
[7] Nous parlons évidemment ici des seules projections archétypales, et non des projections plus légères, qui se dissolvent beaucoup plus aisément et dont les contenus alors ne sont pas seulement reliés à la conscience, mais totalement réintégrés dans la personnalité consciente.
[8] Cette crise décisive correspondrait, mutatis mutandis, bien sûr, à ce qu’on appelle « théorie des catastrophes » en physique infinitésimale. Le potentiel de conscience, en s’accumulant, atteindrait un niveau ou une « masse critique » qui déclencherait ce « saut qualitatif » (commentaire dû à Brigitte Darcourt).
[9] Le mal radical est donc une formation seconde et non originelle. Ce n’est pas un mal qui se trouve à la racine de l’être, mais un mal qui s’attaque à la racine, au fondement de l’humain en l’homme (commentaire dû à Brigitte Darcourt).
[10] De l’instinct, le mal radical, c’est-à-dire le processus sacrificiel, a sous toutes ses formes, physiques et / ou psychiques, lentes ou paroxystiques, le caractère de programme parfaitement exécuté, et, là où les circonstances l’exigent, la souplesse et l’adresse nécessaires à la réalisation de sa fin. Mais, selon une heureuse formulation de Brigitte Darcourt, si le mal radical peut présenter toutes les caractéristiques apparentes de l’instinct, il en inverse les finalités, ce qui devrait suffire à écarter tout amalgame entre instinct et mal radical. Cette inversion des finalités explique la cécité absolue, à l’égard du processus de création, des figures du mal radical dans les contes.
[11] L’incestuel ainsi compris est donc très vaste, puisqu’il englobe tout sacrifice où l’enfant n’est pas même perçu comme ayant une existence séparée, mais où il est au contraire ressenti avec une évidence inentamable comme prolongement et instrument de son père (dans les contes, comme nous le verrons, il s’agit dans ce cas presque toujours du père). L’enfant est, en quelque sorte, absorbé par le narcissisme absolu du père (Cf. Paul-Claude Racamier, L’Inceste et l’Incestuel, Éditions du Collège, Paris, 1995). L’incestueux apparaît alors comme un cas particulier de l’incestuel.