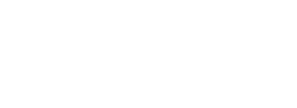Intranet
Accueil > Nos projets & actions en cours > Démocratie & veilles citoyennes > Lobbying et conflits d’intérêt : (...) > Documentation > "Lobbying et Santé", un ouvrage de (...) > L’école du tabac |
L’école du tabacnovembre 2009 |
Pourquoi les cigarettes ne s’éteignent-elles pas ?
Fin 1996, une information tombe dans les agences de lobbying des cigarettiers américains. Mauvaise nouvelle. Il s’agit des résultats d’une étude menée par le Département des pompiers de New York comparant les différentes causes d’incendie. Ils font ressortir que les cigarettes sont la première cause d’incendies mortels. Au cours des douze mois qui précèdent, 43 habitants de la ville ont péri dans des incendies dus à des cigarettes. En fait, les lobbyistes savent déjà que les cigarettes mal éteintes sont à l’origine d’un plus grand nombre d’incendies que toutes les causes connues comme les friteuses qui s’enflamment, les enfants qui jouent avec des allumettes, les courts-circuits et autres accidents ordinaires. Cela les surprend d’autant moins que c’est la même chose dans toutes les villes du monde et qu’ils disposent de données à ce sujet depuis plus d’un siècle. Ils ne craignent qu’une chose en recevant les résultats de l’étude : que les pompiers diffusent ce résultat aux médias et que l’opinion publique s’en émeuve.
Pour un lecteur commun, l’information pourrait paraître purement factuelle et d’un intérêt quasi anecdotique. Par contre, pour un lobbyiste travaillant au service des firmes de tabac, il s’agit d’une mèche redoutable, prête à s’allumer si des observateurs perspicaces se prenaient de l’envie d’y réfléchir sérieusement. Les lobbyistes concernés anticipent aussitôt les suites probables… Les agences de presse vont lancer leurs dépêches, sans s’y attarder. Routine. Des médias la reprendront éventuellement sous forme de brèves. En revanche, il ne faudrait pas qu’un journaliste décide de s’y intéresser de trop près, de faire des extrapolations à l’échelle des États-Unis et, ô cauchemar, de retrouver certaines données gouvernementales, peu divulguées mais accessibles, montrant qu’environ 2 000 à 24 000 Américains meurent chaque année dans des incendies causés par des cigarettes [1]. Cela fait beaucoup. Surtout si l’on s’approche du terrain : enfants en bas âge, malades privés d’autonomie, personnes handicapées ou âgées, gens vivants dans des sous-sols, étages qu’on ne songe pas toujours à avertir en cas d’incendie, etc. Au-delà des morts, il y a aussi les blessés, les grands brûlés et les autres, qui gardent des séquelles à vie.
Ces tragédies sont provoquées par des mégots mal éteints, des explosions de nuages de gaz entrant au contact de cigarettes incandescentes, des déflagrations de vapeurs d’essence ou de dissolvant pour les ongles au moment d’appuyer sur un briquet… Pour ne pas parler des fumeurs, très nombreux, qui s’endorment avec leur cigarette allumée ou l’oublient sur un meuble. Après ça, il y aurait des journalistes pour chercher des estimations du coût économique de ces incendies en perte de biens et en soins des blessés [2].
Les cigarettiers se seraient bien passés d’une information aussi dramatique au moment où le tabac est devenu officiellement l’ennemi public n° 1. Ces milliers de décès, s’ajoutant au nombre d’Américains qui meurent chaque année du tabagisme, soit 300 000 personnes, risquent même d’attirer les regards sur de lourds secrets, comme nous allons le voir…
Les données montrant que les cigarettes sont à l’origine de très nombreux incendies avaient été plusieurs fois réunies avant 1996, quoiqu’elles n’avaient jamais intéressé grand monde jusqu’alors. Par exemple, une étude sur 530 morts dans des incendies dans le Maryland entre 1971 et 1977 avait révélé que près de la moitié de ces décès impliquaient des cigarettes, mais elle fut accueillie dans une indifférence quasi générale. Depuis, le contexte a changé. Au cours des années 1990, l’opinion publique est devenue plus sensible aux questions de santé publique, et tout ce qui a longtemps été refoulé derrière le plaisir de fumer remonte à la surface. Le contexte n’est plus du tout favorable au tabac et, pardessus le marché, l’étude porte sur New York. La ville la plus médiatisée au monde. Autant dire qu’elle risque d’avoir un retentissement considérable, non seulement au pays de l’Oncle Sam mais dans toutes les capitales. Et si l’idée venait à toutes les métropoles de mener le même genre d’enquête ? De plus, ces drames touchent aussi des non-fumeurs, ce qui affaiblit la défense de la cigarette au nom du respect de la liberté. Les lobbyistes sur le front sont conscients également que cela tombe au moment où des études sur l’impact du tabagisme passif fragilisent leur position…
Ils sont inquiets, bien qu’ils aient déjà surmonté des situations très gênantes. Inquiets est d’ailleurs beaucoup dire, car les crises les font grassement vivre. La multiplication des urgences ne les effraie pas si la poule aux oeufs d’or n’en meurt pas. Cela incite les firmes à multiplier les missions de lobbying et à accepter les opérations éclairs payées rubis sur l’ongle. Avec un peu de talent, les meilleurs professionnels réussissent même parfois à transformer ces situations de crise en opportunités médiatiques favorables à leurs clients. Un principe, pour y parvenir, est d’inverser les représentations, autrement dit de faire croire que ce sont les cigarettiers qui ont décidé de prendre le taureau par les cornes. En l’occurrence, certains songent à prendre les devants avec une campagne sur le thème : « Grâce à leur bon sens, les fumeurs peuvent sauver des centaines de vies chaque année ! » Délicat... Ce genre d’opération est toujours à double tranchant, même s’il vaut mieux allumer un feu pour combattre le feu que d’apparaître encore une fois sur la défensive, comme d’éternels dissimulateurs.
Mauvaise passe pour les cigarettiers. Leur situation historique est alors la pire qu’ils aient jamais connue. La vindicte née avec les grands procès lancés quelques années plus tôt, loin d’être retombée, s’amplifie chaque mois devant les rebondissements judiciaires, la diffusion des documents secrets issus des perquisitions dans les firmes, les nouvelles plaintes de victimes et d’autorités qui ont décidé d’en finir avec les cachoteries. Les lobbyistes hésitent. L’attente est peut-être préférable, en restant prêt à réagir si le vent se lève. Une idée plus forte encore a déjà germé dans l’esprit d’un groupe de consultants : former une coalition des industriels du tabac pour demander un effort aux fabricants de mobilier afin de mettre au point des lits et des divans moins inflammables. Les cigarettiers apparaîtraient comme les fers de lance de la prévention contre les accidents domestiques, parvenant à faire diminuer la mortalité en raisonnant les fumeurs et en suscitant un effort national pour rendre l’environnement plus « secure »…
La campagne sera lancée, d’abord pour rappeler que, dans cette affaire, ce ne sont pas les firmes qui sont coupables mais des « personnes qui ont des comportements insensés ». Elle n’aura pas vraiment l’effet espéré, faute d’envergure et de réactivité des firmes, mais elle limitera un peu l’incendie. Les lobbyistes en profiteront aussi pour lancer aux quatre vents que les fabricants de tabac ont été les premiers à financer des services de sapeurs pompiers au XIXe siècle, notamment avec Stuyvesant en 1860 ! À l’époque, le problème était déjà apparu aux firmes et, comble d’ironie, elles avaient intérêt à soutenir les services de lutte contre le feu car les entrepôts de tabac étaient particulièrement inflammables.
Brûlons la métaphore jusqu’au bout : une partie de l’opinion publique n’y verra que du feu. En revanche, les pompiers de New York ne se laisseront pas intoxiquer. Ignorant l’argument historique et les sollicitations des lobbyistes (y compris leurs contributions financières), ils lanceront une campagne intitulée : « Un monde sans tabac avec le Département anti-incendie ». Ils appelleront à cesser de fumer, à commencer chez les pompiers, lesquels respirent déjà assez de fumées toxiques pour ne pas en rajouter. De fait, l’addiction au tabac touche aussi leur corporation, même si les pompiers ne fument pas plus que les autres, malgré la fameuse expression « fumer comme un pompier ». L’origine de l’expression serait liée aux vestes en cuir enduites de graisse qu’ils portaient autrefois et qui fumaient en chauffant (certains la font remonter à l’époque où ils utilisaient des pompes à vapeur qui enfumaient les rues).
Les cigarettiers s’abstiendront de rappeler qu’ils connaissent le problème des incendies dus à leurs produits depuis qu’ils en font le commerce. Ils se garderont aussi de rappeler que la composition de leurs cigarettes et leur densité sont conçues pour qu’elles ne s’éteignent pas quand on les pose. Elles sont ainsi plus vite consumées, ce qui accroît les ventes. Une autre raison, plus impérieuse encore, les rend muets à ce sujet : si cela vient à se savoir, des procès pourraient être intentés par les victimes dans différents pays et donner lieu à une jurisprudence.
Ils oublieront de dire également que, dès la fin des années 1920, une députée américaine, Edith Nourse Rogers, avait solennellement exigé qu’ils vendent des cigarettes s’éteignant toutes seules quand elles ne sont plus aspirées. Comme ils oublieront de signaler que des générations d’hommes politiques ont demandé à leur tour qu’on fabrique des cigarettes « auto-extinguibles » [3]. Enfin, ils continueront de passer sous silence les dizaines de brevets mis au point par des ingénieurs depuis 1854 pour qu’elles s’éteignent plus rapidement ou dégagent moins de chaleur en se consumant (diminuant ainsi le risque d’embrasement). Brevets pourtant répertoriés avec soin dans leurs archives [4]. Quand on les interroge à ce sujet, les firmes répondent soit que « les procédés d’autoextinction ne sont pas encore satisfaisants », soit qu’elles n’ont pas à prendre en charge « la négligence de certains consommateurs ». D’autres encore déclarent que ces cigarettes imposeraient l’emploi d’additifs dangereux ou de substances ayant un goût que les fumeurs n’aiment pas. Aucun ne reconnaît spontanément mêler au tabac des substances propices à la combustion, ni avoir étudié la juste compression des brins de tabac dans le même objectif, ni avoir conçu de papier spécialement aéré pour contribuer à cet effet… Doit-on s’en étonner ? Le laboratoire du California Fire Marshal, après avoir examiné 55 marques de cigarettes, conclura pourtant que leur papier avait été traité avec une substance le rendant plus poreux afin de faire passer l’oxygène et d’assurer ainsi la combustion du tabac jusqu’au bout.
On peut trouver plus surprenant de voir les autorités qui fixent des normes anti-incendie et anticombustion pour les produits les plus divers, et soucieuses de les soumettre à des contrôles stricts, refuser d’encadrer peu ou prou la combustibilité des cigarettes, comme le remarquait récemment le médecin Myron Levin et des sénateurs.
Les opérations de communication des lobbyistes et leur travail de relation publique pour conserver la main ne parviendront plus très longtemps à donner le change. En tout cas, pas auprès des New Yorkais qui, au cours de la décennie suivante, observeront avec de plus en plus d’attention les incendies évitables. Leur capacité d’indignation s’aiguisera avec les événements du 11 septembre 2001 : la vision en direct des hommes et des femmes prisonniers des flammes dans les tours du World Trade Center, les faiblesses de leur structure et du dispositif anti-incendie feront surgir des questions embarrassantes, lesquelles éveilleront la curiosité des habitants sur les problèmes de sécurité anti-incendie. Le surnombre de brasiers causés par les cigarettes qui ne s’éteignent pas les sidère. En découvrant bientôt que les fabricants favorisent cette combustibilité et qu’ils pourraient y remédier facilement, ils tombent des nues. En outre, que ces derniers rejettent la responsabilité sur leurs propres clients et sur les fabricants de meubles apparaît aux habitants comme le comble du cynisme. Grâce à leur mobilisation, le 28 juin 2004, cette ville va devenir la première administration au monde à imposer des normes de sécurité aux cigarettes qu’on y vend. Désormais, leur combustibilité doit être assez réduite pour qu’elles puissent s’éteindre toutes seules quand on les repose (la norme new-yorkaise impose qu’elles s’éteignent avant la fin dans 75 % des unités composant un paquet).
En France, où les cigarettes mal éteintes sont aussi à l’origine de nombreux incendies domestiques et de feux de forêts dramatiques, les autorités seraient bien avisées d’intervenir à ce sujet. Elles pourraient s’inspirer de l’exemple new-yorkais, mais aussi des efforts de nos cousins canadiens. Au Canada, en effet, le ministère de la Santé a suivi avec intérêt l’adoption des nouvelles normes par la ville de New York. Il a testé 62 marques de cigarettes vendues dans le pays. Une seule marque a démontré que le fabricant avait réduit la combustibilité de sa cigarette et la chaleur qu’elle dégageait en brûlant. Le ministère de la Santé, après avoir établi la faisabilité technique des procédés (faisabilité déjà établie par un organisme américain [5]) et leur « coût abordable » pour les cigarettiers, a défini une norme et prévu un règlement exigeant qu’à partir du 1er octobre 2005, les cigarettes fabriquées ou importées au Canada ne se consument pas toutes seules sur toute leur longueur et produisent moins de chaleur.
Tirons la leçon des réactions tactiques des lobbyistes cigarettiers. Dans l’espoir de contrer ce projet, certains ont affirmé que le règlement n’aurait qu’un effet pervers sur les comportements en « créant un faux sentiment de sécurité parmi les fumeurs », lequel aggraverait les comportements à risque. L’argument aurait pu offrir une porte de sortie aux autorités politiques si elles avaient souhaité s’en saisir, mais tel n’était manifestement pas le cas. Les lobbyistes se sont vus rappeler que le même argument avait été utilisé par les constructeurs automobiles qui s’étaient dressés contre l’obligation de la ceinture de sécurité et des airbags, dispositifs qui ont vraiment fait leur preuve et n’ont pas multiplié les chauffards. Les lobbyistes ont essayé aussi de repousser le projet en déclarant que les consommateurs mécontents de voir leurs cigarettes s’éteindre plus souvent se tourneraient vers des produits de contrebande (argument particulièrement retors, comme le montreront les procès révélant des liens effarants entre firmes et contrebandiers [6]). Les mêmes ont argué de la nécessité que des tests de toxicologie précèdent la mise en vente de ces nouvelles cigarettes et qu’ils ne voulaient pas porter la responsabilité d’intoxications éventuellement liées à de plus faibles combustions. Cette soudaine préoccupation a fait sourire, dit-on, les participants incrédules. Il est vrai que, jusqu’à présent, on avait peu l’habitude de les entendre au sujet de la toxicité du tabac, sinon pour nier son impact sur la santé.
Le fait que la cigarette contienne plus de 4 000 substances chimiques, dont 50 à 60 sont des cancérogènes déjà connus, sans parler des neurotoxiques et des cocktails toxiques qui se forment en brûlant, n’avait jamais semblé les troubler à ce point. Pour les « tranquilliser », les représentants du ministère ont rappelé que deux études rassurantes avaient déjà été publiées sur la fumée des cigarettes à combustion réduite et qu’elles avaient été conduites par deux grands fabricants américains. Les lobbyistes, qui ne pouvaient ignorer l’existence de ces études, savaient désormais que le ministère les connaissait aussi. Celui-ci s’est d’ailleurs montré « affable » et, saisissant la balle au bond, a considéré que les études en question pouvaient néanmoins être approfondies. Il a donc modifié le texte pour leur imposer de procéder à leur tour à des tests, avec l’obligation de les renouveler tous les ans. En attendant, il décidait que les mesures prévues par le règlement entreraient tout de même en application à partir de l’année 2005.
Un représentant des fabricants a opposé un autre argument : selon lui, les consommateurs qui n’accepteraient pas les cigarettes modifiées allaient se tourner vers d’autres produits comme les tabacs à rouler, à commencer par les clients les plus démunis économiquement (catégorie qui est déjà la plus portée à utiliser ces produits) et ne ferait « qu’accentuer la vulnérabilité de ce groupe ». Il a fallu lui rappeler que les cigarettes que l’on roule soi-même présentent justement la tendance très nette à s’éteindre toutes seules.
Sur sa lancée, le ministère canadien a annoncé que les cigarettes fabriquées au pays pour l’exportation vers l’étranger devraient se conformer aux mêmes exigences pour ne pas nuire à la réputation du Canada auprès de la communauté internationale…
Ce qui n’est pas le cas de toutes les Américaines à l’heure où j’écris ces lignes, loin s’en faut. Le faire savoir au public français ne pourra qu’inciter les producteurs à faire des efforts pour ne pas perdre des parts de marché.
New York et le Canada ont fait des émules. Cinq nouveaux États américains ont adopté des lois limitant le potentiel incendiaire des cigarettes. Le Vermont au 1er mai 2006, la Californie au 1er janvier 2007, le New Hampshire au 1er octobre 2007, l’Illinois au 1er janvier 2008 et le Massachusetts au 1er janvier 2008.
En France, le problème n’est soulevé par personne et si on s’y attaquait ?
Les cigarettiers américains et leurs lobbyistes
Aux États-Unis, le marché du tabac se porte très bien aussi. Les planteurs y ont constitué très tôt un vigoureux lobby dès le XVIIIe siècle. L’honorable Georges Washington, le 1er président, l’a soutenu d’autant plus activement qu’avec ses 150 esclaves noirs fraîchement capturés en Afrique, il était l’un des planteurs les plus puissants de Virginie. Plus accessoirement, il a contribué aussi à la défense des viticulteurs, possédant aussi des hectares de vignoble avec des cépages qu’il avait fait venir de France, des côtes de la vallée du Rhône.
Comme lui, les premiers colons des États du Sud comme le Maryland, la Virginie et la Caroline ont pressenti les gigantesques possibilités de gains offertes par l’extension de l’usage du tabac. Ce fut la principale source d’enrichissement de ces États qui ont refusé aussi bien l’abolition de l’esclavage que tout ce qui pouvait limiter l’économie de leurs plantations. Le commerce du tabac ne pouvait se développer sous des auspices plus appropriés. L’Oncle Sam est né, peut-on dire, avec un cigare entre les dents. Son usage deviendra le symbole de la réussite sociale et la boîte de cigares figurera toujours en bonne place sur le bureau présidentiel américain, de Georges Washington jusqu’à Georges Bush, en passant bien sûr par Bill Clinton (Barack Obama s’est engagé quant à lui à faire la guerre au tabac).
En mécanisant la fabrication des cigarettes au début du XXe siècle, les producteurs se sont ouvert des perspectives de gains encore plus prodigieuses.
Ils ont rapidement exercé une influence considérable sur les politiques. Pour preuve, ils ne craindront même pas les services chargés de tester la toxicité des produits mis sur le marché, ceux de la Food and Drug Administration (FDA), l’organisme créé en 1927 pour se prononcer sur le sort des produits chimiques entrant dans la composition des produits destinés à la consommation ou à des usages domestiques, tels que les médicaments, les denrées alimentaires, les cosmétiques, les insecticides… Savons, confiseries, pâtisseries, conserves, normalement rien n’échappe à la FDA. Même les pâtes de dentifrice sont analysées et testées. Que le moindre échantillon examiné contienne une substance suspecte de provoquer des irritations ou des maladies, et l’entreprise est sommée d’y remédier si elle ne veut pas mettre la clé sous la porte. Elle se montre souvent impitoyable et interdit en principe ceux qui présentent des risques sans nécessité. D’ordinaire, les industriels la redoutent donc. Logiquement, les cigarettiers devraient avoir des sueurs froides en songeant aux substances qu’ils utilisent pour traiter les feuilles des plants de tabac, blanchir le papier et « saucer » les brins. Pour ne pas parler des goudrons qui se forment en brûlant, ni de la nicotine… Alors, comment expliquer leur sérénité ? Ils ont obtenu des autorités, en 1906, que leurs produits échappent au contrôle. Leurs lobbyistes sont déjà si actifs et s’appuient sur des réseaux si puissants – notamment ceux qui soutiennent les campagnes des candidats aux élections – qu’ils ont effacé de l’horizon les menaces qui semblaient devoir s’accumuler sur leurs produits avec le progrès des sciences médicales. En un mot, aucun organisme officiel ne peut inspecter le contenu de leurs cigarettes. Seuls des chercheurs isolés s’enhardissent sur ce terrain.
Pour défendre leurs intérêts auprès des autorités, multiplier les fumeurs et calmer l’opinion publique quand des scientifiques publient des résultats inquiétants, les cigarettiers se sont dotés de grands professionnels des « relations publiques ». Notamment Albert Davis Lasker et les très réputés Ivy Ledbetter Lee, Edward Bernays et John Hill. Ces lobbyistes méritent la plus grande attention. Car c’est tout simplement eux que les historiens tiennent pour les inventeurs du lobbying moderne. Ces hommes vont en effet affiner et formaliser les techniques d’influence auprès des politiques et de la presse. Le troisième surtout aura un rôle central : Edward Bernays forgera les concepts fondamentaux de cette activité. Accessoirement, il va permettre aux cigarettiers américains de s’imposer dans le monde entier malgré l’adversité grandissante des scientifiques et des associations. Nous allons voir que le même homme rendra également service à d’autres industries posant des problèmes chroniques de santé publique.
Vendre les symboles du progrès industriel
Examinons tout d’abord les contributions d’Albert D. Lasker (1880-1952). Fils de banquier, il débute comme journaliste au Morning News. Son père ne voyant pas d’un bon oeil son désir de faire carrière dans le journalisme, Albert accepte d’entrer quelques semaines dans une agence de publicité pour lui faire plaisir. Il y restera plus de quarante ans et deviendra l’un des meilleurs vendeurs de produits industrialisés au monde et un créateur de « nouveaux besoins ». Il se distingue d’abord par des campagnes innovantes pour des industriels voulant commercialiser du porc en boîte et des conserves de haricots. À une époque où 94 % des femmes américaines restent au foyer et ont l’habitude d’acheter des haricots frais et de la viande de porc à l’étal, le pari semble impossible. Pourtant, il réussit à convertir les consommateurs en les faisant passer pour un symbole de progrès. Ces derniers ignorent qu’ils y perdent en qualité nutritionnelle et qu’ils avalent des additifs alimentaires produits par l’industrie chimique, notamment des conservateurs, mais Lasker leur vend un « gain d’hygiène et d’efforts ». Il en fait surtout profiter son client, l’industrie Van Camp’s, laquelle vendra ensuite des conserves de lait condensé, des boîtes de tranches de hot-dog en sauce, etc. De même, alors que les Américains sont de gros mangeurs d’oranges, il leur fait adopter le jus d’orange en bouteille. Albert D. Lasker récidive avec le nez des Américains. Il en fera le premier peuple au monde à abandonner les mouchoirs en tissu pour se moucher dans des morceaux de papier, pour le compte de Kleenex. Ce n’est pas économique, ni respectueux de l’environnement, ni même si hygiénique qu’on le prétend car les consommateurs conservent souvent le papier pour le réutiliser (sans pouvoir le laver), mais c’est « moderne ». Le mythe du jetable est né. Les succès de ce publiciste qui achète au passage un certain nombre d’industries d’avenir incarnent de façon éclatante le mot d’ordre qui se répand parmi les théoriciens des « relations publiques » selon lequel il faut détourner les populations de leurs véritables besoins pour enrichir les industriels (voir le chapitre Un petit homme nommé Edward…).
Lasker a aussi l’idée de lancer des opérations publicitaires au sein des écoles, dans les classes de filles, sous des prétextes « pédagogiques » sur les cycles menstruels, pour une marque de tampons hygiéniques, Kotex tampons. Ce faisant, il explique à ses confrères et concurrents que les réussites commerciales ne reposent pas sur le respect des usages mais sur leur transgression ou leur déplacement, lesquels séduisent toujours une grande partie du public, du moins au début.
On le voit même appliquer ses recettes aux campagnes électorales pour des candidats républicains et conduire Warren G. Harding à la victoire aux présidentielles en 1920 en le vendant comme un produit de consommation moderne. Il ne pourra pas en tirer tout le bénéfice attendu auprès de l’opinion publique car le nouveau président des États-Unis fera scandale en acceptant 100 000 dollars de commission discrète de l’industrie pétrolière et en nommant une équipe gouvernementale très ouverte aux pratiques de corruption. Mais, bien conseillé, Warren Harding redorera partiellement son blason auprès de l’opinion, de plus en plus sensible aux ravages de l’alcoolisme, en interdisant aux médecins de prescrire de la bière et des spiritueux aux malades.
Et les cigarettiers ? La Première Guerre mondiale leur offre l’opportunité d’écouler leur produit aux soldats et de multiplier ainsi durablement les fumeurs, mais le retour de la paix coïncide avec une rumeur persistante sur le caractère irritant du tabac. Lasker va accomplir une performance en la prenant à contre-pied pour le compte de l’American Tobacco Company, plus précisément en faveur des cigarettes Lucky Strike, en étroite collaboration avec John Hill. Sur la base d’un faux sondage auprès du corps médical, il présente ces cigarettes comme des produits conseillés par les médecins. Il va jusqu’à réaliser des spots avec des stars du cinéma parlant et des cantatrices réputées du Metropolitan Opera qui acceptent de déclarer : « Je protège ma précieuse voix avec Lucky Strike » ou « Les cigarettes adoucissent votre gorge », en espérant du même coup inciter les femmes à fumer, car les rares qui s’y adonnent le font encore très discrètement [7].
Lasker va utiliser à fond la presse féminine pour relayer ses pubs. À partir des années trente, les femmes américaines ne peuvent plus ouvrir une revue sans tomber sur une page leur vantant les mérites d’une marque de cigarettes.
Albert D. Lasker est considéré comme le premier communicant à avoir conçu les messages publicitaires avec l’aide d’écrivains et à avoir créé des émissions radiophoniques ou des spectacles entiers autour de produits à vendre, voire des stations de radios à finalité publicitaire. Les publicistes verront en lui le fondateur de la publicité moderne.
Il achèvera sa vie en prenant de la hauteur par rapport au monde de la publicité, qu’il regardera avec un certain mépris. Il créera finalement la Fondation Lasker en faveur d’actions philanthropiques et organisatrice d’un prix pour la recherche médicale. Il se mobilisera également dans la lutte contre le cancer.
Ivy Lee : « Mâchez le travail des journalistes »
Le parcours d’Ivy Lee, né en 1877, présente des similitudes très intéressantes avec celui d’Albert Lasker. Il illustre de façon tout à fait typique le cheminement des hommes qui, au début du XXe siècle, ont jeté les bases de la communication d’influence et du lobbying qui ne se réduisent plus à viser les décideurs politiques. Diplômé de Princeton (où il obtint un prix d’éloquence), il travaille d’abord comme journaliste à New York, spécialisé dans les affaires financières. Puis il entre au service du bureau de presse du Comité national démocratique et participe au soutien de la campagne présidentielle du juge Alton Parker contre Theodore Roosevelt. C’est un échec, mais l’opinion publique lui apparaît définitivement comme un matériau qu’il rêve de pétrir à sa guise. À l’âge de 27 ans, avec George Parker qu’il a côtoyé dans le cadre de la campagne présidentielle, il monte une agence, Parker and Lee. En quelques années, Ivy Lee va s’imposer comme l’un des pionniers du secteur.
Il se fait connaître au cours de l’année 1906, en gérant la communication d’une grande société impliquée dans une catastrophe de chemin de fer qui a fait de nombreuses victimes. Il met en application l’une de ses idées : plutôt que de faire le dos rond en évitant les journalistes, comme les entreprises en avaient l’habitude en semblable occasion, il adopte l’attitude inverse et diffuse activement auprès d’eux des informations préparées par ses soins pour qu’ils puissent remplir leurs colonnes. À l’époque, cette attitude est révolutionnaire. Elle présente l’intérêt d’imposer plus aisément le point de vue de l’entreprise en « facilitant » la rédaction des articles, voire le remplissage des journaux. Elle évite surtout que de nombreux journalistes aillent chercher eux-mêmes sur le terrain des témoignages et des informations dérangeantes. Certains journalistes ne se laissent pas manoeuvrer et l’accusent d’être un manipulateur. Il s’en défend en publiant une Déclaration de principes, dans laquelle il argue de sa « réelle volonté » d’informer le public et d’aider la presse « sans esprit partisan », il s’engage même à leur donner des mises à jour régulières et « tous les détails qu’ils souhaiteront ». La promesse ne résistera pas longtemps à la réalité, mais la majorité des journaux s’en contentera et de nombreux rédacteurs s’empresseront de reproduire le texte gracieusement envoyé. Ivy Lee vient tout simplement de lancer la culture du communiqué de presse et d’inventer le principe de base de la « gestion de crise ». Sa Déclaration restera gravée dans la mémoire des lobbyistes et sera souvent citée dans leurs futurs manuels de formation comme l’acte fondateur des « relations publiques ». Cent ans plus tard, en 2006, jour pour jour, des professionnels de la « communication de crise » y rendront hommage à l’occasion de la fête du centenaire (plutôt discrète) de leur discipline.
La société de chemins de fer dont il a géré si habilement la communication, la Pennsylvania Railroad Company, l’embauche à plein temps au sein de la direction. Avec lui, le « souci de la sécurité des voyageurs » devient l’une des vitrines de la compagnie.
En 1914, le puissant John D. Rockefeller, malmené par l’opinion publique pour ses méthodes anti-syndicales très offensives, obtient de la compagnie ferroviaire de leur emprunter quelque temps ce spécialiste des relations. Lors d’une grève dans une de ses compagnies, Rockefeller a fait intervenir des « briseurs de grève » et des policiers de l’État qui n’ont pas trouvé mieux que de tirer à la mitrailleuse sur les grévistes installés sur le site de production avec leurs familles. Douze enfants ont été fauchés, des ouvriers et leurs femmes. Avec ce massacre, Rockefeller est devenu très impopulaire et fait l’objet d’une campagne virulente qui le fragilise gravement. Pour redorer son blason, Ivy Lee le convainc de cultiver une image de bienfaiteur et l’incite à créer des fondations et des oeuvres de charité, à encourager la recherche pharmaceutique… Il vient, là encore, d’inaugurer un procédé nouveau. Stratagème dans lequel, bientôt, cigarettiers et alcooliers investiront à leur tour des sommes colossales, au demeurant très rentables.
Pour finir de ravaler l’image de Rockefeller, Ivy Lee met en exergue le montant impressionnant des impôts payés par sa famille et évoque les milliers d’ouvriers qu’il emploie. Il parviendra non seulement à redresser la situation mais à rendre le magnat du pétrole sympathique aux yeux des médias et d’une partie de l’opinion. Ce dernier fera à nouveau appel à ses compétences lors d’une autre grève dans ses mines de charbonnage où soixante-dix ouvriers ont perdu la vie suite à une opération répressive.
Ivy Lee aiguise encore ses procédés durant la Première Guerre mondiale, au service du gouvernement, pour mobiliser l’opinion publique en faveur de l’effort de guerre et fait apprécier son ingéniosité de propagandiste. Il lance aussi des campagnes publicitaires pour la Croix-Rouge qui permettent à l’organisation de multiplier les dons et les adhésions. Fort de ses succès, il fonde en 1919 une nouvelle agence : Ivy Lee & Associates. Deux ans plus tard, il devient membre du Conseil des relations étrangères des États-Unis.
Sans cesser de servir les intérêts de la compagnie ferroviaire, il loue ses talents aux alcooliers, aux cigarettiers et aux industries agroalimentaires. Il leur propose de mieux faire face aux enquêtes lancées par les autorités, aux mobilisations d’associations, aux investigations de la presse, aux crispations de l’opinion publique, aux mouvements syndicaux et aux crises liées à des fusions de groupes. L’une de ses stratégies les plus efficaces consiste à faire adopter aux entreprises des attitudes d’« écoute », voire de « soutien » suscitant la sympathie des interlocuteurs et les désarmant. Public et autorités y étant sensibles, il devient plus facile de leur faire accepter des délais, des promesses, des compromis et des alliances. Travestir les rapports de force permet d’instrumentaliser des adversaires et de les désunir au moment opportun. Yvy Lee développe aussi l’idée de diffuser des informations aux consommateurs sur les emballages de nourriture, non pour cultiver leur discernement mais pour renforcer leur confiance. Les industriels apparaissent ainsi plus conscients et plus soucieux que les consommateurs eux-mêmes des ingrédients qui composent leurs produits. Parallèlement, il favorise les alliances entre les compagnies pour qu’elles mènent ensemble des opérations de lobbying plus efficaces auprès des politiques.
Ivy Lee travaillera pour les plus grands noms de l’industrie et de la finance. Mais il connaîtra la disgrâce peu de temps avant sa mort, en novembre 1934, quand le Congrès américain décidera d’enquêter sur les missions qu’il a menées en 1933 pour le compte d’IG Farben, un groupe pharmacochimique qui a financé la campagne électorale de Hitler, et sur ses démarches pour favoriser une entente germano-américaine, tout particulièrement avec les grands groupes pharmaceutiques américains. Emporté par une tumeur cérébrale pendant cette enquête, Ivy Lee ne saura jamais que ce groupe sera aussi impliqué dans la production du Zyklon B (le gaz utilisé dans les chambres à gaz), et dans l’utilisation de cobayes humains dans les camps à des fins pharmaceutiques.
Edward Bernays ou la démocratie en fumée
« Eddie » pour les familiers, « Docteur Edward L. Bernays » pour la voix féminine qui, sur le répondeur téléphonique de son domicile, invite les interlocuteurs à laisser un message… Ce spécialiste de l’influence a la réputation d’être terriblement envoûtant, malgré sa petite taille et ses yeux malicieux qui invitent plutôt à l’ironie. « Médecin des relations sociales » comme il se définit lui-même, il ne cache pourtant pas ses aigreurs à l’idée que les ouvriers développent une « conscience sociale » et que les consommateurs s’organisent en associations…
Il assurera des consultations pour les entreprises, à 1 000 dollars l’heure, jusqu’aux derniers jours de sa vie, en 1995. Une vie débordante qui l’amène très tôt à conseiller les plus gros industriels américains et des hommes politiques de premier plan, tel le président des États-Unis, Calvin Coolidge, successeur républicain de Warren G. Harring (Calvin Coolidge est un partisan de la non-intervention du gouvernement dans les affaires, adepte du « laisser faire » et de la libre concurrence). Mais notre lobbyiste sera surtout l’âme damnée des barons du tabac dont il organisera les principales opérations d’influence jusque dans la deuxième moitié du XXe siècle.
On pourrait remplir une encyclopédie avec toutes les représentations symboliques qu’Edward Bernays réussira à placer entre le monde réel et la perception commune pour mieux vendre les produits de ses clients, en particulier les cigarettiers. Son parcours plus édifiant encore que celui d’Ivy Lee constitue selon les historiens une excellente initiation aux concepts fondateurs du lobbying, puisqu’il en fut précisément le professionnel le plus prolixe et qu’il a activement accompagné le développement de la communication d’influence tout au long du XXe siècle pour le compte des industries du tabac et de l’agroalimentaire. La notion même de « relations publiques » lui doit beaucoup. En 1991, quelques années avant de disparaître, il confiait dans un entretien filmé pour la BBC la raison pour laquelle il avait choisi cette expression après la première guerre mondiale : « La propagande avait mauvaise presse. Alors j’ai essayé de trouver un autre mot. Et on a trouvé Conseil en relations publiques. [8] »
Neveu de Sigmund Freud, Edward Bernays fut le premier à diffuser aux États-Unis les oeuvres du père de la psychanalyse. Mais son objectif n’est pas d’améliorer la santé mentale de ses compatriotes, ni de contribuer au succès de la psychanalyse en tant que thérapie. En fait, les découvertes de Freud lui apparaissent comme la voie royale pour… « moderniser » les relations des dirigeants et des foules. Certes, il n’oublie jamais de rappeler sa parenté avec l’illustre Viennois, mais c’est pour répéter qu’il faut appliquer la connaissance des lois de l’inconscient à la « gestion scientifique de l’opinion publique » et à la publicité. Il passe sous silence le fait que la psychanalyse consiste à faire émerger à la conscience les motifs cachés de nos comportements. Alors que Freud veut favoriser les prises de conscience et les libérations thérapeutiques, le lobbyiste utilise ce savoir pour produire sur l’opinion « l’impression voulue, le plus souvent à son insu », à « contrôler et mobiliser les consciences selon notre volonté sans qu’elles le sachent » au service d’un système de « gouvernement invisible » tenu par une élite [9].
L’élite qu’il veut servir, composée de politiques et de grands dirigeants d’entreprise est, selon Edward Bernays, à l’aube d’une nouvelle ère où les consommateurs pourront être contrôlés par une communication exploitant scientifiquement les ressources les plus profondes de l’inconscient. Il veut compléter ce système par une ingénierie des slogans et du consentement appuyée sur les connaissances apportées par les sciences sociales. Il va s’employer à creuser ce sillon et offrir à son « élite » des méthodes ad hoc.
Pour mieux faire connaître ses ambitions aux dirigeants d’entreprise, Edward Bernays publie d’abord deux livres, Cristallising Public Opinion (Fixer l’opinion publique), en 1923 [10], et Propaganda, en 1928 [11]. Il ne les a pas écrits pour qu’ils soient lus par le public mais par ses clients potentiels. En y exposant les vertus de son activité, il assure habilement son auto-promotion. Il y décrit les pouvoirs de son métier de « fabricant d’assentiment », et flatte généreusement l’ego des dirigeants d’entreprise en expliquant qu’ils sont voués à devenir l’élite intellectuelle et éthique de la nation. Il leur offre un avant goût des principes d’une manipulation collective des consciences et même les clés idéologiques qui leur permettront de dominer les autres et d’en tirer une jouissance sans culpabilité, avec le sentiment d’être investis d’une mission supérieure. Sa vision sociale les place au sommet de l’Olympe, si haut que la plèbe ne peut se représenter leur pouvoir qu’en rêve et les admirer. Il s’agit tout simplement d’une philosophie taillée sur mesure pour les nouveaux « maîtres du monde ».
Avec ces ouvrages, où la flagornerie le dispute à un machiavélisme modernisé non dénué de mégalomanie, il prend le risque de paraître ridicule. Cependant, comme le flatteur ne se propose pas de vivre aux dépens de ceux qu’il flatte mais de les enrichir adroitement et de renforcer leur puissance grâce à des techniques de manipulation savamment conçues, les dirigeants vont se l’arracher. À commencer par la firme de cigarettes Chesterfield et l’American Tobacco Company, laquelle regroupe alors la plupart des grandes marques de cigarettes.
Le système de représentation que leur apporte ce temple théorique et technique est celui qu’il leur fallait inconsciemment pour lever ce qui empêche tout homme de jouir plus intensément de sa situation : la séparation entre le moi et l’idéal du moi. Séparation ordinairement pénible et omniprésente dont Freud avait justement expliqué de façon lumineuse, dans Psychologie collective et analyse du moi, paru en 1921, comment on peut la dissoudre. La jouissance procurée par cette dissolution est l’une des bases secrètes du système de Bernays. Aux dirigeants et au public, il ne vend pas des services et des produits dont ils ont vraiment besoin, il vend la croyance qu’ils se sentiront mieux avec eux, des promesses symboliques de réconciliation, des aspirations collectives ou narcissiques. Sa marque de fabrique sera celle-là. Il crée une nouvelle façon de vendre les produits de consommation et... ses propres relations publiques. La cigarette conjuguera tout cela merveilleusement. Bientôt, les gens se définiront par la symbolique des produits qu’ils achèteront et ils confondront leur liberté avec cette consommation. Choisir sa marque de cigarettes et fumer va bientôt paraître indispensable pour exister, s’épanouir et réussir.
Au-delà des détournements de l’oeuvre de son oncle à des fins manipulatrices, parfois espiègles mais, hélas, jamais cathartiques, ses idées sont surtout inspirées par les spécialistes des « mentalités grégaires », dont Gustave Le Bon, auteur de Psychologie des foules [12]. Bernays est sensible aux descriptions affolantes que Le Bon fait des rassemblements populaires, décrites comme des hordes imprévisibles. Qu’il défende des thèses élitistes et racistes au passage ne sont pas pour le gêner. Par ailleurs, il n’accorde pas d’attention au regard critique que Freud porte sur les conceptions hautaines et répétitives des théoriciens de la psychologie de masse qui réduisent les foules et les « formations collectives » aux pires tendances au lieu de s’intéresser à leurs vertus. Edward Bernays sait que le lobbying se vend mieux en donnant une image redoutable du public, de l’opinion, du monde associatif et syndical.
Il est aussi très influencé par Walter Lippmann, à la fois penseur, journaliste et conseiller politique, à qui l’on doit le livre Public Opinion [13], paru en 1922. Lippmann y propose une approche de la subjectivité collective à travers les projections mentales, les stéréotypes, les croyances formant les préjugés. On ne peut bien gouverner, selon lui, qu’en employant les ressorts de l’opinion et ses faiblesses, ses haines, ses enthousiasmes et ses craintes irrationnelles. Il en appelle de la sorte à un gouvernement offrant un rôle inédit aux sciences sociales. L’ouvrage a été publié un an avant qu’Edward Bernays sorte son premier manifeste. En 1925, Lippmann sortira la suite de son oeuvre sur l’opinion publique, The Phantom Public où il exprimera ses convictions sur l’incapacité du public à gouverner, livre qui provoquera un débat célèbre avec le philosophe John Dewey, partisan du développement d’une démocratie active où l’implication citoyenne peut devenir source de maturation et de connaissance. Dans ce débat, se dessinent déjà les clivages que devront surmonter, à la fin du XXe siècle, les partisans d’une « démocratie sanitaire » où le rapport des citoyens à leur santé ne se réduirait plus à une passivité consumériste et à des fantasmes dictés par les publicités pharmaceutiques [14].
Creusant le même sillon, Harold Lasswell publiera Propaganda Technique in the World War, en 1927 [15], puis Bernays poursuivra avec Propaganda en 1928.
Le système de gouvernement que préconise Edward Bernays ressemble étrangement au tableau que dresse Alexis de Tocqueville, dès 1840, dans un texte devenu fameux où, en vrai démocrate, il nous met en garde contre le danger qui guette la société qui ne voit plus d’où vient le pouvoir : « Je veux imaginer sous quels traits nouveaux le despotisme pourrait se produire dans le monde ; je vois une foule innombrable d’hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs, dont ils remplissent leur âme. Chacun d’eux, retiré à l’écart, est comme étranger à la destinée de tous les autres : ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui toute l’espèce humaine ; quant au restant de ses concitoyens, il est à côté d’eux, mais il ne les voit pas ; il les touche mais ne les sent point ; il n’existe qu’en lui-même et pour lui seul (…). Au-dessus de ceux-là s’élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d’assurer leurs jouissances et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l’âge viril ; mais il ne cherche, au contraire, qu’à les fixer irrévocablement dans l’enfance. (…) Il ne brise pas les volontés, mais il les amollit, les plie et les dirige ; il force rarement d’agir, mais il s’oppose sans cesse à ce qu’on agisse ; il ne détruit point, il empêche de naître ; il ne tyrannise point, il gêne, il comprime, il énerve, il éteint, il hébète, et il réduit enfin chaque nation à n’être plus qu’un troupeau d’animaux timides et industrieux, dont le gouvernement est le berger. « En vain chargerez-vous ces mêmes citoyens, que vous avez rendus si dépendants du pouvoir central, de choisir de temps en temps les représentants de ce pouvoir ; cet usage si important mais si court et si rare, de leur libre-arbitre, n’empêchera pas qu’ils perdent peu à peu la faculté de penser, de sentir et d’agir par eux-mêmes, et qu’ils ne tombent ainsi graduellement au-dessous du niveau de l’humanité. J’ajoute qu’ils deviendront bientôt incapables d’exercer le grand et unique privilège qui leur reste. [16] »
À l’époque, Tocqueville ne peut pas encore imaginer que cette « tyrannie douce » puisse être délibérément obtenue par des professionnels de l’influence. Il ne voit pas qu’une minorité au pouvoir, usant de sa fortune et de ses positions acquises, puisse instrumentaliser les sciences sociales pour consolider son pouvoir. Certes, David Hume a déjà jeté les fondements conceptuels sur lesquels les sciences sociales pourront s’appuyer. Auguste Comte, qui a créé le mot « sociologie », rêve déjà de rebâtir la société sur des bases scientifiques, non sans céder à une forme de délire scientiste [17]. Mais la psychologie des foules et les sciences sociales, au stade des prémices, ne sauraient apparaître à l’observateur de la démocratie américaine comme l’outil possible d’une pareille domination. Tocqueville pense d’ailleurs qu’un contrôle aussi discret et général que celui qu’il brosse ne peut pas relever du pouvoir d’un despote mais du joug d’une opinion standardisée et se nourrissant d’un assentiment général de tous les instants. En cela, son cauchemar deviendra bien le doux songe de Bernays.
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, notre lobbyiste se fait donc d’abord remarquer par ses deux premiers ouvrages qui ne laissent paraître aucun état d’âme. Ses actions concrètes au service des cigarettiers ne laisseront pas paraître plus d’épaisseur morale. Pour amener les femmes à fumer, Edward Bernays lance un slogan particulièrement habile : « Faites le bon choix : dégustez une cigarette plutôt qu’un bonbon. » La formule fait mouche, elle attaque les femmes sur un sujet qui les préoccupe massivement : leur poids. Cette campagne sera couronnée de succès. L’industrie du tabac enregistrera une multiplication du nombre de fumeuses.
Sur la base d’une étude psychanalytique, il développe aussi l’idée que la cigarette ne doit plus seulement être un symbole de virilité mais qu’elle devienne aussi un attribut de l’érotisme féminin. Mieux : il veut en faire le symbole de la libération féminine. Pour cela, il organise à New York un retentissant défilé de jolies femmes fumant ce qu’il nomme les « torches de la liberté » et fait diffuser dans le monde entier des photos reprenant ce thème. Le tabac sera vendu à présent comme le produit qui nous rend indépendant. Le tour de force est complet. Il parviendra même à faire de la cigarette un signe de jeunesse et de vitalité.
Edward Bernays théorise également ce qu’il nomme le « rubber stamp ». Littéralement, le « tampon ». Ce dernier est l’une des formes les plus subtiles du slogan : il ne vise pas nécessairement à vanter un produit ou une entreprise mais à créer une image tenace entre l’intelligence collective et la réalité. Sous l’aspect d’une formule, il peut constituer un filtre, un détour, une digression interminable apparaissant comme une nécessité ou une aporie (question impossible à résoudre mais qui semble devoir être résolue avant d’aller plus loin). Ce n’est pas seulement le moyen de fixer l’attention mais de la « cristalliser » autour d’une obsession. Cette espèce d’ornière dans laquelle l’esprit retombe interminablement est une sorte d’équivalent rhétorique de ce qu’on appelle en psychanalyse une « image écran ». Nous verrons plus loin des exemples de « tampons » devenus de véritables « pensées écrans » qui constituent des obstacles épistémologiques au coeur même des débats juridiques ou législatifs.
Edward Bernays travaillera lui aussi pour des groupes agroalimentaires, notamment pour des produits qui suscitent des doutes. Il montera une stratégie pour les vendeurs de bacon, qui lui seront très reconnaissants de son impact commercial : après avoir fait réaliser un sondage auprès des médecins en leur posant des questions ambivalentes, il déclarera que ceux-ci recommandent sa consommation. Il affinera au fil des années cette technique consistant à utiliser des corporations ou des personnalités qui font autorité, avec ou sans leur collaboration consciente. Le procédé, comme les précédents, deviendra commun à la publicité et au lobbying. Il renouera ainsi avec ce qui a fait le succès du tabac au cours des siècles précédents, le concours de médecins et de leaders qui ne sont pas toujours assez méfiants ou qui sont parfois prêts à monnayer leur caution [18].
Malgré le caractère mercantile de ses missions, qui relèvent au fond d’une rouerie doublée d’un culot sans borne, Edward Bernays parviendra à apparaître auprès des historiens américains du lobbying comme le grand penseur de sa discipline, compte tenu de son héritage technique et des ouvrages qu’il a laissés. Le comble est atteint si l’on songe qu’il a réussi à passer auprès du grand public pour un défenseur de la liberté. Il est vrai qu’à l’instar des politiques et des dirigeants d’entreprises de son époque, il multiplie les professions de foi démocratique. Il lui serait difficile de faire autrement. Il n’est pas question de prendre le risque d’apparaître comme un lobbyiste liberticide. Mais, lorsqu’il s’adresse à ses pairs et à ses clients, il prétexte « le chaos qui guette les sociétés démocratiques » pour professer que la démocratie n’est viable qu’avec une élite « éclairée par les sciences sociales » qui doit « tirer les fils contrôlant l’esprit du public », piéger nos naïvetés et nos instincts grégaires. Véritable « fabrique du consentement », pour reprendre une de ses expressions, façonnage mental portant joyeusement la population vers les produits qu’elle doit consommer et lui faisant aimer les règles que les puissants fixent pour elle. Conditionnement et assentiment doivent remplacer la répression. Dans ce système, les mots « démocratie » et « liberté » doivent être répétés, ils ont ceci de bon qu’ils permettent de faire oublier à la collectivité qu’elle est tenue d’une main experte. Ces mots doivent contribuer à « dissimuler les données pertinentes » qui pourraient troubler l’opinion et de laisser s’exercer dans l’ombre le despotisme éclairé des rares intelligences. « Les minorités intelligentes doivent, en permanence et systématiquement, nous soumettre à leur propagande. Le prosélytisme actif de ces minorités qui conjuguent l’intérêt égoïste avec l’intérêt public est le ressort du progrès et du développement des États-Unis. [19] » Quant au reste du monde, il y viendra tôt ou tard, non par la guerre mais par l’économie et la puissance de la propagande. Bernays découvrira d’ailleurs que les guerres elles-mêmes peuvent être efficacement gérées par des lobbyistes [20]. Pareillement, il tient pour évident que les grandes entreprises privées sont naturellement portées à s’entendre avec l’élite politique et que l’intérêt commun trouve nécessairement à se concilier avec les intérêts particuliers, surtout à travers la consommation. L’idée que les inégalités sociales peuvent favoriser chez les privilégiés des comportements immoraux et des abus de toutes sortes n’affleure même pas dans les propos de notre « ingénieur des relations sociales ». Dans cette perspective, le citoyen doit devenir un consommateur dont les désirs seront en grande partie créés pour vendre les produits des grandes compagnies. Et les candidats aux élections choisis par l’élite devront désormais se vendre aussi comme des marques de cigarettes. La politique elle-même devra se réduire, pour la population, à des actes d’assentiment commandés par des campagnes exploitant uniquement le registre symbolique à travers des images et des slogans étudiés pour leur impact inconscient.
Edward Bernays était-il dupe de son propre idéal ? Il plaidera plus tard la naïveté devant les ravages du tabac, en prétendant qu’il avait ignoré sa nocivité. Notre « négociant en réalités », comme il aimait se définir lui-même, n’avait pas non plus prévu ce que ses principes pourraient devenir entre les mains de dirigeants prêts à franchir les limites de l’abomination. Faut-il s’étonner que Joseph Goebbels, le ministre de la propagande nazie, ai fait son miel d’Edward Bernays ? Le jour où, en 1933, le lobbyiste américain apprit que Goebbels se servait de ses livres pour planifier des campagnes contre les Juifs, il déclara qu’il tombait des nues. « Cette nouvelle me choqua », écritil dans son autobiographie [21]. On le serait à moins.
Hill and Knowlton : le lobbying de gestion de crise
Le cas de John W. Hill et de son agence permet également de découvrir les premières articulations du lobbying avec les questions sanitaires posées par le tabac. Lui aussi a commencé par exercer le métier de journaliste. Il est même devenu rédacteur en chef et chroniqueur financier avant de fonder Hill & Knowlton, en 1927, avec Donald Knowlton. Connue sous le sigle H & K, cette agence a conquis sa première clientèle auprès des banques et des dirigeants de l’acier. Malgré la crise de 1929, H & K connaît une croissance fulgurante. En 1937, John Hill crée une « élite de professionnels des relations publiques », dont fait partie Edward Bernays. Sans complexe, ce groupe prend le nom de The Sages. La Seconde Guerre mondiale permet à John Hill de consolider ses relations avec les plus grandes entreprises de l’acier, les fabricants d’avions, la construction navale et les compagnies pétrolières. Il formulera des recommandations pour le projet Manhattan (destruction atomique d’Hiroshima et de Nagasaki) et le début du programme nucléaire civil des années 1940 et des années 1950, mais les activités de ce club très privé resteront secrètes pour l’essentiel.
À partir des années 1950, conseillée par le directeur de la CIA, Allen Dulles, H & K implante un réseau de filiales partout dans le monde, notamment dans les pays de la Communauté économique européenne. Elle représente la première tête de pont du lobbying américain auprès des pères de l’Europe et de ses nouvelles instances, suivie par l’agence Burson- Marsteller qui s’occupera de nombreuses affaires explosives en termes de santé publique [22]. Le gouvernement laissera H & K réorganiser les services de presse de la Maison Blanche après l’élection du Président Eisenhower. Les autorités américaines lui confieront de nombreuses missions nationales et internationales et en feront finalement leur agence de référence sur toute la surface du globe.
Les cigarettiers utilisent abondamment les services de H & K. Entre 1950 et 1953, la publication des premières études scientifiques mettant en relation la progression des cancers et le tabagisme pousse les plus grands fabricants de cigarettes américaines de l’époque – Brown & Williamson, Lorillard, Philip Morris et RJ Reynolds – à consulter H & K pour « gérer la crise ». La situation les préoccupe d’autant plus sérieusement qu’ils observent que de nombreux chercheurs se penchent sur le rôle du tabac dans l’apparition d’autres maladies graves. Ils vont s’employer à neutraliser l’émergence de cette recherche par de nouvelles stratégies. Les lobbyistes doivent gérer la plus grande crise sanitaire qu’ils ont jamais connue. H & K crée et peaufine des techniques de lobbying dans cet objectif. Il s’agit, par exemple, de susciter des controverses brouillant la représentation de ce qu’est la santé, de ce qui permet de la maintenir, des facteurs de maladie, etc. Dans des stratégies de ce genre, la circulation d’anecdotes inventées peut jouer un rôle déterminant. On retrouvera une note d’un lobbyiste de H & K écrivant : « Les histoires les plus décisives sont celles qui sèment le doute sur la cause de la maladie et sur l’effet du tabagisme » [23]. On lit dans la même note une série de mots d’ordre pour noyer le débat dans la polémique, distiller le doute et rendre le dossier filandreux : « Controverse ! Contradiction ! Autres facteurs ! Inconnues ! » L’agence réfléchit aussi aux moyens de gérer l’indignation populaire et de continuer à multiplier les fumeurs. Par ailleurs, elle définit des axes d’action pour assurer l’impunité des industriels du tabac face à d’éventuels procès.
Un cadre de la même équipe résumera en une phrase sa conception de la gestion de crise quand le problème concerne la santé publique : » Il n’y a qu’un seul problème – la confiance et la façon de l’établir ; rassurer le public et comment maintenir les choses dans la durée tant que des doutes scientifiques peuvent subsister. »
L’année suivante, H & K crée la Tobacco Industry Research Committee (qui s’appellera plus tard Council for Tobacco Research). Cette structure de lobbying qui se donne les apparences d’un conseil d’expertise scientifique lance une campagne dans plus de 400 journaux américains avec des annonces couvrant des pages entières. Sous le titre « Une déclaration honnête aux fumeurs », elle donne aux lecteurs l’assurance que les fabricants de cigarettes prennent leurs responsabilités très au sérieux et elle promet de gros investissements pour financer une « recherche indépendante » sur les implications sanitaires du tabac, aux côtés des autorités sanitaires. Pour réduire les suspicions émises sur sa crédibilité, elle embauche un médecin très réputé qui dirige alors la Fondation américaine pour la prévention du cancer. Ce dernier fait la promesse qu’en cas de vérification de la cancérogénicité des cigarettes, le Comité se « donnerait pour priorité de déterminer comment éliminer le danger du tabac ».
H & K intervient aussi, en 1958, dans la création de l’Institut du Tabac. Ce sera, de l’avis même des spécialistes du lobbying, une des plus efficaces machine d’influence jamais conçue en matière de crise sanitaire. Mise en cause dans le cadre des procès américains contre les cigarettiers et leurs mensonges, H & K jouera un rôle décisif dans la négociation avec les autorités américaines, en 2005, pour s’accorder sur un échelonnement de 280 milliards de dollars de dommages et intérêts en échange d’un abandon des poursuites.
Pour optimiser son influence dans tous les secteurs, de façon plus générale, H & K recrutera activement du personnel gouvernemental et politique possédant de solides carnets d’adresses, comme Gordon Gray, secrétaire de presse du Président Eisenhower, ami de Richard Nixon et organisateur de la campagne présidentielle de Ronald Reagan. Il placera aussi ses propres hommes au sein de la haute administration ou auprès des dirigeants, comme Howard Paster, qu’on voit alternativement à la direction de H & K, au bureau de Washington DC, au rang de chef de la Maison Blanche, avant de revenir à la tête de H & K. On peut citer beaucoup d’autres habitués des allers-retours entre les plus hautes instances du gouvernement et chez H & K, comme Thomas Hoog, Lauri Fitz-Pegado, Craig L. Fuller, Frank Mankiewicz...
En 1987, dix ans après la mort de John Hill, le conglomérat de communication WPP Group absorbe son agence, sans lui enlever son nom. Des scandales à répétition à la fin du XXe siècle entraîneront des conflits entre ses dirigeants et la feront rétrograder en troisième position derrière les agences Fleishman- Hillard et Weber Shandwick Worldwide. Ces affaires révéleront des implications de H & K dans des missions pour l’Église de Scientologie, et d’autres organisations en perte de vitesse dans l’opinion publique. Sérieusement éclaboussée, elle retrouvera tout de même une forte croissance sous la direction de Howard Paster dans les années qui suivront et restera l’agence de lobbying la plus recherchée pour son savoir-faire dans le domaine de la gestion de crise.
La similitude des techniques employées au service des cigarettiers et des gouvernements est frappante. Notons, par exemple, que la famille royale koweïtienne utilisera les compétences de H & K au début des années 1990 pour affiner les « arguments de vente » de la première guerre du Golfe aux Américains réticents et pour en assurer sa promotion auprès des gouvernements des autres pays. À cette fin, l’agence créera des associations pour le « Koweït libre », distribuera d’innombrables T-shirts et autocollants portant le slogan « Free Koweït », multipliera les conférences de presse dénonçant les privations de liberté des Koweïtiens et toutes sortes d’abus terrifiants de l’armée irakienne qui convaincront l’opinion qu’il faut envoyer les soldats occidentaux. Il est sidérant qu’on puisse simplement retrouver les mêmes slogans et les mêmes actions pour les campagnes en faveur du tabac : création d’associations pour la liberté de fumer, T-shirts et autocollants portant des slogans du type « Free Smoking », conférences de presse dénonçant les privations de liberté des fumeurs et les « abus du lobby des anti-fumeurs ».
L’agence interviendra dans la gestion de nombreux scandales qui marqueront la seconde moitié du XXe siècle et de la décennie suivante : l’accident nucléaire de Three Mile Island, la marée noire en Alaska causée par l’Exxon Valdez, et pour contrer les mises en cause de nombreux pays pour non respect des droits de l’homme (Égypte, Haïti, Indonésie, Maldives, Maroc, Turquie…). Elle gérera même le redressement de l’image de la Chine après le massacre de la place Tiananmen. D’aucuns estiment que prendre en charge de tels dossiers n’est pas en soi immoral tant que les moyens utilisés ne le sont pas, mais l’opinion publique internationale ressentira un trouble légitime à l’idée qu’une société de lobbying engrange les missions de gestion de crises liées aux répressions politiques aussi bien que les missions visant les crises sanitaires, écologiques ou financières. Après le scandale du groupe Eron de 2002, son image souffrira à nouveau quand l’opinion apprendra qu’elle a travaillé également pour cette société.
L’agence apportera sa contribution dans le montage d’opérations contre toutes sortes de projets de lois faisant valoir des impératifs sociaux ou environnementaux qui, selon elle, présentent des risques de restriction du commerce et de l’investissement international. Elle organisera de nombreuses opérations de parrainage et de marketing sportifs, des stratégies pour des laboratoires pharmaceutiques mis en cause, etc. Au-delà des cigarettes, on retrouve H & K dans des dossiers de santé publique particulièrement sensibles, comme la stratégie de défense d’industriels commercialisant de nombreux produits amiantés. Une procédure judiciaire lancée par l’État de Baltimore contre le producteur US Gypsum dans les années 1980 a montré que H & K avait décidé d’assurer une veille détaillée de la presse, de mobiliser des scientifiques et des médecins en tant qu’« experts indépendants » pour rassurer le public sur les effets de l’amiante, et de faire pression sur les médias.H & K indiquait le principe de cette stratégie en notant que les industriels devaient viser à créer le sentiment d’un « non-événement » [24].
On retrouve encore l’agence dans la défense de la Bank of Credit and Commerce International (BCCI) au coeur d’une tourmente concernant des blanchiments d’argent de la drogue du cartel de Medelin et des trafics d’armes. H & K a également lancé une vaste campagne contre le droit à l’avortement, pour le compte de la Conférence nationale des évêques catholiques, une mission payée cinq millions de dollars. H & K a aussi oeuvré pour le compte de Monsanto afin que la FDA autorise l’hormone de croissance bovine génétiquement modifiée et que le législateur n’impose pas l’obligation d’étiqueter le lait produit par les animaux concernés. L’agence a cherché à obtenir la même autorisation au Canada pour les hormones de Monsanto en intervenant directement auprès des hauts fonctionnaires de la santé. Mais une enquête du Sénat canadien a fait échouer l’opération en révélant que les scientifiques de Santé Canada qui travaillaient sur ces hormones avaient subi d’importantes pressions par leurs tutelles pour taire leurs préoccupations sur la sécurité de ces produits.
Notes
[1] A. McGuire, « Cigarettes and Fire death »(Cigarettes et décès par le feu), Journal of Medicine, vol. 83, Dec. 1983, pp 1296-1298. Et Prévention nationale des incendies, 1981, Incidence Reporting System (NFIRS) et Federal Emergency Management Agency (FEMA).
[2] De l’ordre de 400 millions de dollars pour les seules pertes de biens annuels liées aux incendies par le tabac, selon la National Fire Protection Association.
[3] En mars 1974, par exemple, le sénateur américain Phil Hart avait défendu un projet de loi sur le sujet, mais il a été repoussé en commission par la Chambre des représentants. En 1979, Joe Moakley, après la mort d’une famille de sept personnes dans un incendie par cigarettes dans son district, présentait vainement un projet de loi exigeant que les cigarettes puissent s’éteindre quand elles ne sont plus aspirées. En 1980, le sénateur Alan Cranston défendait un projet de loi allant dans le même sens…
[4] tobaccodocuments.org/product_design/508509884-9888.
[5] National Institute of Standards and Technology.
[6] Voir, par exemple, Info-tabac, Revue pour un Canada sans fumée, n° 25, janvier-février 1999.
[7] Richard Pollay, « Propaganda, Puffing and the Public Interest », in Public Relations Review, vol. 16, n° 3, 1990, p. 40.
[8] The Century of the Self, A. Curtis, BBC Four, 2002.
[9] Edward Bernays, Propaganda, Kennikat Press, Port Washington, (reedit. de Propaganda New York, 1928, pp. 47-48, 1972). Ou éd. Zones, Paris, 2007, pp. 76 et 39.
[10] Edward Bernays, Crystallizing Public Opinion, New York, 1923.
[11] Edward Bernays, Propaganda, op.cit.
[12] Gustave Le Bon, Psychologie des foules, 1895.
[13] Walter Lippmann, Public Opinion, Londres, Allen & Unwin, 1922.
[14] Pour une problématisation de ce débat depuis la moitié du XXe siècle, voir Droits des maladies Vers une démocratie sanitaire ?, La documentation Française, n° 885, février 2003, dossier réalisé par Michèle Guillaume-Hofnung.
[15] Harold Lasswell, Propaganda Technique in the World War, New York, Knopf, 1927.
[16] Alexis de Tocqueville , De la démocratie en Amérique, 1840.
[17] Il a commencé à publier son Cours de philosophie positive en 1830.
[18] Voir chapitres précédents : La panacée universelle et L’État succombe à la tentation.
[19] Edward Bernays, Propaganda, édit. Zone, 2007, p.47.
[20] Voir chapitre suivant : « Hill & Knowlton : le lobbying de gestion de crise ».
[21] Edward Bernays, The biography of an Idea – Memoires of public relation counsel Edward Bernays, New York, Simon and Schuster, 1965, p. 652 .
[22] Burson-Marsteller a particulièrement attiré l’attention des observateurs spécialisés quand l’Union Carbide fit appel à ses services pour gérer ses relations publiques après la catastrophe de Bhopal en 1984.
[23] Archives américaines citées dans Le Rideau de fumée…, op. cit.
[24] Alicia Mundy, Columbia Journalism Review, Sept./Oct. 1992.