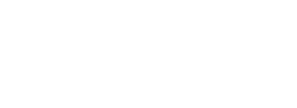Intranet
Accueil > Développement soutenable > Pour un monde durable > La Bio peut-elle nourrir durablement la planète (...) |
Dossier "Pour un monde durable", magazine Biocontact novembre 2010 La Bio peut-elle nourrir durablement la planète ?Un article de Marc DUFUMIER Mardi 2 novembre 2010 L’agriculture biologique est réputée fournir des aliments sains, sans hormones de croissance ni résidus de pesticides, et préserver l’environnement. Mais il lui est souvent reproché de ne pas être assez productive. Trop chers, les produits bio ne seraient pas accessibles aux plus modestes. Pire, ils ne pourraient pas nourrir durablement la population mondiale. Qu’en est-il réellement ? |
La faim dans le monde
Les populations insuffisamment nourries ne parviennent pas à se procurer les aliments disponibles sur le marché mondial, faute d’un pouvoir d’achat suffisant, alors même que des quantités considérables de céréales et de protéagineux trouvent preneurs auprès des fabricants d’aliments du bétail et des usines d’agrocarburants. Ainsi en est-il chez nous des gens qui fréquentent régulièrement les Restaurants du cœur. Mais ainsi en est-il aussi et surtout des millions de personnes sous-alimentées vivant dans les grands pays du Sud qui exportent leurs surplus de grains et de viande sur le marché international : l’Inde, le Brésil, l’Argentine…
Le paradoxe est que ces pauvres qui ne parviennent pas à s’alimenter correctement sont pour deux tiers des agriculteurs. Et le dernier tiers est constitué de populations autrefois agricoles qui, faute d’être restées compétitives sur le marché mondial, ont dû quitter prématurément leurs campagnes et migrer vers des bidonvilles sans pour autant y trouver d’emplois rémunérateurs.
Ce n’est pas en exportant à vil prix nos surplus de céréales, sucre, poudre de lait et viandes vers les pays du Sud que nous pourrons résoudre la question alimentaire à l’échelle mondiale. Mais en créant les conditions qui permettront aux paysanneries pauvres du Sud de dégager des revenus suffisants pour à la fois satisfaire leurs besoins essentiels et investir dans l’amélioration de leurs systèmes de culture et d’élevage. Les Européens seraient quant à eux bien inspirés de cesser la surproduction de denrées standard difficilement exportables et de réorienter leur agriculture vers la fourniture de produits de plus grande qualité gustative et sanitaire, en réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre et sans causer de dommages à leur environnement.
Le défi du Sud
Du fait d’une pression démographique encore importante et de l’émergence de nouvelles classes moyennes, on peut prédire un doublement en 40 ans des productions de grains, tubercules et autres produits amylacés, dans les pays du Sud, pour espérer satisfaire la demande croissante en aliments de plus en plus variés. La demande en produits animaux (lait, œufs, viandes…) ne cesse en effet de s’accroître dans plusieurs pays émergents (Inde, Chine, Brésil…).
La FAO [1] estime que sur les 4,2 milliards d’hectares pouvant être cultivés dans le monde, seul 1,5 milliard l’est en fait de nos jours. Mais on observe depuis peu une extension accélérée des superficies dédiées à l’agriculture ou à l’élevage dans de nombreux pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. En témoignent les défrichements pour implanter du soja ou de la canne à sucre au Brésil et l’élargissement phénoménal des plantations de palmiers à huile en Indonésie et en Malaisie. Ce développement des surfaces, destinées pour l’essentiel à l’alimentation du bétail ou à la production d’agrocarburants, n’est pas le fait de paysans pauvres en manque d’équipements et de pouvoir d’achat mais résulte davantage du recours à des engins motorisés. Cette mécanisation se traduit par une accélération de l’exode rural et ne contribue en rien à résoudre la question de la pauvreté et de la sous-nutrition dans le monde. Les surfaces nouvellement défrichées le sont aux dépens de savanes et de forêts, avec le risque de la disparition d’écosystèmes riches en biodiversité.
Le plus urgent sera de s’assurer que les familles paysannes travaillant à leur compte dans le Sud puissent accroître progressivement leurs productions et leurs revenus à l’hectare, en faisant un usage toujours plus intensif des ressources naturelles renouvelables disponibles (énergie lumineuse et dioxyde de carbone atmosphérique, azote de l’air, eaux pluviales…) et en diminuant le recours aux énergies fossiles et aux produits chimiques de synthèse. Ces formes d’agriculture paysanne devront être créatrices d’emplois et ne pas rejeter les agriculteurs sur les marchés du travail où prédomine encore un chômage chronique.
Les erreurs de la « révolution verte »
Il faudra pendant longtemps encore produire davantage à l’hectare dans les pays du Sud. Mais il ne s’agira surtout pas de reproduire à l’identique les systèmes mis en œuvre dans ce qu’on a un peu trop vite qualifié de « révolution verte » : emploi d’un nombre limité de variétés de céréales, légumineuses et tubercules à haut rendement, sensibles aux stress hydriques, gourmandes en engrais minéraux et peu tolérantes ou résistantes aux insectes prédateurs et agents pathogènes. Depuis quelques années déjà, malgré leur haut potentiel génétique, les rendements obtenus avec ces cultivars n’augmentent plus dans les mêmes proportions et tendent même parfois à baisser, lorsque sont apparus de graves déséquilibres écologiques : prolifération d’insectes prédateurs résistants aux pesticides, multiplication d’herbes adventices dont les cycles de développement sont apparentés à ceux des plantes trop fréquemment cultivées (sans véritable rotation), épuisement des sols en certains oligoéléments, salinisation des terrains mal irrigués et insuffisamment drainés…
Plutôt que de vouloir à tout prix conformer les agro-écosystèmes aux exigences de variétés végétales ou races animales à haut rendement et prendre ainsi le risque de les simplifier et de les fragiliser, il vaut mieux inciter les agriculteurs à ajuster leurs techniques de production aux conditions écologiques de leur région : adaptation aux sols, aux microclimats et à la présence éventuelle d’insectes prédateurs, d’agents pathogènes et de plantes adventices. Les agriculteurs tireraient profit des cycles de l’eau, du carbone, de l’azote et des autres éléments minéraux, en sélectionnant au sein de leurs propres écosystèmes les espèces, races et variétés les plus à même de produire les calories alimentaires, protéines, vitamines, minéraux, fibres textiles et molécules médicinales dont la société a le plus besoin.
Des alternatives existent
Des techniques agricoles inspirées de l’agroécologie permettent déjà d’accroître les rendements à l’hectare dans la plupart des régions du monde, sans coût majeur en énergie fossile ni recours intensif aux engrais de synthèse et aux produits phytosanitaires. Elles consistent en premier lieu à associer dans un même champ, ou y faire suivre systématiquement, diverses espèces et variétés aux physiologies différentes (céréales, tubercules, légumineuses, cucurbitacées…), de façon à ce que l’énergie solaire puisse être au mieux interceptée par leur feuillage et transformée en calories alimentaires au moyen de la photosynthèse. Ces associations et rotations contribuent à recouvrir très largement les terrains cultivés, pendant une durée la plus longue possible, avec pour effet de les protéger de l’érosion, limiter la propagation des agents pathogènes et minimiser les risques de mauvais résultats en cas d’accidents climatiques.
L’intégration de plantes de la famille des légumineuses (haricots, fèves, pois, lentilles, vesce, trèfle, luzerne…) dans les associations et les rotations culturales permet de fixer l’azote de l’air pour la synthèse des protéines et la fertilisation des sols. La présence d’arbres d’ombrage au sein des parcelles cultivées ou le maintien de haies vives sur leur pourtour protège les cultures des grands vents et d’une insolation excessive et crée un microclimat favorable à la transpiration des plantes cultivées, la photosynthèse et la fixation de carbone. Les arbres et arbustes hébergent aussi de nombreux insectes auxiliaires des cultures qui favorisent la pollinisation de celles-ci et contribuent à limiter la prolifération d’éventuels insectes prédateurs. L’association des élevages à l’agriculture facilite l’utilisation des sous-produits végétaux dans les rations animales et favorise la fertilisation organique des sols.
Outre l’azote, les plantes cultivées doivent trouver aussi dans les sols un certain nombre d’éléments minéraux indispensables à leur croissance et à leur développement : phosphore, potassium, calcium, magnésium, oligoéléments… L’épandage d’engrais de synthèse vise alors à restituer aux sols les éléments minéraux qui en ont été extraits par les plantes. Mais on peut craindre l’amenuisement progressif des mines dont on retire les minerais à l’origine de leur fabrication. D’où l’intérêt à implanter au sein des parcelles ou à leur lisière des arbres et arbustes à enracinement profond, capables d’intercepter les éléments minéraux dans les sous-sols, au fur et à mesure de la décomposition de la roche mère (hydrolyse des silicates). Transférés dans la biomasse aérienne des arbres et arbustes, ces éléments minéraux sont ensuite déposés à la surface des terrains lors de la chute des feuilles et branchages et peuvent alors contribuer à leur fertilisation.
Promouvoir l’agriculture paysanne
Les obstacles à l’élévation de la productivité agricole dans les pays du Sud, dans le plus grand respect de l’environnement, ne sont souvent pas tant d’ordre technique que de nature socio-économique ; ils résultent bien plus fréquemment d’un accès limité aux crédits, de conditions imposées par les entreprises en amont ou en aval, de structures agraires injustes, de législations foncières inadéquates et des conditions inégales de la concurrence sur les marchés mondiaux.
Les paysans les plus pauvres de la planète n’ont pas souvent accès aux moyens de production qui leur permettraient d’associer davantage l’élevage aux productions végétales de façon à recycler au mieux leurs résidus de culture, fabriquer du fumier et assurer pleinement la fumure organique des terrains. De même leur manque-t-il cruellement les équipements nécessaires au maniement et au transport des pailles, fourrages, fumiers et composts : râteaux, fourches, charrettes, traction animale, bêtes de somme… L’urgence serait de leur permettre d’avoir enfin accès à ces animaux et équipements ; mais pour cela, il faut d’abord résoudre la question de l’inégale répartition des ressources (terres agricoles, équipements, capital circulant…) et de l’insuffisance dramatique des revenus paysans.
La mise en œuvre des pratiques inspirées de l’agroécologie dans les pays du Sud suppose aussi que leurs paysanneries puissent jouir d’une plus grande sécurité foncière, de façon à pouvoir bénéficier des fruits de leurs efforts sur le long terme. Cette sécurité peut être assurée sans nécessairement passer par une appropriation privative (souvent le meilleur moyen de priver les paysans pauvres d’un accès à la terre), mais va en tout cas à l’encontre des tendances actuelles à l’accaparement du foncier qui ressortent à la fois de la panique de certains Etats et firmes multinationales soucieux de garantir leurs approvisionnements agroalimentaires et d’une croyance dans la supériorité du modèle latifundiaire. La sécurité des approvisionnements pourrait être bien mieux assurée par la contractualisation des achats de productions végétales et animales auprès de producteurs travaillant pour leur propre compte, plutôt que de miser sur l’extension croissante de très grandes entreprises agricoles capitalistes pilotées par des objectifs de maximisation du taux de profit et de minimisation des coûts salariaux.
Les paysanneries du Sud ne pourront enfin financer et mettre en œuvre par elles-mêmes des systèmes de production agricole à la fois plus productifs et plus respectueux de l’environnement que si leurs gouvernements sont à même de faire ce que l’Europe a entrepris avec succès au lendemain de la deuxième guerre mondiale : protéger leur agriculture vivrière de l’importation de produits en provenance des puissances excédentaires par des droits de douane conséquents, de façon à garantir des prix agricoles suffisamment rémunérateurs, incitatifs et stables, aux paysans. Mais il nous faut alors être conséquents et ne plus vouloir exporter à tout prix des excédents de produits « tout-venant » en direction des nations les plus pauvres du monde.
En Europe
Ne serait-il pas plus avantageux pour les Européens de cesser d’exporter des céréales, du sucre et de la poudre de lait, à bas prix, et de produire plus de protéagineux (soja, lupin, pois fourrager…) dont ils sont devenus très largement importateurs du fait de leur moindre protection aux frontières ? Les élevages industriels de porcs, de volailles, et même de ruminants, sont en effet devenus très dépendants de l’importation de soja ou tourteaux de soja transgénique destinés à l’alimentation animale. Ne conviendrait-il pas non plus de s’interroger sur le bien-fondé d’une politique destinée à exporter à tout prix des produits standard ? Ne conviendrait-il pas plutôt de favoriser la production de denrées de grande qualité gustative et sanitaire dont les paysans européens pourraient alors tirer de meilleurs prix, tant sur les marchés intérieurs qu’à l’exportation ?
Rappelons que les rendements céréaliers français sont déjà deux fois supérieurs à ceux des Etats-Unis et trois fois plus élevés qu’en Ukraine, mais que cela résulte d’un emploi beaucoup plus intensif en engrais de synthèse et en produits phytosanitaires dont la fabrication est fort coûteuse en énergie fossile et dont l’emploi exagéré cause de graves dégâts environnementaux.
A l’heure où il faut réduire de toute urgence les émissions de gaz à effet de serre, la PAC rénovée devra encourager la mise en œuvre des systèmes de culture les plus économes en carburant et les moins exigeants en engrais de synthèse dont la fabrication est coûteuse en énergie fossile et dont l’épandage est à l’origine d’émission de protoxyde d’azote. L’Europe serait bien plus inspirée de promouvoir désormais en son sein des formes d’agriculture artisanales plus respectueuses de l’environnement, de façon à mettre davantage à profit les potentialités écologiques de ses terroirs et fournir des produits de plus haute valeur ajoutée : avec son cahier des charges exigeant et ses procédures de certification agréées par l’Etat, l’agriculture biologique est la plus à même de répondre à ces exigences.
L’agriculture bio au service de l’environnement
Les producteurs qui respectent le cahier des charges de l’agriculture bio ont su déjà mettre au point des systèmes de production permettant la cohabitation durable, dans certaines de nos campagnes, d’un grand nombre d’espèces, races et variétés, domestiques et spontanées. Ces systèmes associent fréquemment agriculture et élevage et contribuent aujourd’hui à fournir des produits fermiers, biologiques et de terroir, tout en favorisant le recyclage des matières organiques au sein même des exploitations, le stockage du carbone sous la forme d’humus dans les sols, une couverture végétale maximale des terrains, le maintien de prairies permanentes enrichies en légumineuses, la transformation locale des produits et des économies substantielles en eau et carburant. Ils font souvent preuve d’une grande efficacité en matière de rendement calorique et protéique à l’hectare, tout en limitant les consommations d’énergie fossile et en s’interdisant l’emploi d’engrais chimiques et de produits phytosanitaires de synthèse.
Les agriculteurs européens devront s’efforcer de valoriser au mieux les ressources naturelles renouvelables auxquelles ils peuvent avoir aisément accès dans leurs exploitations : l’énergie solaire et le gaz carbonique de l’atmosphère pour les besoins de la photosynthèse, l’azote de l’air pour la fabrication des protéines, les éléments minéraux libérés par la décomposition des roches du sous-sol pour la fertilisation des terres arables… Les rayons du soleil vont devoir être interceptés au maximum par les plantes cultivées ; et pour capter au mieux le gaz carbonique, en séquestrer le carbone et transformer au mieux l’énergie lumineuse en calories alimentaires (amidon, sucres…) ou en autres produits carbonés (cellulose, lignine…), celles-ci devront continuer d’avoir des échanges gazeux avec l’atmosphère. Ce qui suppose qu’elles soient en état de transpirer pendant longtemps et signifie qu’elles devront être correctement alimentées en eau, sans être exposées à une insolation extrême et à des vents desséchants.
Bien rémunérer les producteurs bio
Ces formes d’agriculture se révèlent plus exigeantes en travail et ne pourront être développées que si les producteurs sont assurés de bénéficier de prix suffisamment incitatifs, quitte à mettre en place des procédures de certification, labellisation et indication géographique protégée. En effet, c’est bien plus par une politique de prix rémunérateurs que par des subventions directes qu’on pourra inciter les agriculteurs à pratiquer des systèmes de production vraiment « durables » et à mettre pleinement en valeur la diversité des terroirs et des conditions écologiques de leurs « pays », en assurant la transformation locale de leurs productions fermières et en les commercialisant en circuits courts.
Favoriser l’accroissement de la demande en produits bio permettra à leurs circuits de commercialisation d’atteindre la taille critique nécessaire pour garantir leur pérennité. D’où l’intérêt de redéployer progressivement le montant des aides, versées de nos jours directement aux exploitants, sous la forme de « droits à paiement unique », au profit de la restauration collective (cantines scolaires, restaurants universitaires, repas hospitaliers, restauration d’entreprises…), moyennant le respect d’un cahier des charges bio. Ces montants retourneraient bien sûr aux producteurs, mais dorénavant sous la forme de prix plus rémunérateurs pour ceux qui accepteraient de répondre aux nouveaux cahiers des charges, tout en permettant aux couches sociales les plus modestes, qui fréquentent davantage la restauration collective, d’avoir accès à cette alimentation de qualité, à coût égal et à pression fiscale constante.
Cette réorientation vers des formes de production plus durables et artisanales mettrait fin à nos surplus récurrents de produits « tout-venant » que nous ne parvenons à exporter vers les pays pauvres qu’à des prix subventionnés. Elle permettrait alors aux peuples du Sud de protéger leurs propres agricultures vivrières par des droits de douane conséquents. La défense d’une agriculture bio, respectueuse de l’environnement et soucieuse de la qualité de nos aliments en Europe, n’est en rien contradictoire avec le droit des nations du Sud de reconquérir leur sécurité et souveraineté alimentaires.
Professeur d’agriculture comparée et développement agricole à AgroParisTech.
Extraits d’un article écrit par l’auteur en vue d’un séminaire dédié à l’agriculture biologique qui aura lieu le 19 novembre 2010 à la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire. Article complet téléchargeable sur www.agrilianet.com, rubrique « Publications », domaine « Agrobiologie ».
| LIRE
|
Notes
[1] Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture