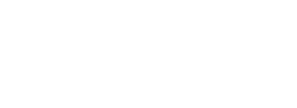Intranet
Accueil > Points de vue & interviews > Interview d’Eliane Viennot, professeuse de lettres et (...) |
Interview d’Eliane Viennot, professeuse de lettres et historienne : le genre et la langue françaiseVendredi 8 mars 2019 Dans cette interview, Eliane Viennot, professeuse de lettres et historienne, autrice de plusieurs ouvrages sur le genre et la langue française, donnait son point de vue sur le refus de l’Académie française de la féminisation de noms de métiers et de fonctions. Deux ans plus tard, coup de théâtre : l’Académie publie un rapport "La féminisation des noms de métiers et fonctions", où elle revient sur ses positions. A cette occasion, nous avons de nouveau interrogé Eliane Viennot. |
Télécharger le rapport de l’Académie "La féminisation des noms de métiers et fonctions" >>>>. Site de l’Académie
Féminisation des noms de métiers et fonctions, du nouveau du côté de l’Académie ?
D’une manière générale, que pensez vous de ce rapport ?
Il est fort long et fort verbeux pour le peu qu’il a à dire – à savoir qu’il lève le veto de l’Académie sur l’usage des noms féminins qu’elle proscrivait jusqu’à présent.
Quelle en sera la portée sur le plan concret ?
Les individus qui se réclamaient des positions de l’Académie pour s’opposer à la reféminisation du lexique des métiers et fonctions, voire pour s’opposer à des réformes plus fondamentales, ne peuvent plus le faire. Cela ne fera pas d’eux des adeptes du langage égalitaire, mais le combat des personnes qui promeuvent celui-ci va être grandement facilité.
Pourquoi l’Académie après avoir fermement refusé pendant des décennies cette féminisation, change-t-elle soudain d’optique ?
Elle n’a pas changé d’optique – à part peut-être quelques personnes, notamment les deux femmes qui ont cosigné le rapport. Elle a levé son veto parce que l’État lui a demandé de le faire, d’abord par l’intermédiaire de la Cour de Cassation (par lettre du 20 avril 2017), puis vraisemblablement par un coup de fil venu de plus haut – l’enquête est à mener – après l’intempestive Déclaration sur le péril mortel [représenté par l’écriture "dite inclusive", cf. annexe en bas de cet article] (26 octobre) et la fin de non-recevoir adressée au président de la Cour (6 novembre) [1].
L’origine de la demande de la Cour semble le « cas Aubert-Mazetier », en octobre 2014, le premier s’étant vu privé d’une partie de ses indemnités de député pour avoir enfreint le règlement de l’Assemblée en interpellant la seconde au masculin, et ayant promis qu’il poursuivrait l’Assemblée nationale devant les tribunaux. Le président de la Cour demande explicitement à la secrétaire perpétuelle de l’Académie si son opinion tient toujours ou si le temps passé ne l’aurait pas fait changer d’avis… Du coup, le rapport ne se prononce que sur cet aspect des choses, en faisant semblant d’élargir son propos aux noms de métiers, alors que seuls les noms de fonctions sont en litige depuis 1999.
Le fait que la commission chargée de ce rapport soit paritaire (deux femmes, deux hommes + quand même deux experts linguistes hommes) a-t-elle pu avoir un impact ?
Sur le contenu du rapport, je ne pense pas. La commission aurait pu être remplie d’hommes, elle serait sans doute arrivée aux mêmes conclusions. Sur les détails, je l’ignore. En revanche, l’impact sur le public (médias compris) est patent. Si la commission n’avait pas été paritaire, sur un tel sujet, tout le monde se serait encore moqué de l’Académie.
Que pensez vous de la justification « Notre pays traverse à cet égard depuis une dizaine d’années une période de transition, marquée par une évolution sociale qui se déroule sous nos yeux et par de multiples tentatives de modification des usages qui restent hésitantes et incertaines, sans qu’une tendance générale se dégage et que des règles, même implicites, parviennent à s’imposer » ?
C’est amusant quand on connait la maison. L’Académie admet enfin – sans le dire évidemment – qu’il y a un rapport entre les femmes et le féminin, entre les hommes et le masculin, et plus généralement entre la réalité sociale et la langue. Ce qu’elle niait vertement depuis 1984, en accusant les naïfs et les naïves, les féministes, tous les ignorants en général, de tomber dans ce panneau. Les y voilà tombé·es aussi… sauf les deux personnes qui n’ont pas approuvé ce rapport.
Dans le rapport il est fait mention du « masculin » et non d’un « masculin » équivalent à un « neutre » qui justifiait précédemment le fait que des fonctions soient au masculin. Le terme « neutre » n’apparaît jamais dans le rapport. De même que la précédente argumentation sur le « genre marqué » (féminin) et le « genre non marqué » (masculin), qui pour le public était obscure, n’est-elle tout d’un coup plus valable sur le plan linguistique ? Est-ce un revirement complet de l’Académie, qui ne reconnaît plus que le féminin et le masculin ?
L’Académie semble en effet enfin avoir enregistré qu’il n’y a plus de substantifs (ni d’adjectifs, ni de formes verbales) neutres en français depuis le XIIIe siècle – seulement quelques pronoms (ce, ceci, cela). On le lui répétait depuis quarante ans. Elle parait aussi avoir abandonné sa distinction entre genre marqué et non marqué, qu’elle tirait de théories structuralistes mal lues et mal comprises. Les linguistes qui ont travaillé pour la commission ont peut-être réussi ce tour de force. C’est en tout cas un revirement de taille, puisqu’elle fondait sur ces arguments sa préférence pour les noms masculins – ou plus exactement pour trente à quarante noms masculins prétendument valables pour les deux sexes, sur les milliers qui existent et qui ne servent qu’à désigner des hommes. Mais l’absence de référence au neutre est aussi une catastrophe pour les tenants du « masculin générique », expression également absente du rapport (ce qui s’explique sans doute par la volonté de ne se prononcer que sur le lexique des fonctions et des métiers, et de n’aborder aucun autre sujet). Les deux notions sont en effet régulièrement invoquées pour justifier les énoncés conduits au seul masculin alors qu’ils portent sur des populations mixtes, au motif que le masculin aurait la capacité de quitter sa signification particulière pour revêtir une signification générique, supérieure, neutre (ou plus exactement neutralisée en genre), englobant les deux sexes.
Que pensez vous des précautions énoncées par l’Académie dans le domaine des grades et fonctions élevées. Exemple : « même quand l’emploi des formes féminines s’est imposé à l’écrit, sa généralisation à l’oral n’est pas toujours systématique, ce qui donne alors la mesure de l’ancrage des nouvelles dénominations et invite à une grande souplesse d’utilisation : une application systématique et rigide de la féminisation peut constituer en fait un obstacle à son acceptation par la société » ; « Il est indéniable que la langue a jusqu’à présent marqué une certaine réserve à féminiser les appellations correspondant aux fonctions supérieures de la sphère publique. Il ne revient pas à l’Académie française de chercher une explication théorique à ce fait de langue » ?
C’est une manière de dire aux gens qui ne vont pas manquer d’être désespérés par ce revirement : « Ne vous en faites pas, les carottes ne sont pas tout à fait cuites, nous ne ferons pas un pas de plus dans cette direction ; nous allons d’ailleurs retourner à notre grand silence ; quant à vous, continuez de lutter pied à pied ». De fait, le propos est à la fois erroné linguistiquement et ignoble politiquement. Ce n’est pas la langue qui a « jusqu’à présent marqué une certaine réserve à féminiser », ce sont les hommes habitués à détenir un monopole sur certaines fonctions, et qui ont imposé aux femmes les mœurs qui y avaient cours – jusqu’au mœurs langagières. En suivant les leçons de l’Académie, qui a montré l’exemple (« On ne dit pas autrice », ont-ils répété pendant des siècles). La langue, elle, ou plutôt la commune et le commun des mortels qui parlent cette langue, n’ont aucun problème à créer des féminins, il en nait tous les jours : footballeuse, handballeuse, blogueuse, slameuse, matinalière (journaliste faisant les « matinales »), etc.
Il est suggéré que dans certains cas la féminisation des grades élevés pourrait soulever des problèmes juridiques, mais ça n’est pas très clair : « Il convient en outre d’évaluer les conséquences juridiques de la féminisation. Sous l’angle juridique, il importe en effet de distinguer ce qui relève de l’appellation proprement dite, pour laquelle les femmes peuvent légitimement souhaiter infléchir l’usage dans le sens de la féminisation, selon des modalités qui restent à préciser, et ce qui relève de la dénomination des fonctions, des grades et des titres dans les textes juridiques, qui reste, elle, fortement contrainte par l’exigence de cohérence des normes et de respect des principes qui fondent nos institutions ». Est-ce que la féminisation peut entrainer des problèmes légaux ?
Non, aucunement. La distinction entre la personne et la fonction, issue de la grande polémique de 1997-2000, lorsque l’Académie a cédé sur les métiers, ne repose sur rien. Une personne exerçant une fonction ou une activité est appelée avec le nom qui correspond à son sexe apparent (sauf à user d’une métaphore : ce type est une gourde). C’est précisément à cela que sert la distinction en genre pour les êtres animés, autrement dit les humains, les figures personnifiées, les animaux dont la différence sexuelle est visible. L’Académie n’a jamais suggéré qu’on devrait parler du roi d’Angleterre actuel sous prétexte que c’est une fonction. Prestigieuse, pourtant ! Mais ce n’est pas un ancien monopole masculin, et surtout ce n’est pas le genre d’activité ou de dignité que visaient les académiciens et leurs collègues. C’est pourquoi le rapport reste dans le flou, se contentant de suggérer aux personnes qui voudraient continuer à ferrailler qu’elles pourraient peut-être trouver de bonnes raisons de le faire. Mais avec un allié pareil, qui déclare n’avoir aucune intention de « chercher des explications théoriques » à ces mystères, ces personnes doivent se sentir aujourd’hui bien seules. Et ce ne sont pas les rares linguistes connus pour défendre les couleurs du masculin qui vont les aider.
Que pensez vous du fait que le rapport insiste à plusieurs reprises sur le fait que c’était ou ce sont les femmes elles-mêmes qui souhaitaient – souhaitent que le nom de leur fonction soit au masculin pour marquer « l’égalité de compétence et de mérite avec les hommes qui avait permis ce qu’elles regardaient comme une conquête ». Sur le cas de « ambassadrice » : « les femmes placées à la tête d’une mission diplomatique ne souhaitent pas nécessairement de nos jours être désignées par la forme fléchie du substantif « ambassadeur ». Les fonctions d’ambassadeur revêtent un caractère d’autorité et de prestige tel que l’usage ne s’oriente pas de façon unanime vers le recours à une forme féminine, qui renvoie à une autre réalité ». Une des conclusions est « il n’en reste pas moins que, dès lors que certaines femmes exerçant des fonctions longtemps et, aujourd’hui encore, souvent tenues par des hommes, expriment leur préférence à être désignées dans leur fonction au masculin, aucune raison n’interdit de déférer à ce souhait ». Pensez vous que les femmes exerçant de hautes fonctions sont particulièrement réticentes à cette féminisation ?
L’argument selon lequel les femmes seraient à l’origine de la préférence pour les titres masculins dès lors qu’elles exercent des fonctions prestigieuses (et naguère exclusivement masculines, donc) n’est pas nouveau. Nous en avons fait le dixième dogme (sur douze) dans notre livre L’Académie contre la langue française : « Les femmes sont contre. Surtout celles qui sont d’accord avec l’Académie ». Le propos est évidemment ignoble, puisque c’est l’Académie elle-même qui a proscrit les appellations féminines et qui a élaboré la panoplie des arguments opposables aux femmes revendiquant l’égalité des sexes jusque dans le langage (ridicule, perturbant, dégradant, dangereux, moche…). Ce passage sert aussi à affirmer que bien des femmes demeurent contre – alors que c’est le contraire. Sous couvert de respect de l’avis des femmes (celles qui sont contre), l’Académie continue ici son combat, qui consiste à fournir encore un argument pour lutter contre l’évolution des mentalités.
Est-ce qu’il y a encore des noms de métiers ou de fonction difficilement « féminisables » ? Par exemple dans les compte-rendus d’audience, les avocates sont appelées « Maitre » ; est-ce que si le juge les appelait « Maîtresse, qu’avez vous à déclarer etc. », cela ne susciterait pas des effets comiques, qu’elles veulent éviter ?
Aucun nom n’est difficilement féminisable, parce qu’aucun nom n’est féminisé ni à féminiser. Les noms de personnes ne naissent pas garçons, et ils n’ont pas besoin de passer sur une table d’opération pour devenir filles. Ils naissent tous fille ET garçon, à partir d’un radical commun : dans-, agricult-, coiff-, etc., donnent naissance à danseur et danseuse (mais aussi à danse, et à danser), agriculteur et agricultrice (mais aussi à agriculture), coiffeur et coiffeuse (mais aussi à coiffer, coiffe, coiffure), etc. Je ne vois pas pourquoi maitresse serait plus risible que maitre : on emploie ce mot tous les jours quand on a des enfants petits, et personne ne ricane. Aucun·e étranger·e apprenant le français n’aurait idée de rire si on lui disait qu’on dit indifféremment maitresse d’école, maitresse de conférence, maitresse des requêtes. Le problème, c’est qu’on lui dit que « ça ne se dit pas », et qu’on oriente sa pensée vers le domaine sexuel – qui n’est pourtant qu’une acception du terme. Mais on pourrait dire de même aux hommes que maitre est dégradant, parce que ça fait penser à maitre chien. On ne le fait pas… On n’a pas de panoplie d’arguments pour dénigrer les appellations masculines, alors qu’on en a une pour dénigrer les appellations féminines.
Par ailleurs, je suis pour abandonner les appellations désuètes dont s’affublent les notaires, les avocats et les médecins. Il y a aujourd’hui dans la société françaises des milliers de gens qui ont une maitrise ou un doctorat, et pour qui madame ou monsieur sont des appellations suffisamment déférentes. Ces gens là pourraient se mettre à la page.
Quelles pistes de travail pourrait-on suggérer à l’Académie française pour qu’elle aille encore plus loin que ce rapport sur la féminisation des noms de métiers et fonctions ?
Il est inutile de lui suggérer quoi que ce soit : elle n’en fera rien, elle n’écoutera rien. Telle qu’elle est, l’Académie n’est pas au service de la nation. Elle est au service de ses membres, qui ne sont entrés là que pour gérer au mieux leur fin de carrière – un livre revêtu de la mention « de l’Académie française » ayant beaucoup plus de chances de se vendre qu’un autre. Et elle est au service de la droite la plus conservatrice – dont ses membres font partie. Le mieux que les féministes et les progressistes puissent attendre de cette institution, dans l’état où elle est, c’est qu’elle se taise. Ce qu’elle semble s’apprêter à faire, si on lit bien ce rapport.
Ce n’est pas qu’elle ne pourrait pas devenir utile, et ce serait même assez facile de la rendre telle, si le pouvoir en avait la volonté. On ignore en effet généralement, d’autant qu’elle ne s’en vante pas, que toute personne admise en son sein a reçu l’aval du « protecteur », en vertu du premier article de ses statuts ; c’est-à-dire, aujourd’hui, du président de la République. Il suffirait qu’il impose son veto à tout nouveau candidat tant qu’il n’y a pas la parité, puis à tout·e candidat·e qui n’est pas linguiste, lexicographe, historien·ne de la langue, etc., tant que cette population n’est pas majoritaire des deux tiers dans la compagnie. Et pendant qu’il y est, à toute personne âgée de plus de soixante ans. Il faudrait aussi modifier son règlement pour que les personnes trop âgées pour travailler – elles sont aujourd’hui la grande majorité – laissent leur place à d’autres. Et il faudrait enfin la délivrer de ce dictionnaire qu’elle traine comme un boulet depuis les années 1640, et que personne ne lit plus depuis belle lurette. À la place, elle pourrait organiser des colloques, des réflexions, suggérer des réformes, y travailler, etc.
Le pouvoir n’a pas ce courage, et il n’en a pas besoin, puisqu’il a mis en place depuis De Gaulle des structures parallèles qui « font le job » a minima (les commissions terminologiques des ministères, la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France, le Conseil supérieur de la langue française, etc.). Donc la société civile va devoir continuer à avancer seule sur ces questions : à réfléchir, à modifier ses usages, à en expérimenter de nouveaux, à faire pression sur les producteurs de normes qui résistent, notamment l’école, qui enseigne aujourd’hui le sexisme sous couvert de règles pensées par les grammairiens de l’Ancien Régime. Oui, si l’Académie peut se taire, pendant ce temps-là, c’est le mieux qu’elle puisse faire.
![]() Analyse plus complète : télécharger la note d’Eliane Viennot « Rapport de l’Académie française sur " La féminisation des noms de métiers et de fonctions ", décryptage » (28 février 2019) >>>>
Analyse plus complète : télécharger la note d’Eliane Viennot « Rapport de l’Académie française sur " La féminisation des noms de métiers et de fonctions ", décryptage » (28 février 2019) >>>>
Droits de l’Homme ou droits humains ?
Est-ce que l’Académie s’est déjà exprimée au sujet du remplacement de « droits de l’Homme » (d’ailleurs souvent indiqué « droits de l’homme » sans la majuscule censée rappeler qu’il s’agit de « Homme » au sens de « genre humain ») ?
L’Académie n’a rien dit sur ce sujet dans ses déclarations depuis quarante ans, et on peut parier qu’elle ne dira rien de plus – sauf si la menace se précise de changer le texte du préambule de la Constitution (qui y fait scandaleusement référence) et tout ce qui s’ensuit (le nom de la « Cour européenne des droits de l’homme », par exemple, à laquelle la France impose son nom parce qu’elle est sur son territoire). En revanche, certains de ses membres l’ont fait, par exemple Jean-François Revel, le directeur du Point, lors de la première polémique (juillet 1984) : « Confondre les deux [le genre grammatical et le genre biologique] relève d’une incompétence qui condamne à l’embrouillamini sur la féminisation du vocabulaire. Un humain de sexe masculin peut fort bien être une recrue, une vedette, une canaille, une fripouille ou une andouille. De sexe féminin, il lui arrive d’être un mannequin, un tyran ou un génie. Le respect de la personne humaine est-il réservé aux femmes, et celui des droits de l’homme aux hommes ? Absurde ! Ces féminins et masculins sont purement grammaticaux, nullement sexuels. » Il est amusant de constater que Revel trouve d’emblée la solution proposée depuis des lustres par les égalitaristes : remplacer homme par humain. Au-delà, il fait surtout la démonstration de son incompétence en matière de langue : il confond les noms d’activité et les métaphores (andouille, génie, mannequin, recrue, vedette…), il ignore l’existence du mot tyranne. Et il oublie aussi l’histoire de France, ou il fait aussi semblant d’ignorer que les droits de l’homme ont été réservés aux hommes jusqu’en 1944.
Au-delà de cette anecdote, il y a deux choses importantes à savoir. La première est que l’Académie est responsable de l’idée que le mot homme signifierait les deux sexes : elle l’a affirmé dès son premier Dictionnaire (1694). Elle a dû sidérer tout le monde, car l’ensemble du droit reposait sur l’idée contraire, état de chose qui allait durer jusqu’en 1944 (au moins). Les autres dictionnaires ont été très longs à embrayer, et certain·es féministes se sont appuyé·es sur ce flou pendant la Révolution, pour protester contre l’interprétation excluante des droits en question. La seconde chose à savoir, c’est que l’expression n’a été revêtue d’une majuscule que dans les années 1960, d’après mes recherches (hors le nom de la Ligue des Droits de l’Homme). Ce mythe est donc très récent. C’est un enfumage de plus, destiné à nous faire croire à la réalité de cette inclusion.
Dans la Francophonie, la France est-elle isolée sur « droit de l’Homme » ?
La France a profité de son leadership au sein des pays francophones, en 1948, pour imposer que de l’expression human rights (adoptée après six mois de débats très intenses, menés par des femmes féministes) soit traduite par droits de l’homme ; ce qui n’est rien d’autre qu’une traduction fautive. Dans les organismes internationaux, elle en est à imposer la traduction droits de l’homme des femmes pour human rights of women dans certaines résolutions portant sur l’égalité des sexes ou les violences faites aux femmes !
Le Québec est le premier pays à avoir marqué son désaccord, en prenant toute une série de lois mettant en avant les droits de « la personne humaine », dans les années 1970. Haïti a choisi récemment d’adopter les droits humains. Il y a débat dans les autres grands pays francophones, mais j’avoue que je ne sais pas où ils en sont.
On trouve de plus en plus « droits humains » y compris dans des textes émanant de ministères (ex. ministère des Affaires étrangères). Mais le point qui ne semble pas négociable, c’est quand il s’agit de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (rappelée dans le préambule de la constitution de 1958 et ayant valeur constitutionnelle) ou de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 (qui dans son article 1 parlent « des êtres humains libres et égaux en dignité et en droits ». Faut-il garder « homme » dans la mesure où cette Déclaration de 1789 a été adoptée selon cette appellation et fait partie du patrimoine culturel et politique français ?
Non, pour moi il va falloir obtenir que la constitution cesse de faire référence à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui est intouchable comme référence historique, mais qui ne concernait que la moitié de la nation. C’est un peu comme si on continuait à se référer au Code noir ! Certaines personnes continuent de prétendre que cette Déclaration était inclusive, mais il n’est qu’à la lire toute entière pour voir que les droits qui sont définis là – la liberté, l’égalité, le droit d’élire ses représentants, le droit d’être élu… – ne concernaient pas les femmes. Certaines personnes veulent croire que si les femmes ont été exclues, c’est plus tard, parce que le « vent avait tourné », mais c’est faux. Ce sont les mêmes gens qui ont promulgué la Déclaration (en aout 1789), qui ont exclu les femmes de la succession « à perpétuité » (en octobre) et qui ont élaboré les premières lois électorales, qui excluaient les femmes (en novembre-décembre). Tous les régimes, ensuite, se sont réclamés des droits de l’homme (ou ont fait semblant) en continuant d’exclure les femmes de la citoyenneté. Pour pouvoir aller dans l’autre sens, à la Libération, il a fallu écrire noir sur blanc que « les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes » (Ordonnance d’Avril 1944) et que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme » (Constitution de 1946).
Dans une constitution égalitaire, il faudrait se référer à la Déclaration de 1948 – en la traduisant correctement, évidemment ! Il y a aujourd’hui de plus en plus de politiques qui comprennent ça – notamment le ministre des affaires étrangères. Mais aucun·e président·e n’aura le courage de prendre le taureau par les cornes si l’opinion publique ne l’y oblige pas. En attendant il faut faire acte de désobéissance civile en parlant systématiquement de la Déclaration universelle des droits humains de 1948 ou de la Cour européenne des droits humains. Il faut rebaptiser de même les Maisons des sciences de l’homme, et les Sciences de l’homme, et le Musée de l’homme, et tutti quanti.
Spécialiste des « femmes d’État » de la Renaissance, elle a édité les oeuvres complètes de Marguerite de Valois et les écrits en prose d’Anne de France. Plus largement, elle s’intéresse aux relations entre les femmes et le pouvoir, aux discours – historiques, littéraires, politiques… – sur ces relations, et à leur transmission dans la mémoire collective (La France, les femmes et le pouvoir, Perrin, 3 vol. parus, 2006, 2008, 2016).
Elle travaille également aux retrouvailles de la langue française avec l’usage du féminin (Non, le masculin ne l’emporte pas sur le féminin ! Petite histoire des résistances de la langue française, iXe, 2014 ; L’Académie contre la langue française : le dossier « féminisation », iXe, 2016, en collaboration). Son dernier livre "Le langage inclusif : pourquoi, comment", 2018.
Cofondatrice de la SIEFAR et de l’Institut Emilie du Châtelet, elle a créé deux collections aux Publications de l’Université de Saint-Etienne et anime plusieurs sites de recherche.
Entretien avec Eliane Viennot, juillet 2016
On nous renvoie souvent à l’Académie française qui se définit comme « la gardienne de l’usage » et estime par exemple que le gouvernement n’a pas le pouvoir « de modifier de sa seule autorité le vocabulaire et la grammaire du français » [2]
— Disons tout d’abord que personne ne lui a jamais demandé de « garder » la langue, ni l’usage, c’est un abus de langage de sa part. C’est aussi une rhétorique qu’elle utilise alternativement avec une autre, tout à fait contraire, qui consiste à dire qu’elle en est la « greffière » (c’est-à-dire qu’elle note, après coup, ce qui est entré dans l’usage). De fait, elle ne campe sur la première position que lorsqu’on la chiffonne, quand on ne lui demande pas son avis – à condition qu’elle en ait un. Pour beaucoup de faits linguistiques, elle n’en a pas (il faut savoir qu’il n’y a aucun linguiste ni aucun grammairien parmi ses membres, et cela depuis des lustres). Quant à « greffière », elle prétend l’être pour répondre aux gens qui critiquent sa lenteur, vu qu’elle ne sort qu’un dictionnaire ou deux par siècle, et que ces ouvrages ont toujours 50 ans de retard sur l’usage. Mais la réalité est qu’elle n’enregistre que les termes qui lui conviennent. Nombre de mots féminins parfaitement attestés, notamment, semblent n’avoir jamais existé quand on lit ses Dictionnaires.
Justement vous venez de diriger l’ouvrage collectif L’Académie contre la langue française : le dossier « féminisation ». Est-ce que historiquement la masculinisation de cette langue date de la création de cette institution ?
— Pas tout à fait. Certains infléchissements sont plus anciens, comme le choix du pronom impersonnel « il » (il faut, il est certain…), qui date du « moyen français » (XIVe-XVe siècle), lorsqu’on a commencé à exprimer systématiquement les pronoms sujets. On aurait pu trouver un neutre, mais les lettrés de l’époque ont trouvé que « il » allait très bien… La condamnation du pronom attribut « la » (je suis gourmande et je la resterai toujours) paraît dater du début du XVIIe siècle, comme l’idée de la prédominance du « genre le plus noble » pour les accords. De fait l’Académie est née (en 1635) après une trentaine d’années de bouillonnement de la réflexion sur la langue, et elle en est un produit. Par ailleurs, elle n’a pas toujours été en pointe sur la masculinisation de la langue qui se fait massivement au XVIIe siècle : ce sont le plus souvent quelques membres de l’institution qui y travaillent, en parallèle avec d’autres idéologues qui n’en font pas partie. D’autres académiciens devaient ne pas être d’accord… Ce qui explique aussi la lenteur du Dictionnaire.
Pour vous quelle est la pire « perle » dite par un académicien à ce sujet ?
— Pour moi, c’est Dumézil qui gagne le prix en 1984, lorsqu’il explique que, de tous les termes féminins « forgés » (car pour les académiciens, sénatrice ou écrivaine sont des néologismes !), le seul vraiment utile et vraiment beau est « conne ». Qui n’était alors nullement nouveau…
A quoi est due leur attitude en retard sur la société ? Classe sociale ? Age ? Méconnaissance de l’histoire ?
— La principale explication, me semble-t-il, est leur positionnement politique. Ce sont très majoritairement des hommes de droite, et à présent des femmes de droite, voire très à droite. Lorsque l’Académie a entamé sa bataille contre la « féminisation des titres », en 1984, elle était encore pleine de pétainistes et de royalistes. L’incompétence est l’autre grande explication : aucun de ses membres n’est entré à l’Académie pour faire le dictionnaire ! C’est une sorte de « boulet sur le gâteau ». Il faut le faire (ou plutôt le faire faire, puisque le travail est assuré depuis trente ans par des agrégé•es !), et les plus ambitieux s’y collent, parce que la commission qui préside à cette activité est la plus génératrice de pouvoir. Mais personne n’a les diplômes ou l’expérience pour cela, et chacun•e ne pense qu’à sa notoriété.
Est-ce que les rares « académiciennes » ont défendu la féminisation ou se sont-elles conformées aux normes de leur confrères ?
— Aucune académicienne, à ma connaissance, n’a défendu la féminisation. Je pense même que les impétrantes font savoir à l’avance qu’elles sont contre, sinon elles n’auraient aucune chance.
En définitive est-ce qu’il appartient à une instance de fixer le « bon » usage du français ou chacun-e peut-il en faire ce qu’il-elle veut ?
— Il n’est pas absurde qu’un groupe de personnes compétentes puisse éclairer le public sur les questions qui se posent en matière de langage (néologismes correspondant à des inventions ou des activités nouvelles, équivalents de termes étrangers, réformes…), et il est justifié que l’État ait recours à de tels groupes, vu qu’il a des responsabilités en matière d’éducation et de communication publique. Mais aucune institution, de nos jours, ne peut prétendre fixer l’usage – surtout quand elle est incompétente et que ses avis vont au rebours des logiques du français !
Est-ce qu’un-e enseignant-e devrait pouvoir décider d’adopter / d’enseigner la règle de proximité auprès de ses élèves ?
— Il y en a déjà qui le font. Mais il faudrait un mouvement officiel, avec une « déclaration d’insubordination » solennelle, d’une part pour expliquer les raisons sociale et politique de l’abandon de la règle du « masculin qui l’emporte sur le féminin » (et du pluriel sur le singulier), d’autre part pour que les élèves ainsi formé•es ne soient pas, un jour, pénalisé•es au motif qu’ils ne connaissent pas la « bonne » règle.
Vous préférez « chercheuse » à « chercheure » pourtant souvent en usage parmi les… chercheuses, pourquoi préférez-vous la terminaison en « euse » et pourquoi beaucoup de chercheuses semblent-elles opter pour « chercheure » ?
— Je suis pour « chercheuse » parce que ce mot existe en français depuis des siècles, parce qu’il suit les règles de formation les plus courantes, et parce qu’on continue à l’employer pour les métiers peu qualifiés (chercheuse d’or…). Le terme « chercheure » n’est guère utilisé aujourd’hui que par des jeunes femmes très diplômées, qui ne se rendent généralement pas compte de l’élitisme de leur geste. Peut-être comptent-elles aussi sur le fait qu’on n’entend pas la différence avec le masculin à l’oral, et que donc certains de leurs collègues masculinistes n’y verront que du feu… Ce qui ne me semble pas de bonne guerre.
De la même façon, êtes vous pour professeuse, proviseuse, procureuse, sapeuse-pompière, etc. ?
— Oui, je suis pour le moins d’exceptions possible – en lexicologie comme en orthographe. Plus il y a d’exceptions aux grandes séries de mots, plus c’est un casse-tête pour savoir si on dit ci ou ça, si on écrit comme ci ou comme ça ; donc plus le nombre de gens qui « maîtrisent » la langue est restreint, et plus le nombre de celles et ceux qui font « des fautes » est élevé. Je me suis habituée à « professeure », parce que j’ignorais jusqu’il y a peu que « professeuse » avait été employé à partir du XVIIIe siècle. Il a évidemment été combattu par les idéologues masculinistes avec la dernière énergie (le grammairien Bescherelle, par exemple). Il se dit encore dans certains pays francophones – là encore, pour les niveaux moyens. Je serais assez pour sa réintroduction, jusqu’au niveau universitaire bien entendu – mais nous avons déjà mis tant de temps à adopter « professeure »…
(A noter : dans votre notice sur wikipédia il est mis « Éliane Viennot est professeur de lettres et historienne »)
— J’avais fait changer ça, mais les partisans du parler mec sont très majoritaires à Wikipédia, et c’est une lutte incessante. Modifiez ma notice ! C’est possible !
Contrairement à beaucoup « d’auteures » vous préférez « autrice » à « auteure », pourquoi ?
— Je suis devenue intraitable sur « autrice » ! C’est le doublet d’« actrice », comme « auteur » est le doublet d’« acteur » – ces mots provenant des latins « auctor » et « auctrix ». Ce mot était employé sans aucun problème au XVIe siècle, et les premiers académiciens eux-mêmes l’utilisaient encore (comme « écrivaine », d’ailleurs) ; et les Italien•nes l’utilisent toujours ! Par ailleurs, c’est LE mot martyre des masculinistes : aucun n’a été combattu avec la même opiniâtreté. J’ai même trouvé un dictionnaire où la seule mention qui apparaisse à son propos est, dans l’entrée « auteur », cette injonction : « il ne faut pas dire “autrice”. »
De même vous optez donc pour « rectrice » ?
— Bien entendu ! puisqu’on dit « directrice », pourquoi dirait-on autre chose que « rectrice » ?
Pensez vous qu’il y a une typographie plus pertinente qu’une autre pour genrer les mots ? (élu-es, élu-e-s, éluEs, élu.e, élu•e, etc.)
— Vous voulez dire pour les démasculiniser ? Oui, j’en suis arrivée (après hésitations) à penser que le point médian unique est la meilleure solution pour exprimer les deux genres à l’écrit. Le trait d’union est « sécable » (la suite peut partir à la ligne), la majuscule ressemble à un bouton sur la figure et semble dire qu’il faut surtout prendre en compte le féminin, le point bas crée, au pluriel, de faux liens hypertextes (des adresses espagnoles)… Le point médian présente en revanche beaucoup d’avantages : il n’entraîne aucun de ces effets secondaires, il n’est attaché à aucune connotation, il est discret (il sera donc mieux accepté) et en outre il est spécialisé dans cet emploi en français. Deux signes, enfin, sont inutiles : tout le monde comprend avec un seul. Par ailleurs, je recommande vivement l’adoption de l’accord de proximité, qui permet d’éviter de recourir à ces signes (« les filles et les garçons étaient tout nus, ils se sont rhabillés »). « Filles » passant avant « garçons » en vertu de l’ordre alphabétique, qui doit aussi entrer dans le dispositif.
Pensez vous que le mot « genre », objet de controverses en France (et lui aussi sous la vindicte de la commission de lexicologie de l’Académie), prête à confusion pour parler de « l’approche de genre dans les politiques publiques », des « études de genre », etc. ? Est-ce qu’on ferait mieux de dire « rapports sociaux de sexe » ?
— Non, je pense qu’aujourd’hui tout le monde connaît ce terme. Même si tout le monde n’en comprend pas les tenants et les aboutissants. Ce qui est le cas de beaucoup de mots, qui sont néanmoins employés…
Que pensez vous de l’expression « égalité de genre » ou même « égalité des genres » qui se développe pour dire « égalité des sexes » ? Les « genres » « masculin » et « féminin » peuvent-ils être égaux si ce sont des constructions sociales précisément fondées sur l’assymétrie de pouvoir ?
— « Genre » n’est pas l’équivalent de « sexe », ni de « masculin-féminin », ni de « les deux sexes ». Il y a des flottements autour du nouveau terme, parce que les gens se l’approprient peu à peu, et surtout parce qu’ils n’avaient pas l’habitude de penser les relations entre les sexes en termes de pouvoir. Celles et ceux qui refusent de voir cette dimension ont tendance à utiliser le mot nouveau en le vidant de son sens, d’autres ne se sont pas encore aperçus qu’il avait un autre sens…
Dans votre ouvrage Non le masculin ne l’emporte pas sur le féminin ! vous dites que la langue française « n’est pas sexiste, elle est genrée ». Vous dites qu’elle est même « particulièrement égalitariste ». Pouvez vous expliquer ? La langue française ne reflète-t-elle pas la domination masculine ?
— Je dis que la langue française a toutes les ressources en elle pour qu’on puisse s’exprimer sans sexisme, si on le veut. Son système impose qu’on parle des femmes au féminin et des hommes au masculin, non seulement en utilisant des substantifs ou des pronoms adéquats, mais en reportant les marques du féminin et du masculin sur une bonne partie des termes qui leurs sont liés. Incontestablement, elle est très « genrée ». Barthes allait jusqu’à dire que « la langue est fasciste »… C’est exagéré, bien sûr, mais en tout cas il est vrai qu’elle ne donne le choix qu’entre deux solutions, le féminin ou le masculin. Qui sont employés à égalité, dès la première unité (un coiffeur, une coiffeuse), mais aussi qui ont la même origine, le même radical commun, et qui sont « marqués » l’un et l’autre : « coiffeuse » et « coiffeur » viennent de « coiff- », qui donne aussi « coiffer » et « coiffure ».
C’est ce système égalitariste que les grammairiens et lexicologues masculinistes ont cherché à infléchir. D’une part, ils ont fait disparaître des noms qu’il est facile de réintroduire, comme le pronom attribut « la ». D’autre part, ils ont fait régresser l’accord de proximité en faveur de l’accord avec « le genre le plus noble ». Enfin, ils ont bloqué sur le masculin singulier beaucoup de formes qui se déclinaient auparavant : les participes présents (on disait « Mme X, habitante à Nantes »), participes passés antéposés (« Vus mes rhumatismes »), adjectifs séparés de leur substantif (Du Bellay parle des « manières de parler françaises ») ou antéposés (« Saufs mes oncles »), etc. De même, les philosophes ont promu « l’homme », et fait régresser les anciennes expressions pour dire le sexe masculin (« les hommes »), et surtout pour dire l’humanité (« les gens », « les gens de tout âge et de tout sexe », « la personne »). Tout cela a à voir avec la volonté de certains groupes, et avec leur pouvoir d’imposer cette volonté, pas avec les capacités intrinsèques de la langue. Par exemple, l’Académie stipule dans sa Déclaration du 21 mars 2002 : « Il est inutile, pour désigner un groupe de personnes composé d’hommes et de femmes, de répéter le même substantif ou le même pronom au féminin puis au masculin. » Les exemples fournis sont pourtant du bon français : « “Les électrices et les électeurs”, “les informaticiennes et les informaticiens”, “toutes celles et tous ceux” ». Et il ne s’agit nullement de répétition ! Ce sont des mots différents, et d’ailleurs logiquement reliés par une conjonction de coordination. Enfin, lorsque l’Académie ajoute que ces expressions sont « des tours qui ne disent rien de plus que “les électeurs”, “les informaticiens”, “tous ceux” », elle énonce évidemment une contre-vérité, non seulement linguistique, mais politique : il s’agit de masquer que les femmes n’ont pu voter que 170 ans après les hommes, que les carrières des informaticiennes ne sont pas forcément comparables à celles des informaticiens, etc.
Pensez vous qu’à terme il vaudrait mieux une langue qui soit totalement indifférente aux sexes ? Est-ce qu’il existe déjà de telles langues ? Pensez vous que cela puisse avoir un impact sur le statut des femmes et des hommes ?
— Les linguistes compétents en la matière (je n’en suis pas) affirment qu’il existe des langues indifférentes à l’expression du genre. Cela n’implique évidemment pas que les sociétés pratiquant ces langues ne le soient pas. Les études menées sur l’anglais (où le genre a quasiment disparu au-delà des pronoms personnels) montrent que les locuteurs et les locutrices restituent mentalement du genre là où la langue n’en affiche plus, en fonction du genre des métiers (nurse = femme, manager = homme). Pour les langues qui connaissent le genre, certain•es féministes rêvent à sa disparition, mais c’est complètement utopique : autant dire qu’on va changer de langue, ou pousser l’Himalaya ! Il faudrait en effet inventer de nouvelles formes – d’articles, d’adjectifs, de pronoms, de substantifs, de participes… – pour remplacer les deux genres actuels dans des milliers de mots. Serait-il plus facile de tout masculiniser (en renforçant la domination masculine) ? Je n’y crois pas davantage, parce qu’il y a moitié de femmes dans les pays dont on parle, et qu’une fois de plus, on touche là au système de la langue, qui bouge très lentement. En revanche, on peut gagner la bataille qui consiste à exprimer le féminin à égalité avec le masculin, parce que là, on a la langue avec nous, et la preuve qu’elle peut fonctionner de manière beaucoup moins sexiste. Ce sont des atouts majeurs – y compris pour aller de l’avant (invention de quelques pronoms, typographie). Je crois qu’on a déjà suffisamment d’ennemis…
Vous venez de publier Et la modernité fut masculine (1789-1804) , qui fait suite à L’invention de la loi salique (Ve-XVIe siècle) et Les résistances de la société (XVIIe-XVIIIe siècle). Est-ce que historiquement il y a eu une régression des droits, du statut et de l’autonomie des femmes au 19ème siècle ? Est-ce que cela a été plus le cas en France que dans d’autres pays ? Est-ce que la révolution française a été une « mauvaise affaire » pour les femmes ?
— Aux trois questions, la réponse est oui. De fait, la régression des droits et des capacités féminines (accord de proximité !) est plus ancienne : elle se met en marche au XIVe siècle, suite à la création des universités, qui préside à la montée en puissance de la « clergie » – la classe qui tire son pouvoir du savoir et qui s’investit dans tous les rouages de l’État en empêchant ses rivaux (les femmes, les juifs) d’y accéder ; classe qu’il ne faut pas confondre avec le clergé, même si historiquement elle vient de l’Église, qui seule produisait des savants avant que les universités ne prennent le relais. La régression a été progressive, mais elle a été favorisée par les coups d’État qui, en France, ont conduit à l’invention de la loi salique (XIVe-XVe siècle). À l’inverse, elle a été entravée par divers mouvements (d’où le titre de mon deuxième volume, Les résistances de la société). La Révolution, avec l’arrivée de la clergie au pouvoir (plus de 70% des « élus » sont des juristes !) permet à ces hommes de réaliser enfin à grande échelle leur rêve de domestication des femmes : ils les privent des droits qu’ils octroient aux hommes. Et les régimes ultérieurs coulent dans le béton le nouveau rapport de force, grâce au Code civil notamment, mais aussi par des dizaines de lois et règlementations discriminantes (dans l’éducation, le travail…) – sans parler du retour du « proxénétisme d’État », que la fin du Moyen-Âge avait vu fleurir…
Est-ce que vous pensez que la révolution féministe a suscité une « crise de la masculinité » au 20ème siècle ?
— Oui, bien sûr. Mais c’est davantage qu’une crise de la masculinité, au sens du vécu des hommes. C’est une crise de l’ordre masculin inauguré en 1789 et incessamment consolidé par la suite. Les hommes sont « en crise » parce que l’ordre social qui leur assurait la suprématie ne les soutient plus, ou plus clairement, par exemple lorsque l’État accorde aux femmes le droit de s’éduquer, de travailler sans autorisation du mari, de voter, de contrôler leur corps. « Tout fout le camp ».
Est-ce qu’historiquement il y a déjà des écrits qui mentionnent une « crise de la masculinité » (ou virilité) ?
— Les historien•es identifient de telles crises à partir de la fin du XIXe siècle, c’est-à-dire précisément lorsque l’ordre masculin si fort depuis un siècle commence à prendre l’eau. Pour autant que je le sache, il n’y a pas ce genre d’analyses pour les périodes précédentes. Il y a en revanche des féministes (femmes et hommes) qui analysent la peur des hommes du renversement de la situation, ou simplement de l’égalité. Depuis Christine de Pizan (XVe siècle).
Pensez vous que les courants « masculinistes » gagnent du terrain en France ?
— Non, je pense que les masculinistes sont aux abois, parce que depuis les années 2000, suite à la mobilisation pour la parité, il n’est plus question que « les femmes aussi » (titre d’une célèbre émission télévisuelle des années 60) exercent des professions ou des fonctions importantes. Il est question qu’elles soient à égalité – quantitative et qualitative – avec eux. Ceux qui n’étaient d’accord avec l’égalité qu’à condition que ça ne les atteigne pas comprennent que ce temps est fini. Donc ils mordent et ils crient.
On constate qu’il y a très peu d’hommes dans les conférences-débats, dans les formations sur le genre, sur l’égalité femmes-hommes ? Comment pourrait-on les y intéresser ?
— Ils y viendront quand ils comprendront qu’il y ont intérêt. Dans les pays où les Gender Studies sont reconnues, par exemple, où cette compétence peut compter sur un CV, ils sont beaucoup moins absents des rencontres scientifiques…
Annexes
Déclaration de l’Académie française sur l’écriture dite "inclusive"
Adoptée à l’unanimité de ses membres dans la séance du jeudi 26 octobre 2017
"Prenant acte de la diffusion d’une « écriture inclusive » qui prétend s’imposer comme norme, l’Académie française élève à l’unanimité une solennelle mise en garde. La multiplication des marques orthographiques et syntaxiques qu’elle induit aboutit à une langue désunie, disparate dans son expression, créant une confusion qui confine à l’illisibilité. On voit mal quel est l’objectif poursuivi et comment il pourrait surmonter les obstacles pratiques d’écriture, de lecture – visuelle ou à voix haute – et de prononciation. Cela alourdirait la tâche des pédagogues. Cela compliquerait plus encore celle des lecteurs.
Plus que toute autre institution, l’Académie française est sensible aux évolutions et aux innovations de la langue, puisqu’elle a pour mission de les codifier. En cette occasion, c’est moins en gardienne de la norme qu’en garante de l’avenir qu’elle lance un cri d’alarme : devant cette aberration « inclusive », la langue française se trouve désormais en péril mortel, ce dont notre nation est dès aujourd’hui comptable devant les générations futures.
Il est déjà difficile d’acquérir une langue, qu’en sera-t-il si l’usage y ajoute des formes secondes et altérées ? Comment les générations à venir pourront-elles grandir en intimité avec notre patrimoine écrit ? Quant aux promesses de la francophonie, elles seront anéanties si la langue française s’empêche elle-même par ce redoublement de complexité, au bénéfice d’autres langues qui en tireront profit pour prévaloir sur la planète".
Notes
[1] Voir l’article de Thomas Vampouille, « Quand l’Académie française voit dans la féminisation des mots une “dérive totalitaire” », Marianne, 21/11/2017, en ligne
titre documents joints
- Académie Rapport féminisation noms métiers 2019 (PDF - 362.9 ko)
- Rapport Académie Décryptage E.Viennot (PDF - 290.2 ko)