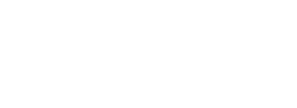Intranet
Accueil > Points de vue & interviews > Pour un féminisme intersectionnel et universaliste |
Pour un féminisme intersectionnel et universalisteLundi 27 septembre 2021 Adéquations présente ce point de vue de membres de la commission genre d’ATTAC, partenaires d’Adéquations, sur les convergences entre les approches intersectionnelle et universaliste du féminisme, qui ne s’opposent pas nécessairement, contrairement aux simplifications souvent diffusées dans le champ médiatique ou même militant. Cette analyse de partenaires d’Adéquations correspond à peu près à notre positionnement. |
Depuis quelques années, un nouveau clivage s’est formé au sein du mouvement féministe, entre deux courants maintenant dénommés « féminisme universaliste » et « féminisme intersectionnel ». De nombreux médias se sont emparés de cette opposition et ont largement participé à la figer en mettant en scène deux camps irréductibles, en organisant des confrontations avec des représentantes « ad hoc » de chacun d’eux, plus préoccupés de faire de l’audience que de vraiment clarifier les divergences. Cette division affaiblit de manière considérable la capacité des féministes de lutter contre les régressions sociales, économiques et sociétales en cours, lutte qui fait pourtant partie de nos urgences.
Ce texte se donne pour ambition de montrer que le clivage entre universalistes et intersectionnelles est en grande partie artificiel et non pertinent. Du moins si l’on se met d’accord sur le sens des concepts, alors qu’ils sont utilisés aujourd’hui de manière extensive, confuse ou dévoyée. D’un côté, l’universalisme doit être entendu comme un idéal, un objectif à atteindre, et non comme un universalisme abstrait qui occulte le racisme ou les discriminations pourtant bien réelles. De l’autre côté, l’intersectionnalité est un outil d’analyse indispensable pour la prise en compte des différents rapports de domination (classe, genre, « race »), mais elle ne doit pas mener à hiérarchiser ces dominations ou à cultiver des logiques d’affrontements identitaires.
L’objectif de ce texte est donc d’aider à éviter les faux antagonismes qui créent artificiellement des oppositions entre différentes féministes, parfois entre les plus récentes et les plus anciennes. Toutes doivent pouvoir se retrouver sur la volonté de faire converger les luttes : les luttes anti-racistes, luttes de classes, luttes contre l’oppression de genre, l’homophobie, etc., sans en reléguer au second plan.
Après avoir évoqué le contexte de l’émergence du concept d’intersectionnalité aux États-Unis (1), nous rappellerons que dans le contexte français très différent, le mouvement féministe des années 1970 s’est préoccupé de l’oppression combinée du patriarcat, du capitalisme et de l’impérialisme, pratiquant de fait une approche intersectionnelle sans qu’elle soit nommée ainsi (2). La troisième partie permettra de prendre des distances avec certaines interprétations, distorsions ou dévoiements de l’intersectionnalité (3). La conclusion résumera le sens de notre féminisme intersectionnel et universaliste.
1. D’où vient le concept d’intersectionnalité : l’influence du Black feminism américain
Le concept d’intersectionnalité a été formulé aux États-Unis dans les années 1980 par la juriste africaine-américaine Kimberle Crenshaw. Sa réflexion se situait dans le contexte d’un droit et d’une jurisprudence de l’anti-discrimination, apparus dès les années 1960 et elle s’est aussi inspirée des travaux du Black feminism des années 1970.
Rappelons que le système de ségrégation raciale n’a été aboli dans le Sud qu’au milieu des années 1960 (Civil Rights Act, 1965) suite à des mobilisations de masse pour les droits civiques, auxquelles les femmes africaines-américaines ont largement participé. Cela a permis d’obtenir une série de mesures pour endiguer les différentes formes de discrimination raciale – mais aussi de genre – toujours à l’œuvre. C’est ainsi que fut notamment votée à la fin des années 1960 une série de lois instituant des politiques d’action positive (affirmative action). Il s’agissait essentiellement d’instaurer des quotas permettant aux personnes africaines-américaines, hispaniques, asiatiques… d’être embauchées dans toutes les entreprises et administrations, et d’éliminer, autant que possible, les discriminations en matière de déroulement de carrière. Des quotas se sont appliqués également pour le recrutement de femmes à l’université. L’ensemble de ces mesures a permis l’ouverture aux femmes de métiers traditionnellement masculins, dans la justice et la santé mais aussi dans les métiers ouvriers (usines, chantiers, mines…).
Kimberle Crenshaw, en analysant la jurisprudence, a ensuite montré comment les juges cherchaient à évaluer séparément les effets de la discrimination dont étaient victimes les femmes Noires [1] en fonction soit de la race, soit du genre. Alors que ces femmes se situaient à l’intersection de deux discriminations potentielles, l’évaluation séparée avait pour conséquence de les exclure en partie du bénéfice des instruments juridiques créés pour lutter contre ces discriminations. [2] C’est ce qui l’a conduite à forger le concept d’intersectionnalité reposant sur une analyse des effets croisés et simultanés du genre, de la classe et de l’assignation raciale. [3]. À noter que bien antérieurement, entre les deux guerres, la militante africaine-américaine Claudia Jones évoquait déjà la « triple oppression » à propos de la position spécifique des travailleuses noires américaines marginalisées tant dans les combats féministes qu’antiracistes.
Le concept d’intersectionnalité a largement bénéficié des travaux des Black feminists. Dans les années 1970, le mouvement féministe aux États-Unis, qui avait connu une renaissance du fait des mobilisations de masse en faveur de l’avortement, était majoritairement composé de femmes blanches de la classe moyenne. Les féministes noires ont remis en cause la représentation du féminisme dominant qui considérait les femmes comme une classe homogène [4] et accordait la prééminence à la lutte contre le patriarcat en négligeant le vécu des femmes noires. [5]
Cette analyse était également formulée par Adrienne Rich [6] théoricienne féministe (blanche) qui a reproché au mouvement féministe américain dominant de prétendre représenter une « classe universelle », ce qui niait les différentes formes de subordination auxquelles sont soumises les femmes de couleur, les lesbiennes et les femmes de la classe ouvrière.
Selon Jaunait et Chauvin (op. cit.), après les combats pour les droits civiques, la question de la race est devenue « le signifiant clef des mobilisations sociales ». Pour les Black feminists, plus qu’une analyse théorique sur l’articulation des différents rapports de domination, il s’est d’abord agi de s’inscrire dans le débat politique sur les stratégies de libération. Et là, le clivage est apparu par rapport au Black Power Movement qui donnait la primauté à la question de la race et refusait de se battre concomitamment contre l’oppression des femmes noires – leurs revendications étant considérées comme affaiblissant la lutte collective – ou, la reportait aux calendes grecques. Diverses organisations de femmes noires se sont alors créées. Citons simplement le Combahee River Collective dont les membres se revendiquaient ouvertement homosexuelles et luttaient pour la prise en compte de toutes les discriminations. Comme le souligne Jules Falquet [7], ces femmes ont élaboré leur réflexion à partir de leur pratique de lutte collective et elles ont mis en bonne place la dimension de classe et celle du lesbianisme. Elles ont proposé le concept de système d’oppressions, avant l’apparition du terme d’intersectionnalité.
2. Le contexte français
En France, le chemin fut tout autre. Pour bien le comprendre, il n’est pas inutile de faire un petit retour historique sur les contextes dans lesquels ont émergé, en France, la vague féministe des années 1970 et la nouvelle vague féministe aujourd’hui.
Une partie de la jeunesse, notamment estudiantine, qui a participé au mouvement de Mai 1968 s’était politisée dans les années précédentes dans le cadre de la lutte contre la guerre d’Algérie, puis contre la guerre au Vietnam menée par l’impérialisme américain à la suite de la défaite du colonialisme français en Indochine. Au lendemain de Mai 1968, les femmes qui avaient été partie prenante de ce grand mouvement social ont décidé de bousculer la vie politique par des revendications contre l’oppression patriarcale, qui étaient systématiquement étouffées par leurs compagnons de lutte au nom d’autres priorités (celles de la lutte des classes) et par les gouvernements de droite partisans de la restauration de « l‘ordre » sous toutes ses formes. Il était question pour ces féministes non pas de nier la lutte de classes mais de l’enrichir ou de l’éclairer à la lumière du mouvement féministe qui défendait le droit des femmes à disposer de leur corps, à résister aux violences sexistes aussi bien dans la rue, au sein de la famille ou au travail et à s’auto-organiser contre leur oppression. Cette volonté de changer le monde et leur vie conduisit plusieurs centaines de milliers de femmes à participer massivement aux manifestations pour le droit à l’avortement et à la contraception libres et gratuits. Ces revendications ne restèrent pas confinées dans un petit cercle de femmes intellectuelles. Elles donnèrent lieu à des débats passionnés dans de nombreux secteurs de la société, grâce notamment à l’action des féministes « lutte de classes » dans les « groupes femmes » de quartiers ou dans des groupes femmes ou commissions syndicales femmes d’entreprises. [8]
Parallèlement à ces mobilisations, un travail d’élaboration théorique s’est approfondi aussi bien dans le milieu militant que dans celui de la recherche pour réfléchir sur la pertinence des concepts marxistes pour analyser l’oppression combinée du patriarcat et du capitalisme. En France, le marxisme était effectivement une référence majeure pour une grande partie des mouvements militants et parmi les intellectuel·les de gauche. C’était le reflet de la continuité de la force des luttes de classes depuis près de deux siècles dans le pays et de la force du Parti communiste depuis la Seconde Guerre mondiale en particulier.
Néanmoins le marxisme de l’après Mai 1968 nécessitait un sacré dépoussiérage après les années de dogmatisme stalinien porté par le Parti communiste de l’époque et dont n’étaient pas exemptes différentes composantes de l’extrême gauche. Parmi tous les concepts inspirés par le féminisme, il y a celui de travail domestique théorisé par Christine Delphy [9]. Dans les années 1980, d’autres concepts vont émerger comme celui de « division sociale et sexuelle du travail », de « rapports sociaux de sexe » ou de « consubstantialité » [10] . Ces trois derniers concepts, repris ou élaborés par la sociologue Danièle Kergoat en particulier, avaient en commun d’analyser la place respective des femmes et des hommes dans les différentes sphères de la société en fonction non pas d’une nature biologique mais des assignations sociales (aux femmes les soins et la reproduction de la force de travail, aux hommes la production et les activités sources de prestige) et des rapports hiérarchiques dans lesquels sont inséré·es femmes et hommes ; d’appréhender les rapports sociaux comme des rapports de domination (au sens large du terme) qui mettent en opposition des groupes sociaux antagonistes autour d’enjeux , en particulier celui du travail (dans toutes ses dimensions), susceptibles de se transformer historiquement sous l’effet des résistances collectives des groupes assujettis, de leurs révoltes. Il s’agissait enfin d’articuler ces différents rapports sociaux pour comprendre la société. Ainsi, pour Danièle Kergoat : « Les rapports sociaux sont multiples et aucun d’entre eux ne détermine la totalité du champ qu’il structure. C’est ensemble qu’ils tissent la trame de la société et impulsent sa dynamique : ils sont consubstantiels. »
D. Kergoat et d’autres sociologues ont montré les conséquences de la lutte féministe inaboutie contre le partage inégal des tâches domestiques entre femmes et hommes et celles de la mondialisation capitaliste. Ainsi, loin de répondre à la demande d’une large partie des féministes d’un réel partage des tâches domestiques et de services publics de qualité pour accueillir les très jeunes enfants et prendre soin des personnes dépendantes, les gouvernements occidentaux, appliquant en majorité des politiques de réduction des investissements dans les équipements et les services publics, ont surtout facilité le développement de services privés d’aide à domicile. Ceux-ci soulagent la vie des femmes – cadres essentiellement – susceptibles d’assumer le coût représenté par l’emploi, sous différents statuts, de femmes, souvent d’origine étrangère. C’est ainsi qu’une nouvelle domesticité a émergé, ainsi que de nouvelles différenciations sociales entre femmes, non seulement au sommet de la hiérarchie sociale mais dans des couches sociales plus larges, en fonction de leurs origines et de leur niveau de diplômes. Illustration donc de l’interaction entre les différents rapports sociaux.
Remarque : le croisement genre/race/classe n’est pas une nouveauté. Comme le souligne Danièle Kergoat, sans remonter jusqu’à Flora Tristan, bon nombre de travaux en France n’ont pas attendu les études postcoloniales ou le Black feminism pour insister sur « l’intrication » des dominations et sur les divisions dues aux inégalités de classe, de sexe et d’appartenance ethnique. Aujourd’hui, la formulation la plus diffusée tant au plan international qu’en France est celle « d’intersectionnalité ».
3. L’intersectionnalité : indispensable… moyennant quelques précisions
Aujourd’hui, tout le monde à gauche, ou presque, se déclare « intersectionnel·le ». Cela signifie peut-être qu’il y a une vraie prise de conscience que les nouveaux prolétaires de tous les pays sont pris dans des rapports sociaux de domination dans lesquels interagissent à la fois les processus de la mondialisation capitaliste, les rapports sociaux de genre, les processus de « racialisation » et l’héritage du colonialisme… C’est plutôt encourageant pour toutes celles et tous ceux qui veulent changer ce monde d’injustices et de violences. On peut donc s’en réjouir à condition d’apporter quelques précisions importantes.
Ne pas raisonner en essentialisant les identités
Il faut s’attacher, non pas à « cartographier » des identités figées mais à analyser les contradictions sociales liées à l’évolution historique et à l’interaction des principaux rapports sociaux et à leur configuration dans telle ou telle société (Kergoat 2009). À ce titre, il est toujours problématique de désigner comme des catégories homogènes les « blancs », les « noirs », les « juifs », les « femmes », les « hommes », etc. Comme si tous les blancs ou tous les noirs s’inscrivaient de la même manière dans le système colonial ou postcolonial ; ou comme si toutes les femmes vivaient l’oppression patriarcale de la même manière.
Ne pas réduire l’intersectionnalité au seul rapport de « race »
Il n’est pas pertinent, en effet, d’analyser les injustices dont sont victimes, par exemple, les jeunes des quartiers populaires à la lumière du seul rapport de « race » ou du postcolonialisme comme on le lit parfois. C’est appauvrir l’analyse et se vouer à une impasse politique.
Si l’on remonte seulement aux débuts des années 1980 en France, il y a eu un tournant majeur dans l’orientation de la gauche de gouvernement : dans son programme, François Mitterrand avait promis le droit de vote aux élections locales pour les étrangers, promesse qui n’a jamais été respectée. En 1983, il avait reçu en grandes pompes les jeunes qui avaient organisé la « Marche pour l’égalité » et traversé la France de Marseille à Paris pour dénoncer les violences et les crimes racistes. Cette mobilisation avait permis l’obtention d’une carte de séjour de dix ans pour les immigré·es, mais très vite la situation se dégrada – F. Mitterrand a même repris le vocable de « seuil de tolérance » – et aux espoirs succédèrent les désillusions, notamment du côté des quartiers populaires. L’année 1983 marqua le tournant de la « rigueur » et de l’austérité adoptée pour rassurer les marchés financiers ; en même temps, les ouvriers immigrés grévistes dans le secteur de l’automobile à Talbot Poissy ont été désignés par plusieurs ministres, dont Mauroy, comme les principaux responsables manipulés par des groupes religieux intégristes. Ce qui ouvrit un boulevard à la droite, à l’extrême droite et à une surenchère raciste et sécuritaire. Les attentats contre le World Trade Center aux États-Unis en 2001 ou ceux de 2015 en France ont ensuite favorisé les amalgames entre immigrés, musulmans et terroristes. Le racisme a pris une forme de plus en plus décomplexée, et il a aussi été utilisé pour faire diversion face aux revendications sociales.
On comprend néanmoins pourquoi dans les quartiers populaires, certains jeunes qui subissent le chômage, de multiples discriminations, le racisme ou les violences policières sont conduits à chercher du côté du seul racisme et/ou de l’héritage du colonialisme, l’explication à leur précarité sociale. Cependant de nombreux jeunes des deux sexes qui travaillent pour subvenir à leurs besoins, par exemple dans la restauration rapide, les grandes surfaces ou comme livreurs pour les plateformes savent bien qu’ils et elles sont victimes à la fois du racisme, de la recherche continuelle de profits qui dégrade leurs conditions de travail, et aussi du sexisme comme l’expérimentent les salariées dans tous les secteurs de la société. Dans ces conditions, la stratégie la plus efficace pour faire reculer le patronat, les racistes et les sexistes est celle de la convergence des luttes, même si elle est très difficile à concrétiser, pour rompre l’isolement des uns, des unes et des autres.
« Féminisme blanc » ?
De ce point de vue, les efforts répétés de certaines féministes pour dénigrer ce qui est nommé le « féminisme blanc », pris encore une fois comme un tout homogène, est parfaitement contre-productif. Depuis plusieurs années, se développe en effet l’idée que le mouvement féministe en France, et plus largement en Europe, serait dominé par des « féministes blanches » intellectuelles de la classe moyenne. Celles-ci auraient sacrifié la lutte anti-impérialiste et antiraciste au profit d’une prétendue conception occidentale du féminisme fondée sur des privilèges obtenus par « les femmes blanches » grâce à leur complicité avec le colonialisme et l’impérialisme de l’Occident. [11]
Tout d’abord, il s’agit d’une contre-vérité quant à l’histoire même du mouvement féministe en France. Dès les années 1970, sa composante « lutte de classes » a œuvré pour la convergence des luttes avec celles des femmes des milieux populaires et avec les femmes immigrées [12] . Une illustration en est, encore récemment, le soutien à la longue grève des femmes de chambre immigrées de l’hôtel Ibis, ou encore la tenue d’assemblées générales communes entre des féministes et des femmes gilets jaunes, ou la participation de féministes aux cortèges des femmes Gilets Jaunes. Ensuite, répétons-le, les « femmes blanches », pas plus que « les blancs », ne peuvent être considérés comme un groupe homogène que l’on pourrait rendre responsable de maux divers. Comme toute essentialisation, cela n’a aucune pertinence. Au sein de la population blanche, l’histoire fourmille d’exemples de persécutions (pogroms contre les juifs) ou de discriminations (contre les Roumain·es ou les Roms), etc. De même, les femmes, qu’elles soient blanches ou noires, vivent des situations très différentes selon qu’elles appartiennent aux classes populaires ou à la classe dominante [13]
Faut-il alors se réclamer d’un féminisme décolonial ? [14]
Oui, si cela signifie décentrer notre regard féministe par rapport à l’Europe pour mieux prendre en compte les luttes des femmes et des féministes dans le monde, contre l’esclavage, contre le colonialisme ou le post-colonialisme.
Oui encore, s’il s’agit de prendre en compte l’héritage transmis par la colonisation dans nos sociétés : car la colonisation, évidemment criminelle, a non seulement laissé de profondes traces qui ont été bien décrites en leur temps par Franz Fanon et d’autres. Mais elle a aussi contribué au maintien de pratiques racistes à différents niveaux dans l’administration française, en particulier dans la police. La fin officielle du colonialisme n’a pas mis fin aux échanges inégaux entre l’ancienne puissance coloniale et les anciens pays colonisés avec, le plus souvent, la complicité de dirigeants corrompus dans les anciennes colonies.
Non, s’il s’agit d’adopter une analyse dans laquelle le colonialisme surdétermine l’ensemble des rapports sociaux. Sans compter que le terme de colonisation est maintenant utilisé par l’extrême-droite pour désigner le processus d’immigration en France, les anciens colonisés coloniseraient la France !
Non encore, s’il s’agit au nom de la lutte contre le racisme décrétée prioritaire, de nier ou de délaisser ce qui est à la base de la lutte des féministes dans le monde : le droit des femmes à disposer librement de leur corps sans être dans la dépendance et le contrôle des hommes dans la société et la famille. Or, pour certaines [15]. par exemple, il ne s’agit plus seulement d’affirmer sa solidarité avec ses « frères » face aux discriminations et aux violences policières, mais plutôt de faire purement et simplement acte d’allégeance, ce qu’avaient précisément mis en cause les féministes africaines-américaines.
Ne pas valider l’idée de « privilège blanc »
La notion de « privilège blanc » est venue se greffer sur cette catégorisation indue. Elle est non seulement infondée, mais dangereuse. Infondée, car quels seraient les privilèges, au sein de la population blanche, des ouvriers et ouvrières, des personnes sans emploi, des précaires par rapport aux personnes « de couleur » des classes dominantes des pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique, etc. ? Adopter l’idée d’un privilège blanc revient à réduire l’ensemble des rapports sociaux à la prééminence de la couleur de peau… à l’opposé donc de l’analyse intersectionnelle ! Certes, en tant que « blancs », les hommes et les femmes ne sont pas confronté·es aux multiples discriminations auxquelles les descendant·es d’immigré·es et immigré·es ont à faire face : parcours scolaires, emplois, chômage, logements, ségrégation urbaine, ni bien sûr aux violences, voire aux crimes racistes ; beaucoup sont néanmoins confronté·es à d’autres discriminations et inégalités. Mais surtout, il est à la fois aberrant et politiquement dangereux de transformer une absence de discrimination en privilège : cela revient à escamoter la réalité des discriminations et à inverser le problème en désignant des prétendus privilégiés, donc, de manière implicite, des coupables. Or ce n’est pas parce qu’on n’est pas discriminé qu’on est privilégié ! Il ne faut surtout pas abaisser la norme : pouvoir vivre sans subir de discriminations, avoir un emploi, un logement, etc. relèvent des droits – qui restent certes à réaliser et pour lesquels on lutte –, mais non de privilèges ! Il serait mortifère d’en venir à considérer, par exemple, les personnes qui ont un emploi comme privilégiées par rapport à celles qui n’en ont pas.
Cette notion dévoyée de privilège relève en outre d’une vision individualiste psychologisante et culpabilisante fondée essentiellement sur des comportements individuels. Elle a pour effet de suggérer une confrontation entre individu·es. Au contraire, raisonner en termes de lutte contre les inégalités débouche sur une réponse collective, dans un cadre unitaire (associations féministes, antiracistes, de jeunes, syndicats…) visant à la transformation des rapports sociaux. Ceci n’est d’ailleurs pas contradictoire avec des pratiques de réunions non mixtes : celles-ci répondent ponctuellement au besoin de certaines personnes vivant une même situation de discrimination, de racisme ou sexisme, de partager plus facilement leur expérience. Ces réunions constituent un palier utile dans la mobilisation.
Féministes intersectionnelles et universalistes
Nous sommes des féministes, intersectionnelles – avec les nuances apportées précédemment – et universalistes. L’universalisme dont nous nous revendiquons doit, lui aussi, être clarifié. Ce n’est pas la conception abstraite de la citoyenneté qui affirme l’unité du genre humain et l’égalité, en restant aveugle aux discriminations diverses pourtant bien réelles. L’universalisme ne doit pas non plus être identifié aux discours de personnes médiatisées qui s’en réclament et qui tiennent souvent en son nom des discours réactionnaires opposant le monde occidental idéalisé et le reste du monde. Ces propagandistes passent, le plus souvent, par pertes et profits les ravages de l’esclavage, du colonialisme et de l’impérialisme mais également les injustices et les violences liées à l’exploitation capitaliste, au racisme et aux différentes formes de domination liées à la question du genre. Or ces injustices et ces violences ne sont pas propres à telle ou telle société mais concernent malheureusement l’ensemble de la planète. Les féministes, et plus largement les femmes, sont bien placées pour se méfier d’une certaine proclamation d’universel complètement en décalage avec la réalité ; rappelons-nous l’expérience du suffrage (dit) universel de 1848 dont elles furent exclues jusqu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Notre universalisme concerne un idéal à atteindre, qui part des conditions de vécu des discriminations et qui s’appuie sur les luttes concrètes et les inégalités vécues au jour le jour pour proposer des politiques alternatives et changer les rapports sociaux. Il affirme le principe politique de droits universels – à l’égalité, à l’éducation, la santé, la liberté, la paix, etc. – qui sont à concrétiser pour tous les êtres humains.
L’antagonisme entre intersectionnalité et universalisme, trop souvent considéré comme une évidence, produit et entretient une division très néfaste en particulier au sein des féministes. Pourtant il s’efface, ou plus exactement il laisse la place à une large plage de consensus pour des luttes communes, pour peu qu’on s’attache à en clarifier les termes. Il ne s’agit nullement de distribuer des labels pour l’un ou l’autre de ces concepts, nous avons simplement souhaité présenter notre conception, pour éviter les fausses oppositions. Les féministes doivent pouvoir se rassembler sur des objectifs et des luttes communes : prendre la défense des femmes chaque fois qu’elles sont attaquées en tant que femmes, être aux côtés des personnes « racisées » chaque fois qu’elles subissent des discriminations et aux côtés des salarié·es qui se heurtent à l’exploitation et à la précarité de leurs conditions, dénoncer les discours racistes, nationalistes et complotistes alimentés tout particulièrement par l’extrême droite ainsi que ceux des fondamentalistes religieux qui légitiment la subordination des femmes à tous les niveaux. C’est seulement par notre capacité d’affronter toutes les dominations simultanément, sans les hiérarchiser, que nous pourrons stopper les régressions sociales, économiques et sociétales en cours et construire une société plus juste.
Catherine Bloch London, Christiane Marty, Christine Mead, Josette Trat, Marielle Topelet, membres de la Commission Genre d’Attac - septembre 2021.
Notes
[1] La majuscule à « Noires » était revendiquée par les Black feminists.
[2] Jaunait A., Chauvin S. « Représenter l’intersection » Les théories de l’intersectionnalité à l’épreuve des sciences sociales. Revue de Science Politique 2012/1/vol 62 pp. 5-20.
[3] Marouz Sarah, « Race », Éditions Anomosa, 2020
[4] bell hooks (sans majuscule, à sa demande), « Sororité : la solidarité politique entre toutes les femmes » dans E. Dorlin (dir.), Black feminism, anthologie du féminisme afro-américain, 1975-2000 L’Harmatan 2008.
[5] Leur critique rejoint celle formulée par le courant féministe luttes de classe en France concernant le concept d’« ennemi principal » défendu par Christine Delphy.
[6] Adrienne Rich, « Disloyal to Civilization. Feminism, Racism, Gynephobia » citée par Jaunait et Chauvin,
[7] Falquet Jules, « Imbrication – Femmes, race et classe dans les mouvements sociaux », Éditions du Croquant, 2019.
[8] Trat Josette (2007) : « L’histoire oubliée du courant “ féministe luttes de classes ”, Femmes, genre, féminisme, pp. 9-32, Syllepse, en ligne sur le site Europe Solidaire Sans Frontières (ESSF).
[9] Delphy Christine (1998) : « L’ennemi principal, 1. Économie politique du patriarcat », Syllepse, 1998.
[10] Kergoat Danièle : - (2005), « Rapports sociaux et division du travail entre les sexes », Femmes, genre et sociétés, l’état des savoirs, sous la direction de Margareth Maruani, pp. 94-101, La Découverte.
![]() (2009), « Dynamique et consubstantialité des rapports sociaux », dans Sexe, race et classe, sous la direction d’Elsa Dorlin, p. 111-125, PUF.
(2009), « Dynamique et consubstantialité des rapports sociaux », dans Sexe, race et classe, sous la direction d’Elsa Dorlin, p. 111-125, PUF.
![]() (2021), « Penser la complexité : des catégories aux rapports sociaux », La Pensée N° 407, J/A/S.
(2021), « Penser la complexité : des catégories aux rapports sociaux », La Pensée N° 407, J/A/S.
[11] Thèse développée par Françoise Vergès. Pour une critique de cette thèse, voir Josette Trat, « Françoise Vergès, une féministe problématique », Contretemps n°41, 2019.
[12] Claudie Lesselier (2007) : « Pour une histoire des mouvements de femmes de l’immigration en France », Femmes, genre, féminisme, pp. 71-104, Syllepse.
[13] Voir notamment « Quand les femmes se heurtent à la mondialisation », Attac, Mille et une nuits, 2003.
[14] Comme le font en France Françoise Vergès et Houria Bouteldja
[15] C’est le cas d’Houria Bouteldja. Elle a écrit en 2016 : « Mon corps ne m’appartient pas. […] J’appartiens à ma famille, à mon clan, à mon quartier, à ma race, à l’Algérie, à l’islam. J’appartiens à mon histoire et si Dieu veut, j’appartiendrai à ma descendance » in « Les Blancs, les Juifs et nous », pp. 71-72, La Fabrique. Ce qui est son droit le plus strict mais qui pose des questions sur le sens qu’elle donne au mot féminisme