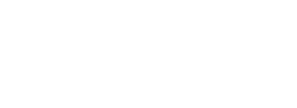Intranet
Accueil > Points de vue & interviews > Gustave Massiah |
Une interview exclusive de... Gustave MassiahMembre du conseil international des Forums sociaux mondiaux, ancien président du CRID 2008 Ingénieur économiste de formation, Gustave Massiah est consultant et professeur dans une école d’architecture. Très impliqué dans les ONG de solidarité internationale et de droits humains et dans le mouvement altermondialiste, Gus Massiah a été président du CRID (Centre de recherche et d’information sur le développement, collectif d’une cinquantaine d’ONG), il est membre fondateur du CEDETIM (Centre d’études et d’initiatives de solidarité internationale), de l’AITEC (Association internationale de techniciens, experts et chercheurs) et du réseau IPAM (Initiatives pour un autre monde). Il est membre fondateur et membre du Conseil scientifique d’ATTAC (dont il a été vice-président de 2001 à 2006) et du Conseil International du Forum Social Mondial. Il a publié de nombreux écrits, articles et contributions sur les thématiques du développement, des rapports Nord/Sud, de la solidarité internationale, des droits économiques, sociaux et culturels... |
 |
Dans cet entretien Gus Massiah développe une réflexion philosophique, éthique et politique autour des notions de droits et de développement.
Droits individuels, droits collectifs, droits des peuples
On parle du « droit des peuples au développement ». Est ce que la notion de « droit des peuples » n’est pas obsolete par rapport au « droit humain », au droit « de la personne » ? Un peuple est-il un ensemble homogène ?
Je parle du « droit des peuples », pas du droit « du peuple » . Ma définition de « peuples » n’est pas un raccourci pour « Nation », « Etat » - souvent,en effet, on part de l’idée de peuples, comme étant ce qui a donné naissance à la Nation, puis à l’Etat. Je pense que la notion de peuple est fondamentale. Comme disait un grand juriste, Chaumont, « Le peuple est le produit de son histoireson histoire, un peuple est le produit de l’histoire de ses luttes ». Ainsi, de même que Renan définissait la Nation à partir d’un projet et non pas d’un passé, on peut dire que le peuple est une notion en construction. Le fait qu’il existe des classes, des conflits sociaux, culturels, etc. n’annule pas la notion de peuples. Evidemment, dans un même peuple il y a plusieurs classes sociales. Je ne fais pas de la notion de peuples une manière d’évacuer les conflits, les contradictions. Mais justement, le peuple définit un cadre dans lequel ces contradictions et ces conflits prennent leur sens et s’inscrivent dans une perspective.
Quel est le contexte historique de la revendication du « droit des peuples » ?
J’ai participé dans les années 70 à la création et l’animation de la Ligue internationale pour les droits des Peuples - qui s’appelait au départ « pour les droits et la libération des peuples ». Effectivement la notion de peuple est toujours très liée à chacune des périodes. A l’époque, la question posée était celle de la décolonisation, de la rupture avec la colonisation et cette rupture passait par le droit à l’auto-détermination des peuples, reconnu dans le droit international. Le droit à l’autodétermination peut aller jusqu’à l’indépendance d’un Etat, mais n’y va pas automatiquement. Il y a des peuples sans Etat, il y a des peuples qui sont sur plusieurs Etats, etc. Je n’adhère pas du tout à une notion « un peuple, une Nation, un Etat ».
L’intérêt de la notion de peuple est justement aussi sa plasticité, la possibilité d’évoluer, de s’adapter à des situations.
Quelle articulation entre droits individuels et droits collectifs ?
Il y a un grand débat sur le rapport et l’articulation entre droits individuels et droits collectifs et notamment droits des peuples. Beaucoup de gens ont considéré très longtemps que les droits des peuples étaient une manière de nier les droits individuels. Mais les droits individuels ne sont pas supérieurs aux droits collectifs et vice-versa. Les deux sont complémentaires. Dans l’ensemble des droits, certains s’expriment individuellement, d’autres ne peuvent se concevoir que collectivement (par exemple, le droit d’association, le droit de parler sa langue).
Développement, transformation sociale
Que signifie la notion de développement ?
C’est à partir de ces questions de droits qu’on arrive à la notion de la transformation sociale, qu’on appellera pour simplifier « développement ». L’histoire même du mot développement est ancienne. Au 18ème siècle, le « développement » est le contraire de « l’enveloppement ». C’était l’idée de s’ouvrir à l’extérieur au lieu de se refermer.
Dans les années 80, les associations de solidarité internationale ont mis en avant l’idée de développement, portée par le mouvement de décolonisation, en réaction à la notion d’urgence et d’humanitaire. Par rapport à la montée en puissance du mouvement humanitaire qui privilégiait l’urgence, nous indiquions qu’on ne pouvait pas avoir de transformation sociale sans une transformation structurelle, sans agir sur la durée et sur les causes structurelles des problèmes. A l’époque, il y a eu un grand débat sur la nature du développement, le modèle de développement, etc.
Aujourd’hui, la montée en puissance de l’écologie, de ce nouveau paradigme dont fait partie le développement durable, a remis en cause la question du développement, même sans aller jusqu’à la décroissance. Une contestation est intervenue de ce qui était devenu une religion du développement (cf. les travaux de François Partant). On faisait n’importe quoi au nom du développement. Prenons le cas de la dictature chilienne considérée par les premiers néo-libéraux et notamment Friedman, comme le modèle du développement. On peut faire le parallèle avec Alain Joxe, qui disait que De Gaulle et l’armée française ont choisi le nucléaire pour « se développer » et se « moderniser » ; l’unité nationale comprise par les militaires français, c’était la place de la puissance française dans le monde, et donc le nucléaire. Dans les pays du Sud, les militaires prenaient le pouvoir au nom du « développement ». Le « développement » a très mal résisté à cette appropriation politique.
C’est pourquoi je préfère parler de transformation sociale plutôt que de développement.
Comment cette transformation sociale est-elle possible aujourd’hui, comment se met-elle en oeuvre ?
Même si on réfute le « développement » au sens galvaudé du terme, une question est posée : un peuple doit-il subir son avenir, soit à travers ses formes d’organisation populaire, soit à travers les formes nationales ou étatiques, ou a-t-il la possibilité de maîtriser son avenir ?
Maîtriser son avenir, cela veut dire qu’il faut s’organiser, avoir une idée de où on veut aller, il faut des objectifs, une stratégie, des politiques. C’est l’ensemble de ces trois instances qu’on regroupe dans l’idée de modèle de développement (organisation, objectifs, stratégie et politiques de mise en œuvre). Alors que le développement comme « religion » court à l’échec.
• La première question qui se pose à un peuple est : est-ce qu’il pense qu’il est comptable de son avenir ? Dans ce cas, quel modèle de transformation sociale choisit-il ?
Quand nous disons : un peuple a le droit de choisir son modèle de développement, ça veut dire d’abord qu’il a le droit de refuser qu’on lui en impose un. Cela ne veut pas dire qu’il a le droit de le choisir sans tenir compte de rien d’autre. La liberté dépend d’un certain nombre de contraintes. La liberté est « situationnelle » comme disait Sartre. Elle dépend du contexte. Choisir son modèle de développement, c’est le choisir dans une période et dans une situation données, en fonction d’une histoire.
Cela implique que ce peuple soit libre de choisir ses objectifs. C’est la première étape du droit au développement. Cela suppose tout d’abord le droit d’en discuter, le droit à un débat politique contradictoire. Dans un peuple, certains choisiront des objectifs inégalitaires, d’autres des objectifs égalitaires, certains des objectifs laissant une place aux libertés, d’autres un modèle de type autoritaire, certains un modèle acceptant le paradigme écologique, d’autres qui le refuseront, des objectifs pacifiques, des objectifs de guerre… Le débat sur les objectifs est un débat politique, à l’intérieur de chaque peuple et entre les peuples. On n’est pas libre de choisir ses objectifs n’importe comment. La liberté de décider des objectifs dépend évidemment des libertés des autres. Ceci non seulement par crainte des représailles des autres, mais aussi parce que la manière de respecter les libertés des autres est une manière de construire sa propre liberté. C’est un élément très important. « Un peuple qui en domine un autre n’est pas un peuple libre » a-t-on dit. A priori le refus d’un objectif de domination des autres n’est pas seulement un objectif de réalisme, c’est aussi un choix philosophique.
Donc, dire qu’un peuple a le droit de choisir ses objectifs, cela veut dire qu’il a d’abord le droit d’en discuter. C’est pourquoi je dis que le droit de choisir est d’abord le droit de refuser celui qu’on veut vous imposer, par exemple le dogme de l’ajustement structurel imposé par la Banque mondiale, et de savoir quelles sont les marges de manœuvre dont on dispose par rapport à ses objectifs et quelles sont celles qu’on veut prendre par rapport à son histoire et à son projet.
• Ensuite, dans un deuxième temps, se pose la question de la stratégie et des politiques qui en découlent, c’est-à-dire comment, à partir d’une situation donnée, on va essayer d’aller vers la réalisation des objectifs.
Là aussi, il est important que les débat sur les stratégies tiennent compte du contexte, des contraintes et du passé, ainsi que du projet. De ce point de vue, il faut se définir par rapport aux stratégies qui sont dominantes. Le premier droit est d’abord celui de refuser les stratégies de transformation sociale dominantes. C’est-à-dire, pour simplifier, les programmes d’ajustement structurel, qui concernent les pays du Sud, mais qui nous sont aussi imposés : l’ajustement de chaque société au marché mondial, lequel est défini par la logique du marché mondial des capitaux. Ce marché se traduit par des politiques très concrètes : ouverture des frontières pour les capitaux, mais pas pour les hommes et les femmes ; liquidation des structures de protection sociale ; libéralisation et privatisations ; liberté données aux entreprises multinationales pour investir là où elles veulent sans contrainte, etc. Tout cela constitue une stratégie.
C’est important qu’un peuple puisse discuter de cette stratégie. Un peuple peut dire : nous refusons cette stratégie, nous en choisissons une autre complètement différente. Ou alors il peut dire : au contraire, nous allons essayer de biaiser, de ruser de façon à rapprocher la stratégie de nos objectifs. Ou doit-il adapter ses objectifs à la stratégie ? Aujourd’hui le modèle dominant de transformation sociale est celui qui oblige d’adapter les objectifs à la stratégie, plutôt que d’adapter la stratégie aux objectifs. Ceci constitue un point déterminant et c’est là que se pose la question du contrôle démocratique. Par exemple, parmi les très nombreuses propositions issues des Organisations de solidarité internationale, il y a le contrôle des politiques imposées par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, la possibilité de pouvoir discuter dans les Parlements de ces programmes d’ajustement structurel.
Autre élément très important – qui relève du cercle vertueux par opposition au cercle vicieux – c’est qu’à partir du moment où les objectifs sont adoptés à travers un débat démocratique populaire et où les politiques et stratégies sont définis par rapport à ce processus démocratique, il y a une capacité de mobilisation et de dynamisme, qui sont des facteurs de la réussite de la transformation sociale. Plutôt que d’imposer par la force, par la répression ou par des circonvolutions idéologiques un certain modèle, on a là la possibilité d’une vraie participation et mobilisation.
Est ce qu’un tel processus de transformation sociale démocratique a déjà existé ou peut exister en ce moment ?
Oui, ça a souvent existé historiquement. Pas à partir d’une discussion polie, mais à travers les mouvements et les luttes. Par exemple, en 1936 en France, je pense qu’il y a eu un vrai débat sur quels objectifs et quelles stratégies. C’est très difficile de savoir dans le moment pendant lequel on vit si ça se passe comme ça. Dans la période actuelle, un tel processus est probablement plus difficile, parce que nous sommes dans une phase d’hégémonie du modèle dominant. En France, toujours, le type de modèle qui a été développé - à travers beaucoup de contradictions - entre 1945 et 1975 était un modèle qui permettait un certain débat sur des objectifs. Il y a eu des compromis sociaux, une stratégie a été mise en œuvre, correspondant à une forme de modèle, malgré des contradictions extrêmement fortes. Il faut bien voir que la transformation sociale ne s’analyse pas de manière abstraite. C’est d’abord la capacité à refuser un modèle imposé et ensuite celle d’agir à travers des contradictions qui sont à l’œuvre.
La « transformation sociale » ou « développement » peut être mauvais ou bon, défavorable ou favorable ? Peut-il y avoir un mauvais type de développement, de transformation sociale ?
Il faut toujours tenir compte des contradictions permanentes. Par exemple, la période vichyiste en France a été une période de grande modernisation économique, mais aussi de grande injustice sociale – sans oublier le caractère déterminant de la question de l’occupation - qui s’est traduite par une très forte régression au niveau social et populaire.
La seule façon pour que la prise de conscience fasse son chemin est que le modèle puisse être discuté. En ce qui concerne les 30 glorieuses, on peut dire que la prise de conscience écologique a trouvé son chemin, en partant de travaux comme ceux du Club de Rome. Mais au départ cette prise de conscience a plutôt été mise au service d’une remise en cause d’acquis sociaux, avec des propositions alternatives de croissance économique zéro, de croissance démographique zéro… jusqu’au moment où, petit à petit, le mouvement écologiste s’est dégagé de cette optique régressive et parfois manipulée.
Droits, devoirs, droits environnementaux
Les droits impliquent-ils des devoirs ? Par exemple la Charte de l’environnement, adossée à la constitution, indique que chacun a le « devoir de préserver l’environnent »
C’est un débat philosophique ancien, mais qu’on voit refleurir un peu partout, comme une réponse aux problèmes actuels. La Révolution française était déjà traversée par ce débat. Evidement, une liaison existe entre les droits et les devoirs. Mais la manière de poser cette liaison a un sens. Je ne pense pas que les droits soient justifiés par les devoirs. Je dirais qu’à l’inverse les devoirs sont justifiés par les droits. C’est dans la mesure où on a un droit que corrélativement il faut accepter un certain nombre de contraintes, de devoirs correspondant à ce droit. Mais l’idée que si on ne remplit pas ses devoirs, on n’a plus ses droits est une idée très dangereuse. Parce que les droits sont définis par l’appartenance à l’espèce humaine, en quelque sorte, et pas par l’acceptation de devoirs. C’est pour cela que je préfère parler de responsabilités plutôt que de devoirs. La première responsabilité étant d’assurer les droits pour tous.
Ce débat montre bien l’importance de la question des droits aujourd’hui. Il correspond à la recherche d’une alternative, dans la mesure où le modèle dominant depuis 1980 – le libéralisme économique - est fondé sur l’idée que chaque société peut être régulée aujourd’hui par son ajustement au marché mondial des capitaux. La conséquence est que la question des droits est secondaire. On a des droits si on est en capacité de les faire reconnaître, si on en a les moyens, si on a un revenu, en gros.
L’alternative qui émerge et qui est portée par le mouvement altermondialiste, c’est que la société peut être régulée autrement, sur la base de l’accès aux droits pour tous. Le changement est fondamental : il s’agit d’organiser la production et la société autour de cette idée d’accès aux droits pour tous. Cela renverse la logique économique, puisqu’il ne s’agit pas de définir une économie en fonction de la propriété du capital, mais en fonction des droits. Les conséquences de cette perspective sont considérables. Ca n’est pas simple à mettre en oeuvre, mais le capitalisme non plus n’est pas simple. Il en faut des experts et de l’énergie pour arriver à le faire fonctionner ! A mon avis, un modèle basé sur les droits pour tous seraient même plus simple à faire fonctionner que le capitalisme !
Cette approche par les droits est-elle en progression ? Et quelles sont ses implications ?
Cette idée a progressé, puisque, actuellement, dans le débat idéologique international et national, l’affirmation selon laquelle pour lutter contre une rareté, il faut augmenter la production par la croissance qui permettrait ensuite de réduire les inégalités, a été contredite par toutes les évolutions constatées et se trouve remplacée par l’idée qu’il faut organiser l’accès à la ressource. Les objectifs du millénaire pour le développement constituent un exemple de cette évolution. Pour la première fois au lieu de dire « il faut faire de la croissance et ouvrir le marché mondial », la communauté internationale dit « il faut assurer la lutte contre la faim, contre la mortalité infantile » etc. Certes, les objectifs sont formulés d’une façon que nous contestons beaucoup, puisque dans un monde aussi riche que le notre il est scandaleux de fixer comme horizon de réduire de moitié d’ici 2015 le nombre de ceux qui ont faim, etc. Et en plus, la manière dont on les met en œuvre ne fonctionne pas, comme le montre le récent calcul qui établit qu’en Afrique il faudrait 110 ans pour atteindre les objectifs de 2012 des Objectifs du millénaire pour le développement. Ca montre bien que les OMD ont été réduit à une récupération publicitaire.
Mais quand même, les OMD ne sont pas que cela. C’est aussi, au niveau des Nations unies l’idée qu’il faut poser la question autrement. Il y a certes récupération, mais récupération par rapport à une critique qui a porté, la critique du modèle de croissance, doublement contesté, d’une part parce qu’il produit des inégalités sociales, d’autre part parce qu’il se heurte aux limites des écosystèmes. C’est quand même la première fois depuis 1980 qu’une déclaration des Nations unies sur le développement ne se réduit pas à un hymne à la croissance et au marché mondial.
Une deuxième réflexion est que, du point de vue philosophique, l’accès aux droits pour tous laisse un débat ouvert. Est ce que c’est l’accès aux droits pour tous ou l’égal accès aux droits pour tous ? Evidemment les approches sont différentes. Si on dit par exemple : il faut que tout le monde ait accès à l’eau, à ce moment-là bien sûr on peut s’arranger, mettre en place un système sur le modèle européen du service universel. Personne ne doit être empêché de téléphoner, donc les pauvres ont droit à, mettons 40 communications par mois, évidemment locales – puisqu’on ne voit pas pourquoi les pauvres auraient besoin de communications internationales. Ca sera gratuit, donc on aura donné l’accès. Pour l’eau, est ce qu’on va donner 20 litres par jour et par personne, 50, 600 comme pour les californiens actuellement ? Et cette égalité d’accès, doit-elle se faire au niveau local, national, des grandes régions, mondial ? Cela soulève un vrai débat, celui sur l’avenir de notre planète. Un débat dans lequel la question écologique est au centre.
En ce qui concerne l’accès pour tous, on peut s’organiser pour ne pas toucher aux limites de la planète, mais pour l’accès égal, non. L’accès pour tous exige une nouvelle forme de répartition et une remise en cause des riches, puisque la question de la pauvreté, ce n’est pas la question des pauvres, mais celles des riches.
Un autre problème philosophique est également posé par cette question de l’accès aux droits : qui assure l’accès aux droits et comment ? Actuellement dans notre modèle politique, surtout en France, nous avons cette idée que si le marchée ne peut pas assurer l’accès aux droits - ce qui est démontré - c’est à l’Etat de le faire. L’action politique consiste alors à faire reconnaître son droit par l’Etat, qui doit ensuite trouver les moyens de le garantir, à travers des services publics ou autres formes d’organisation. L’action politique s’oriente vers une revendication par rapport à l’Etat. Chaque catégorie sociale cherche à se faire reconnaître par l’Etat. La statistique entre en ligne de compte. Si on obtient de l’appareil statistique qu’il compte tous les ans les SDF, tôt ou tard une politique pour les SDF sera mise en œuvre, parce qu’ils seront visibles. Donc, il s’agit de se rendre visible en tant que catégorie et d’obtenir que l’Etat mette en œuvre une politique spécifique pour cette catégorie.
Or l’intervention de l’Etat pour donner l’accès aux droits est efficace et importante - mais elle n’est pas suffisante. C’était le débat philosophique du 19ème. Faut-il faire reconnaître les droits ou faut-il les garantir ? La Déclaration universelle des droits de l’Homme issue de la Révolution française ne garantit pas les droits, elles les reconnaît. C’est le débat entre Hegel et Marx : un droit qui est reconnu mais qui n’est pas garanti a-t-il un intérêt ? La reconnaissance du droit est un élément très important, qui ne relève pas que de l’Etat. L’Etat peut jouer son rôle mais ce n ‘est pas suffisant.
Cette réflexion a été forte à partir du mouvement féministe, d’abord, et des différentes minorités, notamment la question des Roms. Certains Etats reconnaissent des droits aux femmes, qui sont contestés par la société elle-même. L’Etat est parfois en avance sur la société. De la même façon, des maires sont d’accord pour trouver des terrains pour les Roms, comme la loi les y oblige, mais c’est la population de leur commune qui refuse. Là, il y a un problème de rapport entre la démocratie et les droits, qui est compliqué.
Autre problème complexe : les droits peuvent parfois être contradictoires. Par exemple, c’est tout à fait complémentaire d’être à la fois pour le droit de vivre et travailler au pays et pour le droit de circuler librement. Mais à priori cela demande une certaine dynamique pour concilier les deux. L’exemple le plus connu actuellement et le plus important est le droit à la protection intellectuelle d’un côté et de l’autre le droit de lutte contre les brevets pour l’accès aux médicaments génériques.
Enfin, dans le débat actuel sur les droits, ce qui est la vraie révolution en ce moment, c’est la montée en puissance de la notion de l’universalité des droits, notamment des droits civils et politiques et des droits économiques, sociaux et culturels… et environnementaux, qui ne sont pas encore reconnus au même niveau.
Y a-t-il une revendication d’intégrer les droits environnementaux dans les DESC ?
Oui. Mais cette revendication se heurte à un problème – d’ordre plutôt tactique, stratégique, à mon avis. Chaque fois qu’on discute de l’importance d’intégrer les droits environnementaux dans les Droits économiques sociaux et culturels, il y a un accord. Mais la perspective d’interrompre la mise en oeuvre du protocole additionnel sur les DESC pour réintégrer les droits environnementaux et recommencer en quelque sorte à zéro toute la dynamique visant à faire ratifier le protocole, se heurte à cette idée, qu’il faut essayer d’abord d’avoir ça, ensuite on continuera.
Consumérisme, développement, développement durable
Est-ce que le rouleau compresseur actuel du modèle de consommation et la publicité ne viennent pas interférer dans la capacité qu’auraient les peuples, notamment du Sud, de choisir leur mode de développement ? Beaucoup de gens veulent un mode de développement basé sur le coca cola et l’accumulation d’objets matériels.
C’est vrai que question de la consommation et des modèles de consommation vient compliquer les choses. Mais il s’agit plus d’un modèle culturel que d’un simple modèle de consommation. Une partie de l’intégration sociale se fait par la consommation et le marché, au Sud comme au Nord. Dans des banlieues chez nous, c’est par la consommation que se fait l’intégration. On a l’habitude de vouer ce modèle, ce comportement aux gémonies en considérant que c’est une preuve absolue d’aliénation. Pour ma part je ne le pense pas. Je pense qu’individuellement et collectivement, les gens se définissent par rapport à des possibles, pas seulement par rapport à des idéaux abstraits. Ils ont des objectifs, des valeurs, évidemment, d’ailleurs il y tiennent et essaient de les faire respecter. Mais ils sont confrontés à ce qui est possible. Or, une grand partie de l’intégration sociale passe par des modèles, des formes d’habillement, de langages, de consommation, de musiques, etc. qui sont accentués par la publicité, par les médias et la promotion commerciale et donc les gens les adoptent. Ils les adoptent, mais très souvent, ils biaisent avec cela, ils les modifient, les adaptent, ils ne font pas que s’y livrer pieds et p oings liés. Par contre, ce qu’ils ne supportent pas, c’est qu’on les empêche d’y accéder, parce qu’ils prennent cela comme une privation de liberté et moins le fait de ne pas pouvoir consommer, que le fait de se voir interdits de consommation, c’est à dire ramenés finalement dans une position subordonnée et dominée.
Je ne dis pas qu’il n’y a pas d’aliénation, mais il ne faut pas en surestimer le niveau. Il ne faut pas non plus considérer que c’est par la privation de liberté qu’on peut lutter contre certains modèles de consommation.
Dans son livre « Comment les riches détruisent la planète », Hervé Kempf montre comme le pauvre imite la classe moyenne, la classe moyenne imite le plus riche etc. Actuellement une fuite en avant fait que tout le monde a envie de vivre comme la jet set, ce qui nous tire vers un désastre écologique, et c’est impossible à démêler… Comment arrêter l’hyper consommation des riches ? Si tu devenais maître du monde, comment ferais tu pour traiter ce problème des riches ?
Si je devenais maître du monde, je démissionnerais tout de suite, puisque je suis contre l’idée d’un maître du monde.
Justement le problème ne peut pas être résolu de l’extérieur. C’est un élément tout à fait fondamental. Ce n’est pas bon, mais c’est normal, que dans une société – mondiale aujourd’hui – chacun essaie d’adapter son comportement pour avoir le maximum de marge de manœuvre et s’en sortir, puisque tout indique que la libération est individuelle. C’est normal en apparence. Dans une société où la richesse est la valeur, ce sont les plus riches qui apparaissent comme modèle de référence. Mais il existe encore beaucoup de régions dans le monde où ce modèle n’est pas dominant, où des valeurs collectives ont plus d’importance – même si ça peut parfois poser d’autres problèmes, des contraintes. Cette recherche effrénée de la consommation et des richesses n’est pas inhérente à la nature humaine. Elle répond à des situations flattées par la presse, les médias, la pub, etc.
Face à la crise écologique, penses tu que l’espèce humaine pourrait disparaître ?
Je reste globalement optimiste sur la nature humaine. Les hommes et les femmes sont capables, placés dans des situations difficiles, de ne pas faire le choix du pire. Je ne crois pas que l’espèce humaine disparaisse. Il y a des risques, liés à la crise climatique. Mais pas de fatalité. La crise actuelle mêle très étroitement la dimension écologique, la dimension sociale, et celle des guerres et des libertés. Aucune solution qui néglige une de ces dimensions n’est viable à terme. Elle ne peut qu’aggraver les contradictions. C’est en quoi le concept de développement durable est nécessaire.
Il faut évidemment tenir compte du danger à court terme constitué par le dérèglement climatique et engager urgemment une diminution des émissions de gaz à effet de serre. Mais en même temps, il faut s’attaquer à la question des inégalités sociales et à celle des guerres et des libertés. Sinon on ne pourra pas lutter contre le changement climatique.
Exemple : faut-il adopter le nucléaire à cause du réchauffement climatique ? Il est impossible de répondre à la question du nucléaire si on ne prend pas en compte la question des guerres et des libertés et celle de la démocratie.
Aucun mode de production ne peut échapper à cette analyse. La question la plus urgente est probablement celle de la paix et de la démocratie. Pas la démocratie au sens de liberté des capitaux, mais de la manière de préserver les libertés et de définir des décisions collectives !
Y a-t-il une différence entre la définition du développement durable et celle du développement vu par les Organisations de solidarité internationales ?
L’idée du développement par les OSI correspond à la définition du développement durable, qui relie ces quatre dimensions. Il faut adapter la question du développement durable au contexte. Prenons un pays en guerre, le Soudan. Allons nous aller leur parler de réduire leur émissions de gaz à effet de serre ? Ce n’est pas la question. La question est celle de la paix et des libertés. Si on veut pouvoir s’attacher à la survie de la planète et notamment aux aspects écologiques du développement durable, c’est inefficace de ne pas tenir compte des autres éléments. C’était le problème dans les années 70, cette vision trop unilatérale, par ex. la « Bombe P » s’attaquant à la démographie ; ce discours a entraîné des atteintes aux droits, comme des stérilisations forcées, etc. Actuellement une partie de la planète est gérée comme une zone de réserve et non de développement durable ; regardons par exemple les matières premières en Afrique.
L’analyse par le genre
Penses tu que l’analyse de genre soit pertinente ? Tu as critiqué le fait qu’elle soit utilisée par la Banque mondiale
Le fait que la notion de genre soit récupérée par la Banque mondiale au service de la croissance, n’enlève rien à la pertinence du concept. La Banque mondiale récupère tous les thèmes et les revendications des ONG et y instille sa vision libérale. Cela dit, elle est en crise profonde…
Le genre est un concept d’autant plus intéressant qu’il constitue une des clés de la compréhension des questions de discriminations. Il montre bien que la question des discriminations n’est pas liée au fait d’appartenir à des minorités.
Ressources Web
![]() CRID (Centre de recherche et d’information sur le développement
CRID (Centre de recherche et d’information sur le développement
![]() CEDETIM (Centre d’études et d’initiatives de solidarité internationale)
CEDETIM (Centre d’études et d’initiatives de solidarité internationale)
![]() AITEC (Association internationale de techniciens, experts et chercheurs)
AITEC (Association internationale de techniciens, experts et chercheurs)
![]() IPAM (Initiatives pour un autre monde)
IPAM (Initiatives pour un autre monde)
![]() ATTAC
ATTAC
P.-S.
![]() Nouveau : extrait du livre de Gustave Massiah, Une stratégie altermondialiste, La Découverte, janvier 2011
Nouveau : extrait du livre de Gustave Massiah, Une stratégie altermondialiste, La Découverte, janvier 2011
![]() Lire également sur le site Adéquations un article d’analyse et de réflexion de Gustave Massiah :
Lire également sur le site Adéquations un article d’analyse et de réflexion de Gustave Massiah :
- "Quel avenir pour les Forums sociaux mondiaux ?" et
- "les enjeux du Forum social 2011 à Dakar"