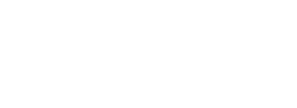Intranet
Accueil > Développement soutenable > Introduction au développement soutenable > Le développement durable, deux siècles de controverses (...) |
Le développement durable, deux siècles de controverses économiquesChapitre 1 du livre Le développement durable, dir. Catherine Aubertin et Franck-Dominique Vivien, La Documentation française Lundi 3 janvier 2011 Ce texte constitue le premier chapitre de l’ouvrage "Le développement durable", publié en 2010 à la Documentation Française, sous la direction de Catherine Aubertin et Franck-Dominique Vivien. |
A noter : il est interdit de reprendre des extraits de ce texte,
publié sur le site d’Adéquations avec l’aimable autorisation de l’éditeur,
la Documentation Française
DEUX SIECLES DE CONTROVERSES ECONOMIQUES
Valérie Boisvert et Franck-Dominique Vivien
![]() Valérie Boisvert : économiste de l’environnement, chargée de recherche à l’IRD (UR 199)
Valérie Boisvert : économiste de l’environnement, chargée de recherche à l’IRD (UR 199)
![]() Franck-Dominique Vivien : économiste, maître de conférence à l’université de Reims Champagne-Ardennes, membre du laboratoire "organisations marchandes et institutions".
Franck-Dominique Vivien : économiste, maître de conférence à l’université de Reims Champagne-Ardennes, membre du laboratoire "organisations marchandes et institutions".
Les économistes constituent une des communautés de chercheurs et d’experts qui a produit le plus de réflexions en matière de développement soutenable. Rien de surprenant à cela, d’abord parce qu’une des caractéristiques de la science économique réside dans ses prétentions normatives fortes. Elle entend donc répondre à cette énigme, à ce « principe normatif sans norme » [1] qu’est le développement soutenable. Ensuite, parce que les débats autour du développement et de la croissance ont, dès son origine, structuré l’histoire de la pensée économique. Même si l’expression « développement soutenable » est apparue dans les années 1980, on peut dire que ce n’est pas une idée tout à fait neuve. Elle est le dernier avatar d’une interrogation fort ancienne qui porte sur le sens de l’évolution économique et les contradictions qu’y rencontre la dynamique capitaliste. C’est cette histoire que nous nous proposons de retracer, afin d’éclairer la complexité et la multiplicité des interprétations du développement soutenable avancées aujourd’hui. Les différents courants de pensée économique qui s’opposent dans la définition du développement soutenable trouvent en effet leurs racines dans ces controverses toujours actuelles [2].
Dans une première partie sera abordée la question des limites de la croissance, qui est une des préoccupations fondatrices de l’économie politique. L’avènement d’un état stationnaire, qui marquerait la fin de la croissance, a été envisagé de longue date et diversement perçu par les économistes. Différentes interprétations se sont ainsi succédé quant à la nature des crises du capitalisme et leur caractère inéluctable ou transitoire. Dans une deuxième partie, on montrera comment cette question des limites de la croissance a été éclipsée, à la faveur du climat économique favorable de ce que, après Jean Fourastié, on a pris l’habitude d’appeler les « Trente Glorieuses ». La poursuite d’une croissance économique soutenue est alors considérée comme possible, sinon probable. Dans une troisième partie, nous verrons comment les problèmes d’environnement ont progressivement amené à changer de perspective à partir du début des années 1970, une évolution qui s’est soldée par l’apparition de la notion de développement soutenable. Enfin, dans une dernière partie, on montrera que l’on rencontre aujourd’hui, dans le domaine économique, des interprétations théoriques et politiques très diverses pour donner sens au développement soutenable. Elles empruntent aux différentes traditions et courants qui se sont succédé au fil du temps, de sorte que coexistent des approches sans cesse renouvelées, conservatrices et radicales, voire utopiques, en passant par des perspectives plus réformistes.
Une interrogation ancienne sur l’évolution du capitalisme
La réflexion sur l’évolution à long terme du capitalisme est aussi vieille que l’économie politique. Elle est même constitutive de celle-ci, le propos de l’économiste étant de définir les normes qui doivent permettre d’améliorer les conditions de vie de l’ensemble de la population. Certains auteurs ont très tôt souligné que la dynamique capitaliste n’était pas exempte de contradictions et pouvait entraîner une surexploitation des ressources – tant humaines que naturelles – et un ralentissement inéluctable de la croissance. Ils posaient ainsi les principales questions du développement soutenable.
L’accumulation du capital, condition du bien-être
Les économistes classiques ont élaboré une doctrine qui a dominé jusqu’au milieu du xixe siècle. Celle-ci veut que l’amélioration des conditions de vie passe avant tout par l’accumulation du capital. D’où une attention particulière au maintien d’un taux de profit suffisant pour inciter les capitalistes à investir encore et toujours. Tout en étant conscients des luttes qui opposent les différentes classes sociales pour la répartition des richesses, les classiques ont confiance dans la régulation marchande pour assurer l’harmonisation des intérêts et allouer au mieux les ressources rares. Cette doctrine libérale vaut pour les rapports économiques à l’intérieur des nations comme pour ceux qui s’établissent entre celles-ci. La thèse des avantages comparatifs de David Ricardo enseigne que les pays trouvent avantage au commerce international en se spécialisant dans la production et l’échange des biens dans lesquels ils sont les plus efficaces. Ainsi, l’enrichissement est fondé sur une division du travail qui s’instaure à l’intérieur des nations et entre celles-ci, et sur l’échange de produits dans le cadre de marchés concurrentiels. Il est clair, cependant, pour ces fondateurs de l’économie politique, que cette dynamique économique s’arrêtera un jour.
L’état stationnaire
À terme, la dynamique d’accumulation du capital doit buter sur les contraintes naturelles que constituent la démographie et la fertilité des sols mis en culture. Les classiques reprennent la thèse de Thomas Malthus qui veut que la population augmente fortement et nécessite de produire des quantités de plus en plus grandes de nourriture. Selon D. Ricardo, à mesure que la taille de la population croît, une rente différentielle, perçue par les propriétaires fonciers, grignote le profit des capitalistes jusqu’à le réduire à zéro. L’incitation à investir ayant disparu, l’accumulation du capital cessera, l’emploi et la population ouvrière correspondante se stabiliseront, de même que le nombre de bouches à nourrir et la quantité de terres à mettre en culture. Cette perspective d’état stationnaire est très présente chez John Stuart Mill qui, contrairement aux premiers classiques, ne redoute pas la fin de l’état progressif de l’humanité. Il se réjouit au contraire de cette issue, qui permettra que l’art de vivre et les raffinements de l’esprit connaissent enfin leur plein épanouissement (voir encadré).
L’état stationnaire selon John Stuart Mill
« Je ne saurais […] envisager l’état stationnaire du capital et des richesses avec l’aversion qui lui est si souvent manifestée par les économistes de la vieille école. Je suis enclin à croire qu’il constituerait, au total, une amélioration très sensible de notre condition actuelle. J’avoue qu’à mon sens, il y a autre chose à attendre de la vie que de faire des pieds et des mains pour réussir ; et que les membres de notre espèce ne sont peut-être pas destinés à se piétiner, s’écraser et se prendre à la gorge, comme les y oblige actuellement leur société […] Les États du nord et du centre des États-Unis offrent un spécimen de ce stade de notre civilisation ; et, bien qu’ils soient placés dans les circonstances les plus favorables, le seul avantage, semble-t-il, qu’ils aient réussi jusqu’ici à en tirer […] c’est que la vie entière de l’un des deux sexes s’y passe à chasser le dollar, et celle de l’autre à engendrer des chasseurs de dollars […] Je ne vois rien d’admirable dans le fait que des individus, déjà plus riches qu’il n’en est besoin pour quiconque, aient réussi à doubler leurs moyens de consommer des produits qui n’offrent guère de satisfactions que comme signes de richesse […] Seuls les pays arriérés de la Terre ont encore réellement besoin d’un accroissement de leur production ; ce qui manque à l’économie des plus avancés, c’est une meilleure distribution, et l’un des moyens indispensables pour parvenir à celle-ci est une plus stricte discipline en matière de population […] Tous les pays les plus peuplés de la Terre ont atteint la densité de population nécessaire pour assurer aux hommes, jusqu’à la limite du possible, les avantages tant de la coopération que des rapports sociaux […] Il n’est pas bon pour un homme d’être astreint en tout temps à la présence de ses congénères […] Et l’on ne saurait attendre grand-chose d’un monde qui n’aurait plus de place pour la spontanéité de la nature […] Si l’accroissement illimité des richesses et de la population devait oblitérer, sur la Terre, une large part des agréments qu’elle peut avoir par ailleurs, je formerais le voeu sincère, pour les générations futures, qu’elles se satisfassent d’un état stationnaire, bien avant d’y être contraintes par la nécessité […] Il est à peine nécessaire de faire observer qu’un état stationnaire pour le capital et la population n’implique aucune stagnation dans l’amélioration du genre humain. Rien ne serait perdu des possibilités offertes à la culture de l’esprit sous toutes ses formes, ou au progrès moral et social : l’Art de Vivre conserverait toutes ses chances de raffinement, et sans doute en aurait-il bien davantage, si nous cessions d’être obsédés par les moyens d’y parvenir […] ».
Source : John Stuart Mill, Principles of Political Economy, with Some of Their Applications to Social Philosophy ["Principes d’économie politique, 1848", trad. française in Edward Goldsmith et alii, Changer ou disparaître, Fayard, Paris, 1972, p. 64-65].
Le capitalisme : un système nécessairement en crise
Rompant avec cette vision, somme toute optimiste de l’évolution économique, Karl Marx et Friedrich Engels vont chercher à mettre en évidence les contradictions de l’accumulation capitaliste. Selon eux, la baisse du taux de profit a des raisons inhérentes à la logique capitaliste : ce sont les modalités d’extorsion de la plus-value et la concurrence que se livrent les capitalistes qui conduisent tendanciellement une population croissante à la misère. K. Marx exclut qu’une économie capitaliste puisse durablement s’installer dans un état stationnaire. Au contraire, écrit-il, « chaque progrès de l’agriculture capitaliste est un progrès non seulement dans l’art d’exploiter le travailleur, mais encore dans l’art de dépouiller le sol ; chaque progrès dans l’art d’accroître sa fertilité pour un temps, un progrès dans la ruine de ses sources durables de fertilité. Plus un pays, les États-Unis du nord de l’Amérique, par exemple, se développe sur la base de la grande industrie, plus ce procès de destruction s’accomplit rapidement » [3].
Il est évident pour Marx que la privatisation et la concentration croissantes des moyens de production, auxquelles conduit l’expansion capitaliste, entrent en contradiction avec l’idée d’une gestion à long terme des richesses de la planète : « Du point de vue d’une organisation économique supérieure de la société, le droit de propriété de certains individus sur des parties du globe paraîtra tout aussi absurde que le droit de propriété sur son prochain. Une société entière, une nation et même toutes les sociétés contemporaines réunies ne sont pas propriétaires de la terre. Elles n’en sont que les possesseurs, elles n’en ont que la jouissance et doivent la léguer aux générations futures après l’avoir améliorée en boni patres familias » [4]. D’où la nécessité, pour K. Marx, bien qu’il ait parfois des accents industrialistes saint-simoniens, de mettre sur pied des institutions collectives susceptibles de pouvoir « maîtriser notre maîtrise » de la nature.
Ces inquiétudes quant aux conditions de gestion des ressources naturelles se retrouvent aussi chez des auteurs qui ne cherchent pas à abattre le capitalisme. L’idée d’une « économie destructrice » se répand alors largement, à l’époque [5]. La « question forestière » va ainsi prendre un nouveau tour au xixe siècle et peut être considérée comme un des lieux où la problématique du développement soutenable a été inventée [6]. En France, à partir de la Révolution, les forêts ont symbolisé les limites naturelles que rencontraient les évolutions sociopolitiques voulues par l’instauration du Code civil et la promotion de la propriété privée. Après avoir abrogé la réglementation de Jean-Baptiste Colbert, les pouvoirs publics ont rapidement pris conscience que la privatisation des forêts allait se traduire par leur destruction accélérée. En effet, le temps de régénération de la ressource en bois risquait fort d’entrer en contradiction avec la gestion financière à court terme, qui est celle de l’accumulation capitaliste. Une autre politique est alors mise en place sous la Restauration, fondée sur une nouvelle administration, un corps d’ingénieurs publics, et de nouvelles règles agronomiques et juridiques. De nouvelles techniques de coupe visent au traitement des peuplements forestiers en futaies et non plus en taillis, ce qui allonge l’horizon temporel dans lequel s’inscrivent les hommes de l’art.
Ce débat est d’autant plus important que, selon la doctrine alors en vigueur, le couvert forestier a des incidences environnementales qui vont bien au-delà de la conservation des éléments végétaux. Depuis la seconde moitié du xviiie siècle, le lien est fait par un certain nombre d’administrateurs des colonies tropicales entre les phénomènes de déforestation, l’érosion des sols et le changement climatique [7]. Dans l’esprit des forestiers, la conservation du patrimoine constitué par les forêts permet la sauvegarde du territoire national, mais aussi celle des solidarités sociales, entre régions et générations. Ces perspectives vont conduire à définir des règles de gestion spécifiques pour ce « capital naturel », comme on le désigne dès cette époque, aussi bien en termes d’objectifs à atteindre que d’institutions les mieux à même de les faire respecter. D’une part, l’optimum technico-économique est défini par un prélèvement de la ressource en bois correspondant à la production de celle-ci depuis la dernière coupe. D’autre part, l’intervention de l’État, qui n’est pas contraint par la rentabilité immédiate, est requise. Bientôt, on va voir poindre les mêmes interrogations sur le bien-fondé du « laisser-faire » en ce qui concerne la « question du charbon » [8].
Croissance versus développement
La perspective d’une croissance infinie est une idée récente, qui se met en place après la Seconde Guerre mondiale, au cours de la période des Trente Glorieuses. Il est vrai qu’il s’agit d’une période de bouleversement économique et social unique à plus d’un titre dans l’histoire du capitalisme, par son rythme de croissance inégalé dans toute l’histoire économique des pays développés, un chômage faible et des évolutions sociales importantes : une dynamique démographique forte, la « fin des paysans », une urbanisation croissante, l’essor de l’État-providence, etc. Dans le même temps, on voit apparaître les premiers modèles de croissance économique et on commence à s’interroger sur le développement. Les dangers d’épuisement des ressources naturelles et les dégâts causés par la pollution sont oubliés, au moment où la production et la consommation de masse s’imposent comme modèle de société.
La question de la croissance
Le débat théorique relatif à la croissance qui va se dérouler pendant les Trente Glorieuses est structuré par une opposition entre économistes keynésiens et néoclassiques. L’idée que, par sa dynamique même, le système capitaliste est nécessairement voué à la crise est aussi celle de John Maynard Keynes, qui a connu la « grande crise » des années 1930 et a vu la montée du fascisme sur le terreau de ses répercussions économiques et sociales. Selon lui, cette crise trouve ses racines dans la rationalité capitaliste qui, du fait d’une incertitude radicale en ce qui concerne l’avenir, conduit les entrepreneurs à ne pas investir suffisamment dans le long terme. De ce fait, les économies sont confrontées à des situations de chômage chronique, qui ne proviennent pas d’entraves aux forces du marché. L’État doit alors intervenir pour soutenir l’investissement et l’emploi. En plus d’une politique de grands travaux, J. M. Keynes est favorable à l’idée d’une redistribution des richesses qui va dans le sens du maintien de la croissance économique. Si on augmente les revenus des classes populaires, qui ont une propension à consommer supérieure à celle des classes aisées, on crée des débouchés qui vont inciter les capitalistes à investir et à embaucher. Il importe donc, selon J. M. Keynes, de concilier équité sociale et efficacité économique.
Bien que ce dernier se concentre sur les problèmes de court terme, il ne néglige pas complètement la question du devenir à long terme des sociétés d’abondance. Ainsi, dans ses « Perspectives économiques pour nos petits-enfants » [9], quand la croissance de la productivité aura fait son oeuvre, J. M. Keynes envisage sérieusement l’hypothèse d’une diminution du temps de travail dans les sociétés industrielles et s’interroge sur le vide que cela ne manquera pas de laisser dans l’esprit des individus. D’autres valeurs de progrès devront alors être instituées.
C’est à partir de ces réflexions que les premiers modèles de croissance sont élaborés, dans les années 1940. Les économistes keynésiens qui les proposent – Roy Harrod et Evsey Domar, notamment – attirent eux aussi l’attention sur l’instabilité de la dynamique économique capitaliste, du fait des difficultés de coordination que rencontrent les décisions d’épargne et d’investissement. De même, ils insistent sur la nécessité d’une intervention de l’État pour pallier en partie ces problèmes de croissance sur le long terme.
Cependant, à partir du milieu des années 1950, une « réponse » optimiste à cette question va être proposée par les théoriciens néoclassiques. En fait, c’est la question même qui va changer puisque le modèle de croissance construit par Robert M. Solow postule que les problèmes de plein emploi des ressources, soulevés par les keynésiens et les marxistes, sont d’emblée résolus (sans que l’on sache d’ailleurs comment…) ; il s’agit alors de s’interroger sur les conditions du maintien d’une économie à l’équilibre. Ce modèle, selon les termes de R. M. Solow, doit être compris comme une « parabole », une « histoire simplifiée à l’extrême » [10] : l’économie y est représentée par une fonction de production macroéconomique qui ne produit qu’un seul bien à l’aide de deux facteurs de production, le capital et le travail. Ce dernier, qui dépend de la croissance démographique, est considéré comme exogène et augmente de façon constante. Il en va différemment pour le capital, qui nécessite un investissement pour être reconstitué. Il s’agit même du seul choix à effectuer dans le modèle, lequel est opéré par une sorte de planificateur qui doit décider, à chaque période, de la quantité de bien produit qui ne sera pas consommée mais investie pour produire du capital. La règle à suivre est de maintenir la croissance de la productivité marginale du capital au même rythme que les autres variables de l’économie que sont la population et l’offre de travail. Ainsi est supposée être démontrée la possibilité d’une croissance équilibrée sur le long terme, sans qu’il soit fait mention d’échanges sur un marché ni de prix…, ce qui n’empêche pas nombre de commentateurs de le faire. Si l’on n’y regarde pas de trop près, l’idéologie libérale semble sauve. On pourrait même dire qu’elle triomphe puisque, contrairement à la tradition analytique des classiques, l’existence de limites sociales et environnementales à l’accumulation du capital n’est plus reconnue, dans cette nouvelle représentation de la croissance économique.
La question du développement
Les années 1940 et 1950 voient aussi la constitution d’une économie du développement, dont l’objet est de démontrer l’incapacité des modèles néoclassiques à guider les politiques économiques dans les pays du tiers-monde.
En Amérique latine, la grande dépression des années 1930 puis le ralentissement du commerce international induit par la Seconde Guerre mondiale ont entraîné une dégradation considérable des termes de l’échange. Les économistes se trouvent confrontés à une situation qui contredit les enseignements de l’économie standard : laisser-faire et spécialisation agricole ont abouti au marasme économique. C’est dans ce contexte que se développe l’approche structuraliste, qui voit dans l’industrialisation par substitution d’importations la clé du développement. Le groupe d’économistes latino-américains de la Cepal (Comisión económica para América latina y el Caribe – Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes), réunis autour de Raúl Prebisch, alors à la tête de la Banque centrale d’Argentine, considère que les économies en développement ont des faiblesses structurelles héritées de leur passé colonial et entretenues par le commerce international. Elles devraient s’affranchir de leur dépendance vis-à-vis de la demande étrangère d’exportations primaires comme moteur de la croissance et favoriser l’expansion du secteur industriel national. Cela implique un rattrapage du retard technique et un rééquilibrage de l’activité économique au profit des secteurs les plus productifs. Là aussi, les préoccupations environnementales disparaissent devant la priorité donnée au productivisme et aux « industries industrialisantes ».
Dans le même temps, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les économistes occidentaux [11] sont préoccupés par l’urgence de promouvoir le développement économique dans les régions sous-développées pour favoriser le maintien de la stabilité internationale et contenir l’expansion du communisme. Le problème se pose avec une acuité nouvelle lors de l’accession à l’indépendance d’un grand nombre de pays et au début de la guerre froide. Le plan Marshall (1947-1953) renouvelle l’intérêt des théoriciens pour l’aide économique, dans laquelle ils voient un véritable levier de développement. En substance, c’est aussi l’idée exprimée par le Président des États-Unis, Harry Truman, lors d’un discours considéré comme fondateur en matière de développement [12], prononcé en janvier 1949, qui introduit la notion de « sousdéveloppement ». Dans cette vision, tous les pays sont appelés à connaître le même processus de développement économique, indépendamment de cultures, d’histoires et de contextes nationaux fort différents : certains sont en avance, d’autres en retard, mais tous sont sur la voie du développement. Le sous-développement est imputé à des facteurs endogènes, tels des institutions inadaptées et un taux d’épargne trop faible en raison de bas revenus.
Les différents courants de pensée au travers desquels l’économie du développement se construit [13] présentent un certain nombre de traits communs, en dépit de leurs divergences. Ils soulignent la spécificité des pays « sous-développés », qui connaissent de fortes inégalités, un manque d’homogénéité dans leurs facteurs de production et leurs produits, un secteur agricole exagérément développé, un sous-emploi endémique et diverses asymétries en matière d’échanges internationaux, autant de caractéristiques qui compromettent le recours à la théorie néoclassique pour fonder stratégies et recommandations politiques. À cette époque, les économistes viennent de démontrer, grâce à un modèle mathématique, l’existence d’un « équilibre général » – à savoir un vecteur-prix qui égalise les offres et les demandes de tous les produits – qui entend faire des mécanismes de marché le mode de régulation idéal de l’économie. Les hypothèses particulières de ce modèle ne permettent pas d’expliquer de façon adéquate le processus de développement dans des pays où le marché est peu développé et ne revêt pas les attributs de la concurrence parfaite. L’économie du développement renoue avec la tradition de l’économie classique puisqu’elle a pour objet la « pauvreté des nations » et les moyens d’y échapper. Pour autant, les économistes du développement remettent en question la théorie des avantages comparatifs chère à D. Ricardo et la spécialisation primaire qu’elle a induite dans nombre de pays. À la suite de la théorie keynésienne, l’intervention de l’État est perçue par la première génération des économistes du développement comme une nécessité pour « moderniser » ces économies, accélérer la croissance économique, accumuler du capital, développer les industries et permettre une mobilisation plus productive du facteur travail.
À partir du milieu des années 1960, avec les indépendances et le mirage du développement à crédit, ces approches sont contestées. Elles n’ont pas donné les résultats escomptés là où elles étaient appliquées, tandis qu’à l’inverse, certains pays ont connu une croissance fulgurante que les théories en présence ne permettent pas d’expliquer. Au côté de ces analyses, qui ne remettent pas en cause le capitalisme, on voit alors apparaître une nouvelle génération de théories plus radicales. Un paradigme néomarxiste se développe notamment à partir des années 1950 avec Paul A. Baran puis, surtout, à partir des années 1960, avec André Gunder Frank, Arghiri Emmanuel et Samir Amin [14]. Pour ces auteurs, le sous-développement est un processus d’extraction et de transfert du surplus des pays sous-développés dans les centres du capitalisme mondial. Le commerce entre les pays capitalistes avancés et les économies sousdéveloppées est ainsi caractérisé par un « échange inégal ». La nature des investissements étrangers enferme les pays du tiers-monde dans leur spécialisation primaire etrenforce les positions monopolistiques des capitalistes en place. La notion de dépendance est mise en avant : les changements intervenant à la périphérie, dans le tiersmonde, seraient toujours, en dernière analyse, déterminés par le centre. Ainsi, même les économies ayant connu un essor ne l’auraient pas fait de façon autonome, elles seraient dépendantes du capital étranger pour leur accès au marché, leurs financements et surtout leur technologie. Le sous-développement serait en outre perpétué en raison de l’incapacité des classes dominantes des pays sous-développés à utiliser le surplus pour l’accumulation productive nationale. Ces classes, détentrices du capital et du pouvoir politique, utiliseraient ce dernier pour maintenir leur domination et s’opposeraient à toute tentative de développement susceptible d’échapper à leur contrôle. Dans cette perspective, le développement, loin d’être assimilé à la croissance économique, est un processus de changement social et politique radical. Il s’agit, pour les pays du tiers-monde, de s’affranchir d’une domination qui les empêche de définir des objectifs autonomes. Cette approche s’attache davantage à dénoncer le contenu idéologique des modèles de croissance, leur adoption sans nuance des catégories du capitalisme comme données naturelles et universelles, qu’à souligner les limites techniques et matérielles de l’expansion du capital. C’est au début des années 1970 que se développera la réflexion critique sur ce dernier aspect.
L’envers des Trente Glorieuses
Dans les années 1970, les écarts constatés dans la répartition des richesses, les dégâts dans le domaine de l’environnement, l’enchérissement du pétrole amènent à s’interroger sur les modèles de développement et la poursuite de la croissance. C’est dans ce contexte que le terme « développement soutenable » va apparaître et se diffuser.
Halte à la croissance ?
Le premier rapport remis au Club de Rome, groupe de réflexion international composé d’industriels, de diplomates et de chercheurs, paraît en 1972. Son titre, The Limits to Growth, a été traduit de manière alarmiste en français par Halte à la croissance ?. Ce rapport a été commandé à une équipe de chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) dirigée par Dennis L. Meadows. Les auteurs de ce document adoptent un point de vue global et systémique. Les problèmes qui y sont considérés s’étendent à l’ensemble de la planète et agissent fortement les uns sur les autres. « Développement et environnement doivent absolument être traités comme un seul et même problème », y lit-on. D’où la nécessité de considérer une « problématique mondiale » qui est partiellement inspirée de la notion de biosphère et de l’écologie globale émergente. Cette étude s’appuie sur une des premières simulations par ordinateur d’un modèle de l’« écosystème mondial » caractérisé par cinq paramètres : la population, la production alimentaire, l’industrialisation, la pollution et l’utilisation des ressources naturelles non renouvelables. La dynamique de ce système mondial fait que les phénomènes se renforcent et aboutissent à un cercle vicieux, à savoir une population croissante d’individus qui consomment et polluent de plus en plus dans un monde fini. Dès lors, quel que soit le scénario testé, la croissance exponentielle que connaît le système mondial conduit, à terme, à son effondrement. « Nous avons la conviction que la prise de conscience des limites matérielles de l’environnement mondial et des conséquences tragiques d’une exploitation irraisonnée des ressources terrestres est indispensable à l’émergence de nouveaux modes de pensée qui conduiront à une révision fondamentale à la fois du comportement des hommes et, par suite, de la structure de la société actuelle dans son ensemble » [15].
Le rapport Meadows promeut l’idée de l’avènement d’un « état d’équilibre global », d’une « société stable ». Plus qu’une référence à Th. Malthus, sur laquelle insistent les critiques de ce rapport, c’est la thèse de l’état stationnaire, chère à J. Stuart Mill, qui, par l’entremise de l’économiste écologique Herman E. Daly [16], revient sur le devant de la scène. D’une façon similaire à ce qu’écrivait en son temps le classique anglais, les auteurs du rapport Meadows notent en effet : « La population et le capital sont les seules grandeurs qui doivent rester constantes dans un monde en équilibre. Toutes les activités humaines qui n’entraînent pas une consommation déraisonnable de matériaux irremplaçables, ou qui ne dégradent pas d’une manière irréversible l’environnement, pourraient se développer indéfiniment. En particulier, ces activités que beaucoup considèrent comme les plus souhaitables et les plus satisfaisantes : éducation, art, religion, recherche fondamentale, sports et relations humaines, pourraient devenir florissantes ». En d’autres termes, le développement, qui est clairement distingué de la croissance, reste possible. La grande différence par rapport à l’analyse de J. Stuart Mill réside dans le caractère désormais volontariste de la politique à mener. La stabilité du système global impose des niveaux de population et d’investissement constants, un décalage d’une quinzaine d’années entre les mouvements de stabilisation de ces deux grandeurs devant permettre d’améliorer le niveau de vie matériel à l’échelle du globe. Ainsi, au-delà du slogan de la « croissance zéro », qui a fait l’objet de vives polémiques, y compris au sein du Club de Rome, c’est plutôt l’idée d’une redistribution des richesses au niveau mondial qui est proposée. Pour ce faire, la croissance doit se poursuivre dans les pays du Sud, au moins pendant un certain temps, tandis qu’elle doit s’arrêter dans ceux du Nord.
Ce rapport, qui a provoqué une importante prise de conscience, a ouvert un débat qui ne s’est jamais refermé depuis. Il amorce aussi un basculement institutionnel : les questions de croissance et de développement se posent désormais à l’échelle mondiale, et les instances internationales vont tenter d’organiser les discussions et de proposer des modalités d’action par une série de grandes conférences.
La conférence de Stockholm
La première conférence de l’Organisation des Nations unies (Onu) sur l’homme et son milieu se tient à Stockholm en juin 1972. Cette réunion internationale, dont une des questions centrales est la confrontation entre « développement et environnement », voit essentiellement des oppositions entre le Nord et le Sud, mais aussi entre l’Est et l’Ouest avec l’absence de l’Union soviétique et d’un certain nombre de pays appartenant au bloc communiste, du fait de la non-reconnaissance officielle de l’Allemagne de l’Est au sein de l’Onu. La priorité donnée au développement est rappelée avec force par les représentants des pays du tiers-monde, qui ont présenté un front relativement uni. Des formules-chocs, telles que « Notre pollution, c’est la misère », marquent les esprits ; une affirmation que l’on retrouvera dans le point 4 du préambule de la déclaration de Stockholm, quand il est dit : « Dans les pays en voie de développement, la plupart des problèmes de l’environnement sont causés par le sous-développement […] En conséquence, les pays en voie de développement doivent orienter leurs efforts vers le développement, en tenant compte de leurs priorités et de la nécessité de préserver et améliorer l’environnement._ »
Depuis le début des années 1970, c’est bien ce qu’ont commencé à mettre en oeuvre les pays occidentaux à l’intérieur de leurs frontières, avec la mise en place de la première génération de politiques d’environnement, qui apparaissent comme des compromis passés entre développement économique et protection de l’environnement. À Stockholm, on commence à envisager l’idée d’intégrer ces politiques à des échelles supranationales ou via des conventions internationales. C’est pourquoi, au terme de la conférence, la décision est prise de créer au sein de l’Onu un organe spécifique en charge des questions d’environnement : le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) voit ainsi le jour et est installé à Nairobi, au Kenya. Pendant ce temps, on assiste à une mobilisation très importante des organisations non gouvernementales qui, au fil du temps, ne se démentira plus [17].
Un autre développement ?
Au cours des années 1970, au sein du champ de l’économie du développement, une distinction est aussi affirmée entre croissance et développement, et un intérêt renouvelé est accordé à la question de la redistribution des richesses. Cette réorientation ne représente pas une avancée majeure d’un point de vue théorique, mais elle a une importance pratique considérable pour les pays en développement dans la mesure où elle détermine l’affectation de l’aide internationale. Face au constat d’une paupérisation accrue, d’une croissance qui, là où elle est intervenue, n’a pas bénéficié à tous, praticiens du développement et institutions internationales reconnaissent la nécessité de se pencher autrement sur le développement. On peut mentionner en particulier la déclaration de Cocoyoc, adoptée à un symposium organisé par le PNUE et la Cnuced (Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement) en 1974, au Mexique, ainsi que la publication de la Dag Hammarskjöld Foundation intitulée What now ? en 1975, préparée à l’occasion de la septième session spéciale de l’Assemblée générale des Nations unies. Ces prises de position prêchent pour un abandon des modèles prétendument universels de développement en faveur de programmes et de mesures ad hoc, dépendant des contextes sociaux, culturels, économiques, politiques ou encore environnementaux. De nouvelles normes y sont avancées : on parle d’écodéveloppement (voir encadré), de besoins essentiels, de participation qui, au fil du temps, donneront naissance aux notions de développement soutenable et de développement humain. Ces approches s’intéressent aux finalités et au sens du développement. Celui- ci doit être orienté vers les besoins des personnes, il doit être endogène, autonome au sens où il doit s’appuyer essentiellement sur des ressources nationales, être acceptable d’un point de vue écologique et fondé sur une transformation structurelle [18]. La couverture des besoins essentiels est finalement réduite, en majeure partie, à un objectif de lutte contre la pauvreté – largement définie en termes monétaires – lors du Sommet de Cancun sur le développement en 1981, orientation consacrée par la pratique de la Banque mondiale. La perspective adoptée est alors résolument économique. L’éradication de la grande pauvreté, avec la création d’emplois et la garantie de revenus, est supposée assurer une croissance soutenue grâce à l’augmentation de la demande nationale et des incitations à investir correspondantes.
L’écodéveloppement
C’est dans les couloirs de la conférence de Stockholm, en 1972, que Maurice Strong, qui en est le secrétaire général, lance le terme d’« écodéveloppement » afin de tenter de concilier les points de vue qui s’y opposent entre le Nord et le Sud. Il s’agit en particulier que les pays du Sud, tout à leur objectif de développement, se préoccupent aussi de questions environnementales. Ignacy Sachs est l’économiste qui a attaché son nom à cette doctrine, conçue au départ pour répondre à la dynamique particulière des économies rurales du tiersmonde, avant de s’élargir et de devenir une approche générale du développement. S’inscrivant dans la perspective ouverte par les théories du développement endogène, il importe que chaque communauté définisse par elle-même son propre « style de développement », en particulier au travers d’un choix de « techniques appropriées », compatibles avec son contexte culturel, institutionnel et écologique. La croissance en tant que telle n’est pas rejetée, mais elle doit être mise au service du progrès social et de la gestion raisonnable des ressources et des milieux naturels. Les trois principales dimensions de l’écodéveloppement sont l’autonomie des décisions, la prise en charge équitable des besoins et la prudence écologique. La nécessité du développement est réaffirmée, mais cet objectif doit se décliner en une pluralité de trajectoires et une diversité de modèles d’économie mixte. Il s’agit, déclare I. Sachs, « de renouer avec le débat des années 1950-1960 et de revenir, au moins en partie, à la base du capitalisme réformé que nous avons connu au cours des Trente Glorieuses. Né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ce capitalisme réformé était fondé sur trois idées : le plein emploi comme objectif central, l’État protecteur et la planification […] Je pense que ces trois idées ont encore beaucoup à donner […] non pas en revenant en arrière, mais en renouant avec elles, et en les corrigeant à la lumière des expériences vécues et des immenses transformations qu’a connues le monde pendant cette époque » (*).
(*) Voir Ignacy Sachs, La troisième rive. À la recherche de l’écodéveloppement, Bourin, Paris, 2008 ; « Le développement : une idée-force pour le xxie siècle », in Christian Comeliau (dir.), « Brouillons sur l’avenir. Contributions au débat sur les alternatives », Nouveaux Cahiers de l’Institut universitaire d’études sur le développement.
La plupart des autres notions mises en avant par les tenants d’un « autre développement » connaissent des sorts similaires. Après avoir retenu l’attention, elles sont tombées dans l’oubli, n’étant plus acceptables politiquement dans le contexte de libéralisation économique des années 1980, ou au mieux sous une forme édulcorée et « économicisée » dans les programmes et la rhétorique des bailleurs de fonds et des institutions internationales. L’intérêt de promouvoir l’autosuffisance, par opposition à la dépendance dénoncée par certains théoriciens, avait ainsi été souligné lors de la réunion des pays non alignés en 1970, à Lusaka, et repris dans leur conférence de 1972, à Georgetown. Il ne s’agissait pas de promouvoir l’autarcie, mais davantage d’autonomie et un usage privilégié des ressources nationales de toute nature. Le commerce international et la coopération devaient être refondés sur des bases plus égalitaires, programme qui n’a pas résisté à la vague libérale. Seules les revendications de sécurité alimentaire restent encore largement évoquées. Quant aux tentatives d’intégrer dans les stratégies de développement les perspectives des exclus – femmes, minorités ethniques… –, loin d’entraîner un bouleversement dans la façon de penser le développement, elles se soldent par un appel à considérer leurs intérêts de façon marginale, dans des projets conçus indépendamment d’eux.
La crise traversée par le capitalisme au cours des années 1980 – avec une remise en cause de l’État-providence dans les pays industrialisés, l’échec des expériences de socialisme réel et la crise de la dette dans de nombreux pays en développement – consacre ces évolutions. L’augmentation du prix du pétrole vient renforcer l’idée d’interdépendance des pays et tend à suggérer que la dépendance est un phénomène universel, ne concernant pas les seuls pays du tiers-monde. L’idée d’une spécificité des pays en développement qui justifierait qu’une discipline particulière leur soit dédiée est peu à peu abandonnée. Les études sur le développement se trouvent marginalisées et « éclatées » en des approches partielles et spécialisées (économie du travail, finance internationale, économie publique…) qui ne prétendent pas fournir de théorie explicative d’ensemble. D’un discours de long terme sur le développement et la dynamique du capitalisme, il faut passer à des considérations plus immédiates. L’impératif d’équilibre évacue les préoccupations sur la dimension temporelle du changement. Les pays endettés sont mis en demeure d’appliquer les politiques d’austérité demandées par le FMI. L’économie néoclassique réinvestit alors le champ du développement, au moment où s’établit le « consensus de Washington ». L’accent est mis sur l’importance de prix transparents, d’une stabilisation de la monnaie et d’une intervention réduite de l’État, politiques mises en oeuvre dans le cadre des plans d’ajustement structurel. La spécificité des pays en développement est niée, de même que le caractère particulier du développement par rapport à la croissance. À une pensée de la diversité des structures et trajectoires économiques, fondatrice de l’économie du développement, se substitue l’impératif de tenir compte de l’unicité et de la finitude de la biosphère. Les considérations politiques, institutionnelles et sociales au coeur des études sur le développement sont largement éclipsées aussi au profit du discours économique, tant dans la formulation que dans les politiques de développement soutenable.
L’entrée en scène du développement soutenable
Plusieurs événements marquent la décennie 1980. La chute du mur de Berlin amène un bouleversement des équilibres géopolitiques. Si on note une relative détente du côté du nucléaire militaire, c’est du côté du nucléaire civil que la catastrophe arrive, avec l’accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl, en avril 1986. Il faut aussi citer la reconnaissance des problèmes globaux d’environnement. La signature, en 1987, au terme d’une dizaine d’années de négociation, du protocole de Montréal sur les substances incriminées dans la diminution de la couche d’ozone apparaît à beaucoup d’observateurs comme un premier pas vers des négociations concernant le changement climatique. Par là même, si les années 1970 ont été marquées par la peur de l’épuisement des ressources naturelles, depuis le milieu des années 1980, les doutes grandissent en ce qui concerne les limites des capacités d’épuration de la biosphère. Dans le même temps, les inégalités de richesse sont de plus en plus importantes. Les pays du tiers-monde s’enfoncent dans la crise – la chute du cours des matières premières et des produits de base, le renchérissement du pétrole, la modification de la politique financière de certains pays riches creusent la dette des pays du Sud. C’est dans ce contexte que l’expression « développement soutenable », apparue initialement dans un rapport de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) [19], va être reprise par d’autres instances internationales et se diffuser dans des cercles de discussion de plus en plus larges.
Le rapport Brundtland
En 1983, l’Assemblée générale des Nations unies décide la création de la Commission mondiale pour l’environnement et le développement (Cmed), composée d’une vingtaine de membres du personnel politique des différents pays membres et placée sous la présidence de Mme Gro Harlem Brundtland. Le mandat de cette commission est triple : établir un diagnostic en matière de problèmes d’environnement et de développement et faire des propositions pour une action novatrice, concrète et réaliste ; envisager de nouvelles modalités de coopération internationale susceptibles de renforcer celle-ci et de provoquer les changements souhaités ; viser à la prise de conscience et à la mobilisation de l’ensemble des acteurs concernés. Après cinq ans de travail, la Cmed publie en 1987 Notre avenir à tous, un rapport constitué de trois parties intitulées respectivement : « Préoccupations communes », « Problèmes communs », « Efforts communs ». Le contenu de cet ouvrage est une synthèse des idées de l’époque. « Nous n’avons qu’une seule et unique biosphère pour nous faire vivre », notent les rapporteurs de la Cmed [20], et elle apparaît aujourd’hui bien fragile. Les questions d’environnement et de développement sont considérées de concert : certains modes de développement dégradent l’environnement, et, inversement, un environnement dégradé peut constituer un obstacle au développement. Il n’y a donc – et l’on pense au premier rapport au Club de Rome – qu’une seule crise : les différents domaines considérés (population, sécurité alimentaire, érosion de la biodiversité, énergie, pollution, etc.) sont liés les uns aux autres, ce qui amène à trouver une solution, laquelle n’est autre que le développement soutenable. La définition qui en est donnée au chapitre 2 est probablement celle que l’on rencontre le plus souvent dans la littérature : le développement soutenable, écrit la Cmed, est « un type de développement qui permet de satisfaire les besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs ». L’accent est d’abord mis sur la durée du développement. Une deuxième dimension à prendre en compte concerne l’équité sociale, entre les générations et à l’intérieur de celles-ci. Une troisième dimension est le respect des systèmes naturels qui nous font vivre. On les désigne généralement comme les « trois piliers » du développement soutenable.
C’est une « nouvelle ère de croissance » que la Cmed appelle de ses voeux pour répondre aux besoins humains, avançant même des objectifs chiffrés annuels de 5 % à 6 % pour les pays en développement et 3 % à 4 % pour les pays industrialisés. Il importe par ailleurs que la « qualité » de cette croissance change, d’une part, dans le respect de « la non-exploitation d’autrui » et, d’autre part, grâce à des techniques moins consommatrices d’énergie et de matière. Le progrès technique doit permettre de « produire plus avec moins », et les pouvoirs publics et l’industrie doivent intégrer l’environnement dans leurs décisions économiques. Cette croissance doit aussi être au service d’une conception « élargie » du développement, incluant les besoins essentiels en ce qui concerne l’alimentation, l’énergie, l’emploi, etc., un objectif qui doit être décliné différemment selon les pays concernés, puisque ceux-ci connaissent des systèmes économiques et sociaux ainsi que des conditions écologiques variables. Si certaines populations doivent adapter leur mode de vie pour qu’il soit plus respectueux de l’environnement, d’autres doivent s’efforcer de limiter leur croissance démographique. Le chapitre consacré aux espèces et aux écosystèmes fait écho aux propositions de l’UICN en recommandant notamment la mise au point de « stratégies nationales de conservation » susceptibles de rapprocher les objectifs de conservation et de développement, tout en gardant à l’esprit que la protection de la nature comporte aussi une obligation morale à l’égard des êtres vivants et des générations futures. La nécessité, d’une part, de recourir au multilatéralisme pour résoudre les problèmes internationaux et, d’autre part, d’instaurer un nouvel ordre économique international – un objectif onusien du milieu des années 1970 qui figure aussi dans le troisième rapport au Club de Rome [21] – est toujours à l’ordre du jour. La gestion du « patrimoine commun » (océans, espace, Antarctique) est aussi une question évoquée en fin de volume. De même figurent des recommandations portant sur les réformes institutionnelles et juridiques à mettre en oeuvre, notamment à l’échelle internationale, le PNUE se voyant notamment proposer un rôle renforcé au sein du système des Nations unies.
Le Sommet de la Terre de Rio
Suggérée par les rédacteurs du rapport Brundtland, la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement (Cnued), appelée « Sommet de la Terre », se tient à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992, soit vingt ans presque jour pour jour après la conférence de Stockholm. Par son ampleur (40 000 personnes, 108 chefs d’État et de gouvernement, 172 États représentés), elle est en son temps la réunion la plus importante organisée par l’Onu. Elle constitue le véritable lancement médiatique de la notion de développement soutenable. Parallèlement à la conférence interétatique officielle, il faut noter la tenue du Global Forum, une conférence animée principalement par des organisations non gouvernementales, mais aussi – c’est plus nouveau – par le monde des affaires [22].
Au terme de cette conférence, plusieurs textes ont été adoptés. La déclaration de Rio reprend celle de Stockholm en guise de préambule et entend lui donner de nouveaux prolongements. La problématique démographique y apparaît moins préoccupante, et les références à la nature et à l’épuisement des ressources renouvelables ont presque disparu, de même que l’idée de recourir à la planification. Un plan d’action, baptisé Agenda 21 ou Action 21, volumineux pense-bête de 40 chapitres et 800 pages sans valeur juridique contraignante, liste plus d’une centaine d’actions à entreprendre pour que le développement soutenable devienne une réalité au xxie siècle. Une estimation des besoins financiers pour la réalisation de ce programme est faite, l’évaluation est de l’ordre de 600 milliards de dollars à l’horizon 2000, ce qui correspond aux dépenses d’armement mondial. Un certain nombre d’engagements ont été pris à Rio : deux conventions-cadres ont été signées, la première relative au changement climatique, la seconde à l’érosion de la diversité biologique. La convention sur la désertification sera adoptée deux ans plus tard. On peut aussi mentionner une déclaration de principe sur la protection des forêts, non juridiquement contraignante, le projet de rédaction d’une convention sur la forêt tropicale ayant rencontré l’opposition de certains pays. On note aussi la création d’une commission onusienne du développement soutenable. Des instances similaires vont bientôt être mises sur pied au niveau national par un certain nombre d’États [23].
Le Sommet mondial sur le développement soutenable de Johannesburg
Le Sommet mondial sur le développement soutenable a été organisé à Johannesburg, en Afrique du Sud, du 26 août au 4 septembre 2002. Initialement, l’ordre du jour de cette réunion portait sur la concrétisation des engagements pris dix ans plus tôt, lors de la conférence de Rio. Il s’agissait par ailleurs d’insister davantage sur le « pilier social » de la soutenabilité et de mettre l’accent sur la pauvreté et son cortège de précarités. Las ! Les crises financières et les problèmes de sécurité ont entre-temps accaparé l’attention. Les observateurs s’accordent pour reconnaître la faiblesse des résultats et l’absence de nouveaux engagements chiffrés de la part des gouvernements en matière de protection de l’environnement. La déclaration finale du sommet n’a fait que reprendre les déclarations internationales précédentes. De même, le plan d’action, qui a beaucoup occupé les négociations, ne comprend que des engagements chiffrés assez flous, lesquels, pour la plupart, avaient été déjà annoncés lors de précédentes rencontres internationales (déclaration de Doha, déclaration du Millénaire…). Encore une fois, on a pu mesurer l’écart entre les promesses d’aide aux pays du Sud et la réalité des montants financiers alloués – les décisions prises à Monterrey en mars 2002, dans le cadre de la Conférence des Nations unies sur le financement du développement, n’ayant fait que réaffirmer un objectif assigné de longue date.
Le sommet de Johannesburg a surtout été l’occasion de la présentation des « initiatives de type II », entendons les partenariats conclus entre des gouvernements et des acteurs privés – entreprises (plus de 800 étaient présentes), organisations non gouvernementales, syndicats, etc. – pour appuyer la mise en oeuvre de l’Agenda 21. Plus de 200 partenariats ont ainsi été annoncés durant le sommet de Johannesburg, processus qui se poursuit encore aujourd’hui. Si certains saluent la reconnaissance d’acteurs à part entière du développement soutenable, d’autres s’inquiètent des glissements opérés à cette occasion : il s’agit de mesures disparates, qui reposent sur des engagements volontaires, le plus souvent sans procédures d’évaluation et qui, pour beaucoup d’entre elles, peuvent s’assimiler à des actions promotionnelles
Le Green New Deal : un nouvel avatar du développement soutenable ?
Depuis Johannesburg, il n’y a pas eu de nouveau sommet de l’Onu consacré exclusivement au développement soutenable. Les négociations internationales se déroulent désormais dans le cadre des Conférences des parties aux conventions sur le changement climatique et la diversité biologique [24]. La problématique du développement soutenable a ainsi eu tendance à se diffracter à travers des enjeux plus spécifiques et des politiques plus sectorielles.
Les choses vont-elles changer sous le coup de la crise exceptionnelle que connaît le capitalisme aujourd’hui ? Avec l’annonce des importants plans de relance élaborés par les différents gouvernements depuis l’automne 2008, il est beaucoup question de Green New Deal, une expression qui trouverait son origine sous la plume de l’éditorialiste du New York Times Thomas Friedman et qui a été reprise récemment par les institutions internationales, comme le PNUE [25] ou la Banque mondiale. Il faut y voir une référence au programme d’investissements massifs réalisés aux États-Unis par Franklin D. Roosevelt pour lutter contre la crise de 1929 et, plus largement, aux politiques keynésiennes mises en place dans la plupart des pays de l’OCDE pendant les Trente Glorieuses. Reste à savoir quelle est l’ampleur véritable des efforts financiers consentis en matière de « relance verte ». Une étude de la banque HSBC publiée en février 2009 chiffre ceux-ci à 430 milliards de dollars au niveau mondial, ce qui correspondrait à environ 15 % des sommes annoncées. Une autre question porte sur le sens des politiques mises en oeuvre à cette occasion. Différentes versions du Green New Deal coexistent. L’accent est mis par les uns – néoclassiques et keynésiens de droite – sur la nécessité d’aider à l’émergence d’une « économie verte » grâce à des investissements en recherche et développement dans certaines technologies et procédés dématérialisés et/ou à basse teneur en carbone. Pour les autres – keynésiens de gauche, partisans de l’écodéveloppement –, il convient d’avoir une stratégie plus large qui prenne en compte les « trois piliers » du développement soutenable : l’intervention des pouvoirs publics ne doit pas se limiter aux secteurs économiques, mais doit aussi viser des objectifs de solidarité aux niveaux national et international de revalorisation des minimums sociaux, d’extension de nouveaux droits économiques et sociaux, etc.
L’analyse économique contemporaine et le développement soutenable
Ce débat s’enracine dans diverses approches du développement soutenable qui ont été conceptualisées au sein de la communauté des économistes depuis le début des années 1990. Si certains néoclassiques ont jugé que le rapport Brundtland adoptait une perspective trop environnementaliste, des économistes de l’écologie ont estimé qu’il faisait la part trop belle à la nécessité de la croissance. Cette divergence de jugement va se cristalliser dans l’opposition entre partisans d’une « soutenabilité faible » et tenants d’une « soutenabilité forte ». On peut ajouter un troisième point de vue, moins homogène que les deux précédents, d’économistes qui profitent du débat soulevé par la soutenabilité pour s’interroger sur le sens du terme « développement » et sur les liens existant entre celui-ci et la croissance économique.
Ce qui sépare avant tout ces diverses conceptions, c’est ce sur quoi doit porter l’enjeu de la soutenabilité. Dans la théorie économique dominante, c’est la dynamique économique – et, plus précisément encore, la croissance – qui doit se montrer durable. C’est elle qui est censée assurer la réduction des inégalités sociales et la protection de l’environnement. Dans le cadre de l’économie écologique, c’est plutôt l’environnement qui doit être l’objet de la soutenabilité : la contrainte qui s’imposerait désormais est celle d’un transfert d’une génération à l’autre d’un ensemble d’éléments du capital naturel jugés critiques. C’est la soutenabilité de la société qui est recherchée avant tout au sein de la mouvance de l’économie du développement.
La croissance durable
Pour la théorie économique dominante, les problèmes d’environnement et de pauvreté ne pourront se résoudre qu’avec plus de croissance. Même si la question du développement soutenable s’est construite en partie sur la critique de la croissance, les économistes néoclassiques entendent proposer des modèles de croissance durable censés répondre à cet enjeu. C’est le modèle de R. M. Solow, légèrement amendé, qui constitue aujourd’hui encore l’élément central de ces propositions. Selon les néoclassiques, l’objectif de soutenabilité doit se traduire par la transmission aux générations futures d’une capacité à produire du bien-être économique au moins égale à celle des générations présentes. En d’autres termes, la soutenabilité est définie comme la « non-décroissance » dans le temps du bien-être individuel, qui peut être mesuré par le niveau d’utilité, le revenu ou la consommation individuelle. Pour atteindre cet objectif, il importe que le stock de capital à disposition de la société reste intact à travers le temps. Les capacités de production d’une économie sont constituées par le stock d’équipements, les connaissances et les compétences, le niveau général d’éducation et de formation, ainsi que par le stock de ressources naturelles disponibles. L’hypothèse retenue par les théoriciens néoclassiques est celle de la substituabilité entre ces différentes formes de capital : une quantité accrue de « capital créé par les hommes » doit prendre le relais de quantités moindres de « capital naturel » (services environnementaux et ressources naturelles) pour assurer le maintien, à travers le temps, des capacités de production et du bien-être des individus. Il y a ainsi, selon R. M. Solow [26], un échange qui s’effectue dans le temps : la génération présente consomme du « capital naturel », mais elle lègue en contrepartie aux générations futures davantage de capacités de production sous forme d’équipements productifs, d’éducation, de recherche.
Plusieurs hypothèses sont nécessaires pour accréditer ce scénario. La première touche à l’innovation technique, qui doit fournir un ensemble de « techniques de secours » permettant la substitution entre les différentes formes de capital. La deuxième est relative à la définition d’un régime d’investissement particulier : la règle de Hartwick stipule que les rentes procurées par l’exploitation des ressources naturelles épuisables doivent être réinvesties dans du capital technique, via un système de taxation ou un fonds d’investissement spécifique. Troisièmement, bien que les prix soient absents du modèle de Solow – celui-ci figure une économie planifiée, un agent unique décidant seul de l’affectation des ressources –, les néoclassiques mettent en avant l’hypothèse selon laquelle l’allocation des ressources doit être réalisée par le marché. Les valeurs des différentes formes de capital doivent être déterminées par le système de prix, de même que les rapports d’échange qui vont s’établir entre celles-ci. D’où la nécessité de faire entrer à l’intérieur de la sphère marchande ce qui, au départ, lui est extérieur, en donnant un prix aux ressources naturelles et aux pollutions ; cette démarche est baptisée « internalisation des externalités ».
Dans cette version de la soutenabilité, qui est qualifiée de « faible », les contraintes qui pèsent sur la dynamique économique ne sont pas très fortes : on peut noter la réaffirmation du primat de la croissance (voir encadré ci-après), la confiance dans le progrès technique et le jeu des prix, l’intervention des pouvoirs publics – sur laquelle la nouvelle génération de modèles de croissance endogène insiste davantage – dans quelques domaines jugés stratégiques (informations en matière de réserves disponibles de ressources naturelles, aides à la recherche et à l’innovation, etc.), pour les prises de relais entre les différentes formes de capital.
Le développement soutenable : une sixième étape de la croissance économique ?
Un argument souvent invoqué par les néoclassiques veut que la poursuite de la croissance aille dans le sens de la protection de l’environnement. Gene M. Grossman et Alan B. Krueger (*) ont cherché à donner une confirmation empirique de cet argument en tentant d’établir une corrélation générale, pour un certain nombre de pays, entre le revenu par habitant et des indicateurs de pollution de l’air et de l’eau. Les résultats de leur étude économétrique laissent entendre que les émissions polluantes augmentent en fonction du revenu moyen jusqu’à une certaine limite puis décroissent, traçant ainsi une « courbe en U inversé », ce que l’on désigne parfois comme une « courbe de Kuznets environnementale », du nom de l’économiste qui, dans les années 1950, avait tenté – sans succès – d’établir une relation similaire entre la croissance et les inégalités sociales. En règle générale, ce point de retournement se trouve aux alentours de 8 000 dollars américains par habitant. L’explication fournie par les auteurs est que, dans les premières périodes de développement, il y a peu d’émissions polluantes du fait de la faiblesse de la production. Puis les débuts mal maîtrisés de l’industrialisation provoquent un surcroît d’effluents et de dommages à l’environnement. Enfin, les moyens financiers dégagés par l’augmentation de la richesse, le poids croissant des services dans l’économie et les changements de préférences des individus (plus portés vers la qualité de la vie à mesure que leur revenu individuel augmente) permettent de réduire les émissions de polluants. Ainsi, non seulement l’augmentation de revenu apportée par la croissance permettrait aux inégalités, à travers un « effet de percolation » (trickle-down effect), d’être moins criantes, mais elle contribuerait de plus à modifier les aspirations des individus, lesquels sont plus enclins à faire pression sur les gouvernements pour exiger la mise en oeuvre de politiques environnementales. On peut noter que la Banque mondiale et le PNUE ont repris cet argument dans leurs rapports publiés en 1992.
Dans la thèse de Gene M. Grossman et Alan B. Krueger, on retrouve en filigrane celle développée en son temps par Walt Whitman Rostow, qui veut que le développement économique intervienne à partir d’un certain stade de l’histoire des sociétés humaines (**). Elles connaissent alors une croissance auto-entretenue et durable (self-sustaining growth) qui devient la « fonction normale de l’économie ». La structure de celle-ci se modifie ensuite à mesure des progrès techniques et de leur diffusion dans de nouveaux secteurs d’activité, des industries nouvelles prenant le relais d’industries anciennes et fournissant aux capitaux de nouvelles possibilités d’investissement. Le caractère novateur de la démonstration de G. M. Grossman et A. B. Krueger réside dans le fait que, contrairement à W. W. Rostow, qui, « guerre froide » oblige, était un peu dubitatif visà- vis des perspectives d’avenir des sociétés avancées de son temps, ces deux auteurs leur dessinent une évolution plus respectueuse de l’environnement. En d’autres termes, le développement soutenable ne figurerait-il pas ce que l’on pourrait désigner, en paraphrasant W. W. Rostow, comme la « sixième étape » de la croissance ? Le problème, ainsi qu’en conviennent G. M. Grossman et A. B. Krueger, est que cette relation « en U inversé » ne peut être généralisée. Elle ne vaut que pour quelques polluants qui ont des impacts locaux et à court terme et non, par exemple, pour les rejets de CO2 ou la production de déchets ménagers, dont les quantités produites vont croissant avec le revenu par tête. Par ailleurs, quand elle est établie, cette relation ne peut être mécanique. C’est parce qu’il y a des politiques publiques qui sont menées que l’on
peut enregistrer des résultats encourageants dans le domaine de la lutte contre les pollutions. Enfin, il convient de ne pas oublier que les réductions de pollution observées par les indicateurs retenus dans les études économétriques ont pu être contrebalancées par des augmentations dans d’autres domaines, ou que les industries les plus polluantes ont pu être transférées sous d’autres latitudes.
(*) Gene M. Grossman et Alan B. Krueger, « Economic Growth and the Environment », The Quarterly
Journal of Economics, vol. 110, no 2, mai 1995, p. 353-377.
(**) « À considérer le degré de développement de l’économie, écrit W. W. Rostow, on peut dire de toutes
les sociétés qu’elles passent par l’une des cinq phases suivantes : la société traditionnelle, les conditions
préalables du démarrage, le démarrage, le progrès vers la maturité et l’ère de la consommation de masse »
(in Walt Whitman Rostow, Les étapes de la croissance économique, Le Seuil, Paris, 1962 – trad. française).
L’économie écologique et la recherche de limites à la dynamique économique
Un deuxième ensemble de travaux économiques relatifs au développement soutenable est caractérisé par la volonté de prendre en compte la spécificité des phénomènes environnementaux, jugés irréductibles à la logique marchande. Cette perspective de recherche, que l’on regroupe aujourd’hui sous le terme d’ecological economics [27], insiste aussi sur la distinction à opérer entre croissance et développement et s’interroge sur les possibilités d’instaurer des limites en ce qui concerne l’exploitation de certaines ressources naturelles. Cette idée s’enracine dans les modèles bioéconomiques élaborés dans le domaine de la foresterie à partir du xviiie siècle et de la gestion des pêches, qui ont connu leur essor depuis les années 1960. Comme nous l’avons vu précédemment, la ressource biologique y est considérée comme une sorte de « capital naturel » dont il importe d’optimiser la gestion dans le long terme, l’objectif à atteindre étant le « rendement durable maximum » (maximum sustainable yield), autrement dit la consommation maximale de ressources qui peut être indéfiniment réalisée à partir du stock de ressources existant. Cette perspective, que l’on qualifie parfois de « bioéconomique », ne s’inscrit pas particulièrement dans un cadre analytique hétérodoxe, mais les économistes écologistes s’y intéressent beaucoup parce qu’elle met l’accent de prime abord sur la nécessité de déterminer des limites quantitatives à l’exploitation des ressources naturelles.
Depuis vingt ans, cependant, cette réflexion sur la gestion des ressources naturelles a pris un tour nouveau avec la reconnaissance des problèmes globaux d’environnement. En l’état des connaissances, on est encore loin de pouvoir donner un contenu opérationnel à une « bioéconomie globale », si tant est que cela ait un sens. Tout au plus peut-on édicter des principes entendus, selon Herman E. Daly [28], comme des règles minimales de prudence : 1) les taux d’exploitation des ressources naturelles renouvelables doivent être égaux à leurs taux de régénération ; 2) les taux d’émission des déchets doivent être égaux aux capacités d’assimilation et de recyclage des milieux dans lesquels ces déchets sont rejetés ; 3) l’exploitation des ressources naturelles non renouvelables doit se faire à un rythme égal à celui de leur substitution par des ressources renouvelables. À l’opposé de la position défendue par les économistes néoclassiques, les tenants de l’ecological economics avancent l’idée d’une complémentarité entre le « capital naturel » et les autres facteurs de production. D’où un modèle qualifié de « soutenabilité forte », qui repose sur la nécessité de maintenir et de transmettre, à travers le temps, un stock de « capital naturel critique » dont les générations futures ne sauraient se passer.
Si ce principe normatif est simple, sa traduction concrète est loin de l’être. La première difficulté, classique en économie, est d’identifier et de mesurer les composantes hétérogènes du capital naturel. Ce concept recouvre l’ensemble des ressources naturelles et des services environnementaux. Or, ce sont autant d’éléments qui diffèrent les uns des autres par leurs caractéristiques écologiques, les jeux d’acteurs qui les concernent et, le cas échéant, les modalités de régulation déjà en place ou qui sont en train d’être négociées. La seconde difficulté est d’appliquer à chacune des composantes de ce « capital naturel critique » une « gestion normative sous contrainte », pour reprendre les termes de René Passet [29], à savoir déterminer d’abord des limites à l’exploitation des ressources naturelles, définir ensuite les conditions de répartition de cette contrainte au sein de la société qui soient les plus équitables possibles et préciser, enfin, les institutions qui permettront aux acteurs économiques de prendre des décisions optimales en fonction de ces différentes contraintes. Ce seraient ainsi trois niveaux de normes qui encadreraient l’activité économique. Or, comme l’illustrent les cas de l’érosion de la biodiversité et du changement climatique [30], il y a de fortes incertitudes et controverses scientifiques sur l’existence de seuils écologiques et sur les conséquences de leur éventuel franchissement. Ces problèmes d’environnement peuvent être qualifiés d’« univers controversés ». Si l’on dispose pour ceux-ci d’une connaissance scientifique suffisante relativement à l’importance des enjeux posés et à la nécessité d’y apporter des réponses, ils restent caractérisés par des interrogations majeures en ce qui concerne leurs causes et leurs conséquences, et les responsabilités qu’il convient d’invoquer à leur égard ; les dommages environnementaux n’y sont pas directement perçus par les agents ; un jeu d’acteurs où se mêlent controverse scientifique, intérêts industriels, enjeux politiques, effets médiatiques, etc. les construit socialement ; certains intérêts concernés (les générations futures, par exemple) sont absents des négociations ou bénéficient de porte-parole contradictoires ; un apprentissage collectif, où interagissent la production de connaissances et la prise de décision, doit être mis en oeuvre au sein d’institutions qui ont été créées pour ce faire. Autant de caractéristiques qui compliquent grandement l’élaboration d’une politique à même de répondre aux problèmes posés et rendent difficile l’examen de l’efficacité de cette politique.
Le développement soutenable : l’occasion de repenser ou de refuser le développement ?
Un troisième ensemble de travaux économiques met l’accent sur les questions sociales soulevées par le développement soutenable. Si certains auteurs veulent conserver l’objectif du développement en cherchant à le décliner autrement, d’autres appellent à le rejeter et à instituer d’autres perspectives de progrès social (V. infra, encadré « La décroissance »).
Les auteurs qui mettent l’accent sur la « dimension sociale du développement soutenable » entendent rendre compte de la multidimensionalité du développement, lequel ne doit pas être confondu avec la croissance économique, qui est mesurée au travers de la variation du PIB (V. infra, encadré « Indicateurs et développement soutenable »). Outre la possibilité d’aborder classiquement les questions d’équité (en les étendant désormais au domaine environnemental [31]), que cela soit à l’intérieur des générations ou entre celles-ci, cette perspective permet d’élargir la façon de considérer les besoins à satisfaire et la transmission d’une génération à l’autre des moyens de les satisfaire. Cette conception du développement est inspirée par les travaux d’Amartya K. Sen qui, pour appréhender correctement le bien-être des individus, propose de ne pas prendre en compte uniquement les biens ou le revenu dont ils disposent, mais aussi leurs « capacités » (capabilities) de faire et d’atteindre des « états d’être » donnés (se déplacer, se loger, être en bonne santé, être socialement reconnu et respecté…), des « capacités » qui sont fournies par les caractéristiques personnelles des individus, les biens qu’ils possèdent et leurs conditions socioculturelles d’existence. À partir de ce mode de raisonnement, certains économistes du développement [32] recommandent d’édicter des normes de soutenabilité (normes sociales minimales) relatives à l’accessibilité ou à l’équité quant aux « capacités » des individus. D’autres auteurs, plus soucieux des enjeux environnementaux, soulignent la faiblesse des réflexions d’A. K. Sen en matière de prise en compte de la nature et en appellent à un élargissement de la notion de « capacité » à des dimensions écologiques [33].
La décroissance
La décroissance a une double filiation (*) qui met l’accent tantôt sur les limites environnementales et tantôt sur les limites sociales que doivent rencontrer la croissance et le développement. Se référant principalement à l’oeuvre de Nicholas Georgescu-Roegen (*), la première perspective est celle d’une décroissance matérielle et énergétique, un objectif qui doit se différencier selon les espaces économiques considérés. La diminution de l’empreinte écologique est requise pour les pays du Nord, pour permettre éventuellement son augmentation dans les pays du Sud.
L’autre racine de la décroissance est la critique culturaliste du développement. Elle a pour principale référence l’oeuvre d’Ivan Illich (***). Au-delà de la critique qu’il adresse aux institutions modernes (l’école, la médecine…), accusées, à partir d’un certain seuil, de contrecarrer l’autonomie et la liberté des individus, I. Illich cherche à instituer ce qu’il nomme une société de « subsistance moderne ». Cette expression se réfère explicitement aux analyses développées par l’anthropologue Marshall D. Sahlins (****), lequel a cherché à modifier la perspective généralement adoptée en économie depuis Adam Smith quant à la rareté et à l’abondance. Alors qu’elles sont habituellement considérées comme le symbole même de la misère, M. D. Sahlins fait des sociétés primitives de cueilleurs-chasseurs qu’il a étudiées des sociétés d’abondance, au sens où ce sont la limitation des besoins et la frugalité qui y sont instituées, et non la rareté. Comme chez les peuples étudiés par M. D. Sahlins, on doit produire pour vivre et non vivre pour produire, dans les sociétés autonomes et économes que les tenants de la décroissance appellent de leurs voeux. Ce projet de « bonne vie », vieille idée philosophique s’il en est, passe par une limitation des besoins (une « simplicité volontaire », diront certains, qui s’oppose au consumérisme) qui doit permettre une réduction du temps de travail. On peut y ajouter – cela nous ramène à la convivialité d’I. Illich – un droit d’inventaire sur le progrès technique et l’accent mis sur le localisme.
(*) Serge Latouche, Le pari de la décroissance, Fayard, Paris, 2006, p. 15.
(**) Nicholas Georgescu-Roegen, La décroissance. Entropie, écologie, économie, trad. française, coll. « La
Pensée écologique », Sang de la Terre, Paris, nouv. éd., 1995.
(***) Ivan Illich, La convivialité, trad. française, Le Seuil, Paris, 1973.
(****) Marshall D. Sahlins, Âge de pierre, âge d’abondance. L’économie des sociétés primitives, trad. française, coll. « Bibliothèque des sciences humaines », Gallimard, Paris, 1976.
Une autre perspective en matière de redéfinition du développement est celle offerte par certains économistes post-keynésiens proches de l’écodéveloppement de I. Sachs [34]. Dans ce cadre, la croissance ne peut être confondue avec le développement, elle apparaît comme une condition nécessaire mais non suffisante. Nécessaire parce qu’elle est le signe qu’un surplus économique, un enrichissement, est dégagé ; non suffisante parce qu’il convient de la mettre au service d’autres objectifs que ceux qui ont été poursuivis jusqu’alors. Cela veut dire que la production doit viser avant tout la satisfaction des besoins essentiels. Cela passe aussi par une autre répartition des richesses créées, en les redistribuant prioritairement aux moins aisés. Une telle action volontariste sur les types d’investissement à réaliser et le partage de la valeur ajoutée ne peut se concevoir sans une intervention forte de l’État et des pouvoirs publics. Ceux-ci doivent agir par le biais d’une « planification participative » et des politiques économiques, sociales et environnementales élaborées à différentes échelles territoriales, auxquelles doivent être associés étroitement des représentants de la société civile. Un point essentiel aux yeux de I. Sachs, qui peut trouver des échos chez les chercheurs qui réfléchissent aux modalités d’instauration d’une « démocratie technique », est le contrôle social de la technique, en vue d’objectifs en termes de création d’emplois et de prudence en matière environnementale.
Conclusion
Lancée au début des années 1980, la notion de développement soutenable a connu un succès qui ne s’est pas démenti depuis. Elle trouve ses racines dans un débat économique qui dure depuis au moins deux siècles. Ainsi, à travers le temps, on peut suivre des continuités, enregistrer des ruptures dans le fil des questionnements relatifs à l’accumulation du capital, à la croissance et au développement, dont le développement soutenable constitue un des derniers avatars. Aujourd’hui, c’est essentiellement la soutenabilité, traduite en termes de prise en compte de l’environnement, qui est questionnée par les économistes ; la notion de développement fait, elle, l’objet de beaucoup moins d’attention. On peut même dire que celle de développement soutenable a participé à la marginalisation du champ de l’économie du développement, au profit d’un discours plus global qui concerne l’ensemble des pays et des économies, dont les destinées sont intrinsèquement liées au sein d’échanges et de processus de production globalisés, et qui se trouvent confrontés aux mêmes limites physiques de la biosphère. Du fait de cette perspective, un nombre croissant d’économistes s’est intéressé peu à peu au changement climatique, plus encore qu’au développement soutenable.
Un des principaux clivages est l’opposition entre soutenabilité faible et soutenabilité forte, laquelle dépend, pour une large part, des possibilités futures qu’offrira ou non le progrès technique. Toutefois, pour intéressante que soit cette distinction, elle a tendance à cantonner le débat à un niveau macroéconomique très abstrait où la société et l’économie sont représentées comme un tout, sans grande réalité institutionnelle. On peut faire la même remarque au sujet de nombre de discours relatifs à la « croissance verte » que l’on a vu fleurir depuis quelque temps, notamment en vue de caractériser le contenu de tel ou tel plan de relance conçu en 2008-2009 pour lutter contre la crise économique. Or, il est difficile d’appréhender la question de l’innovation technique d’un simple point de vue macroéconomique. En effet, les modalités de recherche et développement, les conditions d’émergence et de diffusion des innovations, les opportunités qu’elles offrent à certains acteurs économiques et les résistances qu’elles peuvent rencontrer vis-à-vis d’autres, l’acceptabilité sociale de telle ou telle technique, etc. vont différer grandement d’un secteur à un autre. Pour avancer dans la compréhension de ces éléments, il convient de mener des études mésoéconomiques, quitte ensuite à les considérer conjointement dans une perspective d’ensemble. Cela d’autant plus que le capitalisme ne présente pas le même visage d’un pays à un autre, il a des particularités institutionnelles – y compris quand on considère les systèmes nationaux d’innovation – qui proviennent de l’histoire et, en particulier, des différents types de compromis sociopolitiques qui y ont été passés.
Indicateurs et développement soutenable
Les interrogations sur la croissance et ses limites, sur ses impacts sociaux et environnementaux, sur le développement puis, au cours des dernières décennies, sur le développement soutenable se sont toujours accompagnées d’une réflexion sur la « métrique » adaptée pour rendre compte des phénomènes étudiés. Plus récemment, les exigences croissantes d’évaluation des politiques publiques et de comparaisons internationales, notamment dans le cadre des travaux des agences des Nations unies, ont conduit à un intérêt renouvelé pour les indicateurs.
Différentes fonctions sont traditionnellement assignées aux indicateurs : révéler des phénomènes ou des évolutions, communiquer auprès du grand public et guider la prise de décision. Il est communément admis qu’un indicateur doit être mesurable, c’est-à-dire saisir des dynamiques ou des situations qui se prêtent à la quantification. Il doit avoir des fondements scientifiques, être relativement transparent et rendre compte d’objets qui ont une pertinence politique.
Autant d’objectifs qui peuvent en pratique se révéler contradictoires. Les indicateurs ont, enfin, une dimension performative. Ce sont des outils d’aide à la décision qui tendent à transformer la réalité, politiques et stratégies se concentrant sur les grandeurs dont ils rendent compte, au détriment des aspects qu’ils laissent de côté.
Les indicateurs sont ainsi des constructions sociales et politiques dont l’élaboration requiert une série d’arbitrages qui ne sauraient être considérés comme uniquement techniques. Faut-il privilégier un indicateur agrégé unique qui résumera à lui seul le phénomène ou l’évolution que l’on entend appréhender, ou lui préférer une batterie d’indicateurs ? Vaut-il mieux avoir recours à une métrique unique ou à une multiplicité de mesures et d’unités ? Ce qui revient à se poser la question de la commensurabilité des éléments de nature différente, mais aussi à déterminer qui, du concepteur de l’indicateur ou de son utilisateur, opérera l’agrégation et la pondération éventuelle de ces éléments disparates dans la perspective d’une décision. Est-il par ailleurs préférable de proposer des « corrections » aux agrégats ou indices existants, avec lesquels public et politiques sont déjà familiarisés, ou de s’attacher à définir des indicateurs totalement nouveaux, utiliser les informations existantes ou recueillir de nouvelles données… ?
La soutenabilité économique : le PIB et ses limites
Si la question du choix des indicateurs est apparemment ouverte, l’essentiel des débats sur ce thème, qui dépassent les cercles académiques et les milieux de l’expertise internationale, tourne autour d’une réévaluation du PIB, qui reste la référence majeure en matière de croissance économique, de richesse et de bien-être depuis l’avènement de la comptabilité nationale. En France, le rapport de la commission Stiglitz (i) sur la mesure de la performance économique et du progrès social, présenté en septembre 2009, en a apporté une illustration récente.
Depuis le début des années 1970, les agrégats issus de la comptabilité nationale, au premier rang desquels le PIB, sont violemment critiqués (ii). Les attaques portent en premier lieu sur leur réductionnisme : seules les activités et ressources marchandes sont intégrées au calcul du PIB. Nombre d’activités qui contribuent au bien-être collectif et à la cohésion sociale ne sont pas prises en compte. La croissance économique ainsi mesurée est enfin considérée comme équivalente à une augmentation de bien-être, ce qui revient à assimiler un accroissement quantitatif à un gain qualitatif. Or la croissance peut s’accompagner d’une stagnation, voire d’un creusement des inégalités ou de la persistance d’une grande pauvreté. L’environnement y est pris en compte d’une façon qui n’incite nullement à sa conservation ni à faire preuve de retenue dans la consommation de ressources. En effet, les services non marchands rendus par les écosystèmes ne sont pas comptabilisés, de sorte que leur disparition ne fait pas diminuer le PIB. Les ressources naturelles utilisées dans des processus de production sont évaluées à leur prix de marché, lequel ne reflète pas nécessairement leur valeur. Enfin, les coûts liés à la restauration de l’environnement apparaissent comme une création de valeur, alors qu’ils constituent une tentative de compenser une perte de valeur.
À la faveur de la montée des préoccupations environnementales, diverses propositions de corrections du PIB ou d’élaboration de PIB « verts » ont été avancées à la fin des années 1980. Il s’agit de déduire une partie des dommages causés à l’environnement par l’activité économique et de mieux comptabiliser les dépenses de protection et de restauration des écosystèmes dégradés. La critique du PIB comme mesure de bien-être a également conduit à des propositions de corrections « sociales » dès le début des années 1970, comme la Measure of Economic Welfare de William D. Nordhaus et James Tobin en 1972, qui a été reprise et développée par plusieurs auteurs par la suite, notamment Herman E. Daly et John B. Cobb avec leur Index of Sustainable Economic Welfare (iii).
Vers une mesure du développement : l’indicateur de développement humain
Parallèlement, les économistes et praticiens du développement, notamment au sein d’institutions internationales, ont pointé le fait que la croissance mesurée par le PIB ne constituait pas une réponse suffisante ni appropriée aux problèmes de développement, notamment à la pauvreté, et qu’une autre politique et d’autres indicateurs étaient nécessaires.
Les économistes et statisticiens indiens ont joué un rôle pionnier à cet égard en cherchant, dès le début des années 1960, des indicateurs susceptibles de rendre compte des inégalités de répartition du revenu (iv). Les travaux sur les inégalités et la mesure de la pauvreté développés par Anthony B. Atkinson à partir du début des années 1970 (v), poursuivis et complétés par les travaux d’Amartya K. Sen sur la notion de « capacités », ont permis l’émergence de la notion de développement humain au début des années 1990. Il s’agit du développement qui permet à la population d’« accéder aux revenus et à l’emploi, à l’éducation et aux soins de santé et à un environnement propre ne présentant pas de danger […] et également [d’]avoir la possibilité de participer pleinement aux décisions de la communauté et de jouir des libertés humaines, économiques et politiques ».
L’indicateur de développement humain (IDH) a été proposé pour la première fois dans le rapport sur le développement humain du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) de 1990 (vi). Il s’agit d’un indice composite calculé à partir de l’espérance de vie, du taux d’alphabétisation et du PIB par tête. Cet indicateur s’est rapidement imposé, mais son calcul n’a pas évolué, alors que sa formulation initiale avait été présentée comme un point de départ susceptible de raffinement au fil du temps. La prise en compte de considérations environnementales est ainsi une des voies d’amélioration suggérées.
Quelle métrique pour le développement soutenable ?
Au-delà des projets et propositions divers d’indicateurs de bien-être et de développement, une des questions plus fondamentales qui divise aujourd’hui à propos de l’évaluation du développement soutenable est celle de la métrique. Les tenants de la « soutenabilité faible » tendent à considérer que l’expression monétaire de la valeur des différentes formes de capital – dont le capital naturel – s’impose, tandis que les adeptes de la soutenabilité forte soulignent son réductionnisme et son inadéquation pour rendre compte des dimensions proprement physiques du développement. Un certain nombre de travaux dans le champ de l’ecological economics cherchent à appréhender le développement dans ses limites énergétiques et matérielles et à pointer les consommations et dégradations diverses dont il s’alimente. Il s’agit d’étayer les appels à la dématérialisation et à l’adoption de modes de production et de consommation plus frugaux. On peut citer dans cette veine les travaux pour l’Institut de Wuppertal d’Ernst Ulrich von Weizsäcker et l’analyse éco-énergétique, inspirée par l’écologie de Howard Thomas Odum. Au-delà des slogans – Facteur 4, Facteur 10, qui expriment par combien il faudrait diviser la consommation de matières premières en vue d’un développement soutenable – parfois repris lors des grandes conférences, la notoriété de ces travaux reste limitée. Seule l’empreinte écologique proposée par l’organisation Redefining Progress, qui traduit en emprise spatiale les flux de matière et d’énergie consommés chaque année, a connu un certain succès médiatique au-delà des cercles de l’évaluation environnementale.
La dimension environnementale du développement soutenable et l’empreinte écologique
L’empreinte écologique d’une population peut être définie comme la « surface terrestre et aquatique biologiquement productive nécessaire à la production des ressources consommées et à l’assimilation des déchets produits par cette population, indépendamment de la localisation de cette surface » (vii). Si on la compare à la capacité de l’environnement à servir de support aux activités humaines, traduite elle aussi en termes spatiaux, cela donne une estimation de la soutenabilité de l’exploitation de l’environnement. Cet indicateur est mobilisé dans des comparaisons internationales. Il permet de pointer le fait que le développement de certains pays s’effectue au détriment d’autres, quand la « consommation d’espace » liée à leurs modes de production et de consommation excède la taille du territoire national. Cette situation, dite de dépassement écologique, est interprétée comme un symptôme de non-soutenabilité. Les hypothèses à la base du calcul de cet indicateur ont été largement contestées. Il repose sur des faisceaux de présomptions relatives à des domaines de l’écologie globale dominés par une incertitude radicale ou par des controverses scientifiques persistantes. Il est en outre finalement assez difficile à interpréter, la compréhension intuitive que l’on peut avoir de ses résultats n’étant pas forcément exacte et les modalités de son calcul étant souvent mal comprises et maîtrisées par ses commentateurs. Pourtant, un lancement médiatique habilement orchestré et, surtout, la reprise de l’indicateur par le WWF (World Wide Fund for Nature) dans son rapport Planète vivante, ainsi qu’une publicité importante faite des résultats de ce dernier au moment du sommet de Johannesburg en 2002, ont contribué à sa notoriété.
En tout état de cause, la conversion d’éléments variés en une seule unité, qu’il s’agisse de la monnaie, de la masse, d’une mesure quelconque de l’énergie ou encore d’hectares globaux comme dans l’empreinte écologique, revêt toujours un caractère réducteur. Les unités physiques ne permettent pas de rendre compte des préférences et valeurs de la société, les activités ne sont jaugées qu’à l’aune de leurs impacts physiques et matériels, et, à emprise ou empreinte égale, sont jugées équivalentes. Le moyen d’échapper à ce réductionnisme et de rendre compte de la multiplicité des facettes du développement soutenable est de proposer des ensembles ou tableaux de bord d’indicateurs, comme l’a fait notamment la Commission du développement durable des Nations unies en 1996, 2001 et 2006 et comme s’attache à le faire la Commission européenne (viii), solution qui, si elle est jugée moins élégante du fait de la multiplicité des critères à considérer, a le mérite du pragmatisme.
(i) Joseph E. Stiglitz, Amartya K. Sen et Jean-Paul Fitoussi, Rapport de la Commission sur la mesure des
performances économiques et du progrès social, présidence de la République, ministère de l’Économie, de
l’Industrie et de l’Emploi, septembre 2009.
(ii) Jean Gadrey et Florence Jany-Catrice, Les nouveaux indicateurs de richesse, coll. « Repères », La
Découverte, Paris, 2005 ; Dominique Méda, Au-delà du PIB. Pour une autre mesure de la richesse, coll. « Champs actuel », Flammarion, Paris, 2008.
(iii) Herman E. Daly et John B. Cobb, For the Common Good : Redirecting the Economy toward Community,
the Environment and a Sustainable Future, Beacon Press, Boston, 1989.
(iv) Meghnad Desai, « Human Development : Concepts and Measurement », European Economic Review,
vol. 35, nos 2-3, avril 1991, p. 350-357.
(v) Anthony B. Atkinson, « On the Measurement of Inequality », Journal of Economic Theory, vol. 2, no 3,
septembre 1970, p. 244-263.
(vi) Sudhir Anand et Amartya K. Sen, « Human Development Index : Methodology and Measurement »,
Human Development Report Office Occasional Papers, no 12, Programme des Nations unies pour le développement,
New York, juillet 1994.
(vii) Mathis Wackernagel et William E. Rees, Our Ecological Footprint : Reducing Human Impact on Earth,
New Society Publishers, Gabriola Island, Philadelphie, 1996 ; Aurélien Boutaud et Natacha Gondran,
L’empreinte écologique, coll. « Repères », La Découverte, Paris, 2009.
(viii) Voir, par exemple, Eurostat, Measuring Progress Towards a More Sustainable Europe, 2007.
Notes
[1] Jacques Theys, « À la recherche du développement durable : un détour par les indicateurs », in Marcel Jollivet (dir.), Le développement durable, de l’utopie au concept. De nouveaux chantiers pour la recherche, Elsevier, Paris, 2001, p. 273.
[2] Ce chapitre reprend, pour une large part, celui qui figure dans la première édition de cet ouvrage : Valérie Boisvert et Franck-Dominique Vivien, « Le développement durable : une histoire de controverses économiques », in Catherine Aubertin et Franck-Dominique Vivien (dir.), Le développement durable. Enjeux politiques, économiques et sociaux, coll. « Les Études », La Documentation française, Paris, 2006, p. 15-44.
[3] Karl Marx, Le capital, livre i [1867], trad. française, Gallimard, Paris, 1965, p. 998.
[4] Karl Marx, Le capital, livre ii [1894], trad. française, Éditions sociales, Paris, 1974, p. 159.
[5] Jussi Raumolin, « L’homme et la destruction des ressources naturelles : la Raubwirtschaft au tournant du siècle », Annales. Économies sociétés civilisations, 39e année, no 4, 1984,
[6] François Vatin, « Aménagement forestier et métaphysique économique du xviie au xixe siècle : le premier débat sur le “développement durable” », in Jean-Paul Maréchal et Béatrice Quenault (dir.), Le développement durable. Une perspective pour le xixe siècle, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2005, p. 51-67.
[7] Richard Grove, « The Origin of Environmentalism », Nature, vol. 345, no 6270, 3 mai 1990, p. 11-14.
[8] William Stanley Jevons, The Coal Question : an Inquiry Concerning the Progress of the Nation, and the Probable Exhaustion of our Coal-Mines, Macmillan, Londres, 1865.
[9] John Maynard Keynes, « Perspectives économiques pour nos petits-enfants » [1930], rééd. in La pauvreté dans l’abondance, trad. française, coll. « Tel », Gallimard, Paris, 2002, p. 103-109. Pour une relecture de la pensée keynésienne dans une perspective de développement soutenable, voir Éric Berr, « Le développement durable est-il keynésien ? », in Patrick Matagne (dir.), Le développement durable en questions, L’Harmattan, Paris, 2007, p. 113-140.
[10] Robert M. Solow, Théorie de la croissance économique, trad. française, Armand Colin, Paris, 1972, p. 10.
[11] Parmi les principaux auteurs, on peut citer Paul N. Rosenstein-Rodan, Arthur Lewis, Ragnar Nurkse, Walt W. Rostow, Gunnar Myrdal, Harvey Leibenstein, Hla Myint et Albert O. Hirschman.
[12] Gilbert Rist, Le développement. Histoire d’une croyance occidentale, coll. « Références mondes », Presses de Sciences po, Paris, 1996, p. 116 (3e éd., 2007).
[13] Diana Hunt, Economic Theories of Development : an Analysis of Competing Paradigms, Harvester Wheatsheaf, Hemel Hempstead, 1989.
[14] Arghiri Emmanuel, Unequal Exchange : A Study of the Imperialism of Trade, Monthly Review Press, New York, 1972 ; Samir Amin, L’échange inégal et la loi de la valeur : la fin d’un débat, Anthropos, Paris, 1973 (nouv. éd., 1988).
[15] Dennis L. Meadows et alii, Halte à la croissance ? Enquête sur le Club de Rome, Fayard, Paris, 1972, p. 279, 293-294 (trad. française).
[16] Herman E. Daly, « Toward a Stationary-State Economy », in John Harte et Robert H. Socolow (dir.), Patient Earth, Holt, Rinehart and Winston Inc., New York, 1971, p. 226-244.
[17] Voir chapitre 4.
[18] Marc Nerfin (dir.), Another Development : Approaches and Strategies, Dag Hammarskjöld Foundation, Uppsala, 1977, p. 10.
[19] UICN, Stratégie mondiale de la conservation. La conservation des espèces vivantes au service du développement durable, UICN/PNUE/WWF, Gland, 1980. Voir, à ce propos, le chapitre 4.
[20] Commission mondiale pour l’environnement et le développement (Cmed), Notre avenir à tous, Éditions du Fleuve, Montréal, 1987, p. 31-47 (trad. française).
[21] Jan Tinbergen (dir.), Nord-Sud : du défi au dialogue ? Propositions pour un nouvel ordre international, Club de Rome, Dunod, Paris, 1978.
[22] Voir chapitre 5.
[23] Voir chapitre 3.
[24] Voir chapitre 2.
[25] Edward B. Barbier, Rethinking the Economic Recovery : A Global Green New Deal, Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), Nairobi, avril 2009.
[26] Robert M. Solow, « An Almost Practical Step toward Sustainability », in Wallace E. Oates (dir.), The RFF Reader in Environmental and Resource Management, Resources for the Future, Washington DC, 1999, p. 265.
[27] Robert Costanza, Charles Perrings et Cutler J. Cleveland (dir.), The Development of Ecological Economics, Edward Elgar, Cheltenham, 1997.
[28] Herman E. Daly, « Toward Some Operational Principles of Sustainable Development », Ecological Economics, vol. 2, no 1, avril 1990, p. 1-6.
[29] René Passet, L’économique et le vivant, Economica, Paris, 2e éd., 1996.
[30] Voir chapitre 2.
[31] Pierre Cornut, Tom Bauler et Edwin Zaccaï (dir.), Environnement et inégalités sociales, coll. « Aménagement du territoire », Université de Bruxelles, Bruxelles, 2007.
[32] Jean-Luc Dubois et François-Régis Mahieu, « La dimension sociale du développement durable : réduction de la pauvreté ou durabilité sociale ? », in Jean-Yves Martin (dir.), Développement durable ? Doctrines, pratiques, évaluations, IRD Éditions, Paris, 2002, p. 73-94.
[33] Fabrice Flipo, « Pour une écologisation du concept de capabilité d’Amartya Sen », Natures Sciences sociétés, vol. 13, no 1, janvier-mars 2005, p. 68-75.
[34] Éric Berr, « Le développement soutenable dans une perspective post-keynésienne : retour aux sources de l’écodéveloppement », Économie appliquée, t. LXII, no 3, 2009, p. 221-244.