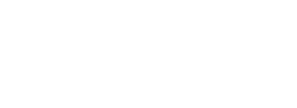Intranet
Accueil > Nos projets & actions en cours > Démocratie & veilles citoyennes > Archives > Le développement soutenable est-il (...) > Extraits de l’ouvrage "Un pouvoir sous influence" |
Extraits de l’ouvrage "Un pouvoir sous influence"Vendredi 11 novembre 2011 |
Roger Lenglet & Olivier Vilain,
"Un pouvoir sous influence.
Quand les think tanks confisquent la démocratie".
Armand Colin, octobre 2011
EAN13 : 9782200271800. 240 pages. 19,90 Euros
Le livre, sur le site de l’éditeur : >>>>>
Sommaire de l’ouvrage
Remerciements
Introduction
Chapitre 1 – La nouvelle fabrique de la pensée politique
Chapitre 2 – Think tanks : grenouillage et prolifération
Chapitre 3 – Fonction publique : l’hallali
Chapitre 4 – Des retraites à points
Chapitre 5 – Dette publique : la règle d’or comme horizon
Chapitre 6 – Une campagne présidentielle 2012 bien bordée
Chapitre 7 – Santé : les pilules des think tanks
Chapitre 8 – Principe de précaution sous haute pression
Chapitre 9 – L’éternel retour d’une France de propriétaires
Chapitre 10 – Préserver notre faculté d’indignation
Chapitre 11 – L’armée des think tanks américains
Chapitre 12 – Du Mont-Pèlerin à l’Adam Smith Institute
Conclusion
Notes
Index des auteurs et des personnalités
Index des think tanks, des entreprises et des associations
Tables des matières
Introduction
Adam Smith , 1776 [1]
 Ce livre est une enquête sur les nouvelles éminences grises
qui orientent les choix économiques, sociaux et sanitaires de
nos dirigeants politiques. Ignorer ces « hommes de l’ombre »,
leurs réseaux d’influence et leur manière de travailler, c’est
s’interdire de comprendre les décisions de nos responsables
politiques et les évolutions du débat public.
Ce livre est une enquête sur les nouvelles éminences grises
qui orientent les choix économiques, sociaux et sanitaires de
nos dirigeants politiques. Ignorer ces « hommes de l’ombre »,
leurs réseaux d’influence et leur manière de travailler, c’est
s’interdire de comprendre les décisions de nos responsables
politiques et les évolutions du débat public.
De Nicolas Sarkozy à Dominique Strauss-Kahn, en passant par Jean-François Copé, François Bayrou, Ségolène Royal, François Hollande et bien d’autres, nous allons découvrir l’envers du décor de la politique contemporaine et comment les financiers tirent les ficelles. Nous avons voulu faire tomber les masques, à droite comme à gauche, en révélant les stratagèmes des professionnels de l’influence, ceux qui infléchissent le programme politique du parti socialiste aussi bien que ceux de l’UMP , du Modem et des centristes, ceux qui fournissent les idées des leaders, organisent leurs prestations et pensent à leur place.
Qui sont-ils ? Comment travaillent-ils ? En quoi les groupes qu’ils forment, aujourd’hui souvent qualifiés de « think tanks », sont-ils différents des clubs intellectuels qu’a connus la France par le passé ? Quels sont ceux qui ont la faveur de nos dirigeants ? Qui les finance et pour qui travaillent-ils réellement ? Quelle est leur indépendance ? Quelle est leur démarche et quel avenir nous préparent-ils ?
Ce voyage dans les arcanes du monde politique permettra à chacun de se faire une idée tout autre de la manière dont se forgent les réponses aux questions devenues brûlantes du chômage, du droit du travail, des retraites, du système de santé, des privatisations, du logement, de la place de l’État… On y découvre également que ces maîtres des coulisses n’ont pas pour souci de préserver leur liberté d’esprit, leurs convictions ou leur faculté d’indignation. Ils réfléchissent avant tout en fonction des forces en présence, des attentes des partenaires qui les alimentent et de la place qu’ils veulent prendre ou conserver.
Il est temps de regarder froidement leur « pragmatisme » qui recompose le paysage intellectuel et politique français, et de prendre conscience de la servitude des décideurs, de l’instrumentalisation de leur pensée et de ses traductions dans l’économie et l’idéologie ambiante.
Chemin faisant, nous dressons un état des lieux de la pensée politique qui est en train de se transformer sous les pressions très organisées des lobbies et dans laquelle la notion d’intérêt général se perd dans la plus grande confusion.
« L’influence s’acquiert en faisant des chèques », lançait ironiquement François Bayrou en janvier 2011 pour brocarder la réunion du « Premier Cercle » des donateurs de l’UMP que Nicolas Sarkozy animait en personne. L’argent est en effet l’une des voies d’influence pour obtenir des complaisances. Mais il en existe d’autres, plus déterminantes, qui permettent à quelques cercles d’initiés d’orienter le pouvoir et de canaliser les décisions dans une valse à trois temps : mâcher le travail intellectuel des décideurs, concevoir leurs stratégies et forger les consensus.
Il n’est pas dans notre intention de rendre compte ici des innombrables jeux d’influence sur le pouvoir, ni de chacune des institutions ou personnes qui infléchissent les choix des décideurs. Nous nous sommes concentrés sur l’émergence insidieuse (et paradoxalement parfois tapageuse) de certaines structures qui ont pris une importance assez considérable pour qu’il soit devenu nécessaire de les examiner si l’on veut comprendre comment les politiques se déterminent de nos jours.
Parmi elles, les think tanks et les agences de lobbying occupent désormais une place dans l’ombre des partis et des leaders politiques qui mérite une grande attention bien qu’ils redoutent les éclairages qu’ils ne choisissent pas eux-mêmes. On compte entre 150 et 200 think tanks en France et 6 000 à 7 000 dans le monde [2]. À défaut de pouvoir les étudier tous, nous avons choisi une partie d’entre eux, ceux qui nous ont paru s’imposer par leur relation particulière avec les décideurs, d’autant qu’ils ont été créés dans l’objectif de développer une influence déterminante plutôt que de véritablement réfléchir ou produire des idées nouvelles, quelles que soient leurs déclarations d’intention ou leur rhétorique. Qu’il s’agisse de think tanks français tels que la Fondapol [3], l’Institut Montaigne , Terra Nova , l’Afep ou l’Institut de l’Entreprise , et de quelques internationaux comme Heritage Foundation ou la Société du Mont-Pèlerin , leur singularité ne tient pas à l’originalité des idées qu’ils professent mais à leurs points communs : tous financés par de puissants groupes privés (entreprises et/ou lobbies), ils concoctent et propagent une argumentation néolibérale à travers une production médiatique de plus en plus abondante souvent citée par les politiques, et entretiennent avec ces derniers des liens étroits. Argumentation qui se réduit pour l’essentiel à donner à la critique de l’État et de la protection sociale une présentation progressiste, moyennent une sémantique de gauche résiduelle dans le cas de Terra Nova. Nous aurons l’occasion de pointer comment certains think tanks de droite mettent en scène également leur prétendu « attachement » aux valeurs humaines et sociales.
D’autres groupes d’influence jouent un rôle capital dans le tissage des réseaux, voire dans les grandes orientations des gouvernements, comme le Bilderberg , dont certains membres envahissent le paysage politique mondial. En France, des structures a priori modestes, comme le Cercle La Rochefoucauld, qui ne produisent pas d’analyses, nous ont retenus tout de même car elles offrent une instructive illustration des nombreux groupes d’influence qui, sous des dehors purement mondains ou corporatifs, peuvent peser sur certaines décisions.
Les think tanks sont devenus des intervenants omniprésents du débat public. En France, ils s’exposent d’autant plus qu’ils sont partiellement financés par les contribuables, sans que ceux-ci le sachent : les think tanks libéraux sont principalement financés par des dons de riches particuliers, d’entreprises ou de fondations d’entreprises, mais ces généreux mécènes peuvent défiscaliser leurs dons à hauteur de 66 % si le think tank bénéficie du statut d’organisme d’utilité publique. Une défiscalisation rendue possible par l’article 200 du code général des impôts, qui a suivi l’un des premiers rapports de l’Institut Montaigne . Cette libéralité a profité d’un nouveau consensus entre partis politiques, alors que les précédentes lois sur le sujet avaient été l’occasion de débats intenses pour savoir si la générosité publique devait s’appliquer à des aides privées.
En France, le développement des think tanks s’est accéléré à partir du début des années 2000, au moment où le Medef s’est imposé dans le débat politique avec sa « Refondation sociale », conçue par Denis Kessler , François Ewald et Ernest-Antoine Seillière . La justification du poids des think tanks, dont les membres n’ont aucune légitimité électorale, a été directement tirée de la rhétorique de la Fondation Saint-Simon et de cette « Refondation sociale » selon laquelle il faut que la « société civile » pèse sur les orientations de la société. Mais de quelle société civile s’agit-il ? Claude Bébéar , le fondateur de l’assurance Axa , et Jérôme Monod , le cofondateur de Suez lyonnaise des Eaux, ont créé respectivement l’Institut Montaigne et la Fondapol dont la grille d’analyse se fonde sur le présupposé que les marchés financiers et les Français les plus fortunés seraient une source de bienfaits infinis si l’État leur laissait les mains libres. Une grille de lecture communément admise par les partis de droite et certains leaders du PS .
Parallèlement, les agences de lobbying se sont aussi multipliées depuis les années 1980 pour devenir très influentes. Plus discrètes que les think tanks, elles entretiennent pourtant avec ces derniers des relations souvent complices, et dans certains cas franchement organiques. Leurs coulisses réservent des surprises, comme nous le verrons. Ces agences méritent d’autant plus d’être regardées de près qu’elles sont parvenues à instrumentaliser une grande partie des décideurs politiques qui ont littéralement « délocalisé leur cerveau ».
Le pouvoir a toujours eu ses éminences grises mais, sans qu’on en ait pris clairement conscience, l’époque des grands sherpas a déjà cédé la place à un système d’expertises captives et d’organisations qui ont pris en main la décision. En focalisant leur attention sur des hommes tels que Claude Guéant et Henri Guaino , les médias se sont trompés. Malgré l’importance qu’on leur donne, ce ne sont « que » des conseillers présidentiels appliquant une « pensée politique » sur laquelle ils n’ont pas le moindre pouvoir.
Découvrons ensemble les véritables capitaines du navire et les affréteurs qui organisent le marché des idées et produisent cette pensée à la coupe…
Chapitre 3. Fonction publique : l’hallali
Paul Nizan , Les chiens de garde, 1998
Sur la question de la dette publique, les positions des think tanks les plus influents sont assez similaires. Elles sont dictées par leur adhésion au consensus en faveur des marchés financiers, de la concurrence comme mode d’organisation de la société, d’une politique de l’euro fort et d’une régulation destinée à empêcher que le système ne vacille « sous le poids de ses excès ». Au sein de ce spectre politique, les principaux think tanks ne se distinguent qu’à la marge, notamment du fait de leur volonté « d’élaborer ce que à quoi les hommes politiques ne peuvent pas penser en raison des contraintes électorales qui pèsent sur eux », explique Jean-Paul Tran Thiet , membre du Comité directeur de l’Institut Montaigne et associé du cabinet d’avocats d’affaires White & Case . La position commune a été résumée par Daniel Bouton , le Président d’honneur de la Société générale, lors d’un débat organisé le 16 mars 2011 par l’Institut de l’Entreprise : « Les vieux pays européens, aux perspectives de croissance très modestes et au stock de dette considérable, ont-ils la gouvernance qui leur permettra de prendre les mesures nécessaires ? Comment faire pour ramener, avec le consentement social, nos déficits publics dans les normes de Maastricht [5] ? »
Aucun ne relève le paradoxe suivant : plus les think tanks se focalisent sur la dette publique, plus ils proposent de nouvelles coupes dans les dépenses pour la réduire et plus la France est endettée. Ce paradoxe s’explique par le fait que la dette publique n’est pas le fruit d’une mauvaise gestion des deniers publics mais bien d’une volonté politique : empêcher que l’État ne se mêle à nouveau à la sphère de la production et mène des politiques de réductions des inégalités, comme entre 1945 et 1976.
« Affamer la bête »
La « politique des caisses vides », comme l’appelle l’historien suisse Sébastien Guex , « consiste à limiter ou à diminuer drastiquement les recettes de l’État, en plafonnant ou en baissant les impôts, de préférence ceux des ménages les plus aisés, dans le but délibéré de creuser les déficits budgétaires » [6]. En empêchant l’État d’agir, cette stratégie redonne les coudées franches aux classes dirigeantes de l’économie, l’un des buts reconnus par Ronald Reagan , lors de son élection en 1980.
À peine élu, le Président républicain annonçait la couleur. Comparant l’État social américain à un enfant turbulent, il se faisait fort de le discipliner en « réduisant son argent de poche ». Son directeur du budget, David Stockman , était plus cru encore, affirmant qu’il voulait « affamer la bête » [7] : les baisses d’impôts devaient induire la baisse des budgets publics. L’Heritage Foundation , le think tank à l’origine de cette doctrine, a précisé les budgets en cause : ceux mis en place par Franklin D. Roosevelt lors du New Deal et par Lyndon B. Johnson lors de son projet de Grande société, qui avaient mis en place des programmes de lutte contre la pauvreté. Dans la ligne de mire des affameurs se trouvaient donc le système de retraites de base et les programmes d’assurance maladie destinés aux personnes âgées et aux pauvres [8].
Pendant les deux mandats de Ronald Reagan et celui de son successeur George H. W. Bush , les impôts ont été sensiblement réduits, contribuant à creuser un déficit sans précédent. Arguant du manque d’argent, les administrations républicaines, mais aussi plus tard démocrates, ont taillé à la hache dans les budgets de la Sécurité sociale, de l’Éducation, de la Santé et de la Culture. Ainsi, en 1996, le gouvernement Clinton a supprimé l’aide sociale aux mères célibataires, obligeant la plupart à devenir des salariées pauvres.
Enrichir les riches en appauvrissant les pauvres
Les baisses d’impôts de Reagan et de Bush père avaient transféré le poids de l’impôt des entreprises et des ménages les plus riches vers les catégories moyennes et populaires. Entre 1980 et 1990, les ménages les moins riches (20 % de la population) virent leur fiscalité augmenter de 16,2 % alors que les 20 % les plus riches bénéficièrent d’une baisse de 5,5 % ; parmi les plus aisés (5 % de la population), la baisse atteignit même 9,5 %. En prenant pour base fiscale l’année 1977, les mesures adoptées depuis ont augmenté de 25,6 milliards de dollars les impôts payés par 90 % des familles américaines en 1990. Dans le même temps, les 10 % des familles les plus riches ont épargné 93,1 milliards. Les résultats de cette politique de concentration des richesses ne se firent pas attendre, comme le montra le très officiel Bureau de la comptabilité du Congrès : les 20 % des familles les plus pauvres (7 700 dollars de revenus par an avant impôts) ont vu leurs revenus diminuer de 3,2 % durant les années 1980, alors que les familles les plus riches (20 % de la population) ont bénéficié d’un bond de 31,7 % de leurs revenus. Ceux des 5 % des plus riches ont même presque doublé (+ 46,1 %).
Ce « plan Marshall à l’envers » a depuis été poursuivi avec une grande constance. Si bien que même le journaliste républicain Kevin Philips , spécialiste des questions d’inégalités, s’écria un an après le début du mandat de George W. Bush : « Il est difficile d’éviter d’aboutir à la conclusion que les politiques économiques suivies par les Républicains dans les années 1990 et du début 2000 sont une trahison de l’héritage des deux plus grands présidents de ce parti, Abraham Lincoln et Théodore Roosevelt . » Il y a déjà plus de cent ans, ils avaient pointé les dangers que constitue la concentration des richesses et même, pour le second, mené une âpre lutte contre cet état de fait. Même Nixon, dont le programme électoral de 1972 « critiquait les multinationales qui construisaient des usines à l’étranger pour profiter d’une main-d’oeuvre moins chère », rappelle Kevin Philips, « était favorable à l’assurance maladie nationale, le maintien des revenus pour les pauvres et une fiscalité plus lourde sur les revenus hérités que sur ceux provenant du travail » [9].
La « politique de la caisse vide » s’exporte bien
Après 2001, George W. Bush a accordé de nouvelles baisses d’impôts, d’ampleur inégalée, qui ont joué le rôle de « camisole fiscale » à l’encontre du Congrès, selon les termes de l’ancien gouverneur du Texas. Ces nouveaux cadeaux faits aux patrimoines les plus importants ont contribué, avec la récession de 2008, à établir un nouveau record en matière de déficit budgétaire [10]. La très influente Heritage Foundation a repris en juillet 2002 la métaphore employée par Ronald Reagan en 1981 : « Chaque parent sait que l’on ne donne pas une bonne leçon à un enfant dispendieux en lui augmentant son argent de poche. […] Nous devons obtenir davantage de baisses d’impôts [car] il deviendrait plus difficile aux politiciens de gaspiller notre argent [11]. »
Aujourd’hui, les think tanks qui donnent le la dans les rangs républicains cherchent tous à « éduquer les membres du Congrès », comme l’indique l’Heritage Foundation , pour qu’ils coupent dans les budgets publics [12]. Le Cato Institute , basé sur la côte Ouest, remporte la compétition en proposant de faire 1 000 milliards d’économie, en particulier en repoussant l’âge de la retraite, en abrogeant la loi sur l’assurance maladie que Barack Obama a eu tant de mal à imposer et en mettant fin au ministère de l’Éducation [13]. Rien de moins. À New York, le Manhattan Institute n’hésite pas à désigner les fonctionnaires américains à la vindicte, les accusant d’être protégés de la crise qui ravage les salariés du secteur privé. Il conseille donc aux différents États composant la fédération de geler les rémunérations du secteur public [14].
La « politique de la caisse vide » est si efficace qu’elle a été exportée à travers le monde, notamment dans l’ancien Empire britannique. Autrefois havre des politiques keynésiennes, la Nouvelle-Zélande a pratiqué dans les années 1980 l’assèchement des recettes de l’État, avant d’imposer une sévère cure d’austérité qui s’est traduite par le licenciement brutal de milliers de fonctionnaires, des privatisations, la restriction des droits syndicaux et la déréglementation du droit du travail [15]. En novembre 1997, Ruth Richardson , l’une des pionnières de cette politique lorsqu’elle était ministre des Finances de la Nouvelle-Zélande de 1990 à 1993, était invitée en Suisse à un colloque sur les finances publiques. « Pour entreprendre ces réformes, il faut que les gens en ressentent l’urgence. Si vous ne connaissez pas une véritable crise, inventez-la ! » a-t-elle conseillé à ses hôtes [16].
En France aussi, la « politique de la caisse vide » a ses adeptes. Et ses pionniers : « Le déficit engendré par la baisse des impôts apparaît […] comme un formidable moyen de pression pour contraindre l’État à rétrécir. Il n’y a en vérité aucun autre moyen que cette pression », écrivait l’essayiste Guy Sorman en 1984 [17]. Près de trente ans plus tard, les think tanks passent à la seconde phase de la « politique de la caisse vide » : ils phosphorent sans fin sur les futures coupes budgétaires à promouvoir.
Les hauts fonctionnaires se tournent vers les think tanks
Ils se sont d’ailleurs pressés, le 5 juillet 2011, de dévoiler leur programme sur le sujet pour 2012, à l’invitation de la revue Acteurs publics. En matière de « réforme » de l’administration et des services publics, l’audace était de mise. Chaque orateur disposait de quinze minutes pour emporter l’adhésion d’un parterre de hauts fonctionnaires réuni à la Maison de la Chimie, dans une immense salle de conférences sise entre l’Assemblée nationale et les grands ministères de la rive gauche de Paris. Pour éviter les débords, le discours des conférenciers était ponctué toutes les cinq minutes par la sonnerie d’un bourdon.
Le directeur général de la Fondapol , Dominique Reynié , a joué, ce soir-là, sa partition sans négliger la petite note alarmiste. « La crise des finances publiques est réellement grave ; le déficit structurellement excessif. Le phénomène a souvent été commenté mais il a pris de l’ampleur : le service de la dette est de 50 milliards d’euros par an. Ceci introduit un risque de crise de l’égalité comme de la solidarité intergénérationnelle. Un nouveau conflit apparaît entre les générations, plus qu’entre les classes », affirme-t-il. Après ce diagnostic rapide, le bon docteur propose « une sorte de révolution culturelle » : « Il ne s’agit pas de renoncer au service public. Un pays comme le nôtre en a besoin et ce serait irrecevable politiquement. Or, un think tank doit imaginer des idées qui doivent inspirer l’action. » Puisque toute tentative de se passer directement de l’administration publique serait vouée à l’échec, la Fondapol propose d’amoindrir d’abord les soutiens dont elle jouit. Ainsi, la fondation propose d’interdire aux fonctionnaires de devenir parlementaires. « Il est malsain qu’il y ait 40 % des législateurs issus de la fonction publique, qui ont, par là même, la haute main sur ses recettes et ses dépenses », assure Dominique Reynié, pas le moins du monde effrayé par la promotion d’une mesure qui ferait des fonctionnaires des citoyens à part.
La Fondapol veut aussi mettre fin à la spécificité de la fonction publique : le statut de fonctionnaire. Qualifié de « pli culturel, soutenu par des intérêts organisés », ce statut juridique – qui régit les droits et les devoirs de ses agents – doit être renvoyé aux oubliettes de l’histoire afin de « sauver le service public », selon les propres termes de cet enseignant à Sciences-Po [18], pour qui « il n’y a aucune raison de penser que le service public soit nécessairement produit par des agents disposant du statut. » Ainsi, pour le représentant de ce think tank « libéral, progressiste et européen », il faudrait favoriser le passage entre privé et fonction publique : « Des personnes ayant acquis une grande expérience dans le privé sont capables de rendre de grands services à leur pays. »
Une telle dissociation entre la fonction publique et le statut de ses agents permettra de « poursuivre la réduction du nombre de fonctionnaires à vie ». À ce moment précis, le bourdon surprend la salle… Dominique Reynié se fige. Faisant le lien entre cette interruption impromptue et les propos qu’il vient de tenir, le directeur général de la Fondapol lâche dans un sourire : « C’est lugubre ! », alors que la bonne humeur s’empare de la salle.
Une partie des fonctionnaires partis à la retraite devrait donc être remplacée par des agents sous contrats privés, sans la garantie de l’emploi et les autres droits attachés à leur statut. Pourquoi faut-il réaliser cette « révolution culturelle » ? Dominique Reynié effectue une piqûre de rappel : « Un poste de fonctionnaire embauché aujourd’hui coûtera, à la collectivité locale qui l’emploiera, 1 million d’euros sur la totalité de sa carrière. Une dépense qu’il faudra assurer jusqu’en 2075- 2080, en prenant en compte la pension de retraite. Ce qui limite d’autant les marges de manoeuvre des pouvoirs publics durant les prochaines 14 législatures d’affilée et implique une remise en cause croissante de chaque génération à choisir son destin. » L’argument comptable cache mal la véritable raison de ce big bang entrevu, que Dominique Reynié avoue fièrement : « Pour la Fondapol , l’État doit être un opérateur plus qu’un acteur, régulateur plus que producteur direct de services publics. Cette conception permet de rendre à l’économie, au marché, une partie qui peut lui revenir et qui peut être produit à meilleur prix pour une qualité aussi bonne. » Comme exemple de cette formule magique, il évoque la blanchisserie des hôpitaux. Elle « pourrait aisément être confiée à des acteurs privés » (...)
La Fondapol est rejointe par un think tank moins connu, mais tout aussi libéral, l’Institut Thomas More . Ce dernier promeut l’interdiction du cumul des mandats pour éviter que le président d’un exécutif local puisse s’opposer à l’Assemblée nationale à la réduction des dépenses publiques de sa collectivité territoriale. Gérard Dussillol , expert associé à l’Institut Thomas -More, estime que « la surabondance des dépenses de l’État français a un impact sur le coût du travail », car cela oblige le législateur à augmenter les taxes en tous genres, étouffant au passage l’initiative privée. « C’est la grande responsable du chômage endémique que connaît ce pays depuis trente ans, avance Gérard Dussillol. Pour être au même taux d’emploi public que l’Allemagne, il faudrait que 1,3 million de fonctionnaires basculent dans le privé […]. En théorie, sur le long terme, cela nous ramènerait au taux de chômage allemand d’aujourd’hui. » En théorie. Suivant la même comparaison, Gérard Dussillol préconise que la France entreprenne des baisses dans les dépenses publiques en matière de logement, d’hôpital ou d’Éducation [19]. Des broutilles.
La soirée organisée par Acteurs publics est savamment mise en scène. Les grands think tanks ont pris la parole en premier, lorsque l’affluence était la plus importante. Pourtant, une surprise était réservée aux curieux restés jusqu’au bout : l’arrivée d’Agnès Verdier-Molinié , directrice de la Fondation IFRAP (Institut français pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques) , après avoir travaillé au Figaro, L’Express et France Info. À côté des propositions de l’IFRAP, les autres think tanks paraissent défendre des positions très modérées. Agnès Verdier-Molinié propose de faire 30 milliards d’euros d’économies par an : « 10 milliards dans l’administration centrale ; 10 milliards au niveau des finances locales et 10 milliards dans les budgets sociaux. Il faut que la réduction des dépenses publiques soit l’un des enjeux de 2012. » La cure d’austérité, déjà sévère, ne s’arrête pas là. L’IFRAP prône la vente des dernières participations encore détenues par l’État, dont la valeur est estimée à 660 milliards d’euros, mais aussi la vente de Météo France, de l’Insee, de Pôle emploi, de l’IGN. « Tout ce qui n’est pas au coeur de ses missions régaliennes, résume-t-elle. Au final, il ne devrait rester que 700 000 fonctionnaires dans la Défense, la Sécurité et la Justice, à l’image des réformes menées en Suède, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie. » Les économies doivent également être imposées à la Sécurité sociale. Les retraites ? « Elles devraient passer au privé. » Les hôpitaux ? « Il faut en fermer. » (...)
Chapitre 8. Principe de précaution sous haute pression
Les think tanks se livrent à un travail de dynamitage du principe de précaution depuis des années. Il faut savoir que les grandes industries n’ont toujours pas digéré l’intégration dans la Constitution, en 2004, de ce principe qui prévoit des mesures de prudence et d’évaluation vis-à-vis de produits sur lesquels pèse un faisceau de présomptions scientifiques graves. Il tient en une phrase : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en oeuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage [20]. » Nous allons voir qu’il est utile d’en connaître la définition, tant ses ennemis la déforment pour le condamner.
Malgré l’avis défavorable des industriels, très agressifs à son endroit, Jacques Chirac a obtenu sa constitutionnalisation. Après quelques mois de relatif silence, les think tanks sont revenus à l’assaut, en rangs serrés. Depuis l’arrivée de Nicolas Sarkozy à l’Élysée, en 2007, même des commissions nommées par le président de la République participent au laminage du principe de précaution en lui faisant proclamer l’inverse de ce qu’il énonce.
Ce principe renforce la responsabilité des industries qui nous exposent à des risques et il donne un argument juridique aux victimes en cas de procès. La crainte des assureurs d’entreprises qui pourraient devoir assumer des condamnations financières n’est pas étrangère à leur mobilisation. Ce principe offre aux citoyens la possibilité de saisir les tribunaux même quand certains doutes subsistent sur un danger. Le petit jeu qui a longtemps consisté à entretenir des doutes sur la toxicité d’un produit pour retarder son retrait du commerce sera désormais un peu moins tentant pour les producteurs. En l’inscrivant dans la Charte de l’environnement adossé à la Constitution, le législateur qui a suivi Jacques Chirac a envoyé un signal fort à l’opinion car il a donné au principe une force supérieure aux articles de loi.
Comme l’ont montré les affaires de l’amiante et de divers autres cancérogènes, perturbateurs endocriniens ou neurotoxiques, l’industrie tarde trop souvent à retirer du marché les produits délétères ou à fixer des règles d’usage suffisantes. À l’avenir, les entreprises devront faire preuve d’une prudence qui n’était pas dans leurs habitudes. À moins que leur lobbying et le travail des think tanks ne parviennent à faire reculer les politiques. D’autant que les secteurs concernés regroupent les multinationales de la chimie, du médicament, de l’agroalimentaire, de la plasturgie, de l’eau…
La commission Attali, Areva, Axa , Nestlé …
Les think tankers sont rapidement montés au créneau pour miner le principe de précaution en confectionnant un discours type que l’on retrouve souvent dans les médias, y compris sur le Net. François Ewald , le fondateur de l’Observatoire du principe de précaution, un think tank créé en 2006 pour se consacrer exclusivement à cette tâche, en est le grand ordonnateur. Et il ne fait pas vraiment dans la dentelle. Il oppose radicalement innovation et précaution, ou encore développement économique et prévention, tout en prédisant des catastrophes pour la santé des… entreprises.
On en retrouve la trace très caractéristique, en octobre 2007, dans le premier rapport de la commission Attali « pour la libération de la croissance française ». Selon ses auteurs, le principe de précaution créerait « des incertitudes juridiques et instaure un contexte préjudiciable à l’innovation et à la croissance, en raison des risques de contentieux en responsabilité à l’encontre des entreprises les plus innovantes devant les tribunaux de l’ordre judiciaire » [21].
Cette commission dirigée par Jacques Attali, mise en place par Nicolas Sarkozy dès sa victoire électorale, n’a pas hésité à demander qu’on supprime le principe de la Constitution. Elle n’a même pas eu un mot sur le règlement Reach, entré en vigueur en 2006 dans l’UE, qui impose d’évaluer plus sérieusement la toxicité des substances en circulation. Son importance est pourtant capitale : c’est l’une des expressions européennes du principe de précaution. Les lobbies industriels l’ont d’ailleurs vivement combattu en publiant toutes sortes d’études prétendant que cette évaluation allait ruiner la compétitivité des entreprises européennes, et ils ont réussi à le vider en partie de son contenu.
L’attitude de la commission Attali s’éclaire en examinant sa composition : Claude Bébéar , qu’on ne présente plus , Anne Lauvergeon , encore présidente d’Areva , les dirigeants de Nestlé , Essilor , Accor , Crédit agricole , Barclays , Cetelem et des think tankers libéraux n’ayant jamais montré une grande sensibilité pour la protection sanitaire, comme Jacques Delpla , membre du Conseil d’analyse économique (CAE) et ancien conseiller de Nicolas Sarkozy à Bercy, ou Geoffroy Roux de Bédieu, P-DG d’Omega Telecom , membre du conseil de surveillance de PSA Peugeot -Citroën et président de l’Unedic, parmi d’autres.
Même la secrétaire d’État à l’Écologie, Nathalie Kosciusko- Morizet, n’a pu rester sans réagir : « La proposition de la commission Attali, qui veut que l’environnement soit contre la croissance, qu’il soit un frein à la croissance, est une vision réactionnaire », déclarait-elle dans une interview du Monde [22]. « J’avais déjà eu, lors de la discussion sur la Charte de l’environnement, de tels débats avec une frange qui traverse d’ailleurs tout l’échiquier politique. » Vérification faite, il est apparu que la Commission Attali n’avait pas daigné analyser sérieusement les vertus économiques du principe de précaution. Une mauvaise volonté manifeste doublée d’une ignorance arrogante chez certains de ses membres. Nathalie Kosciusko-Morizet s’est chargée de corriger les choses : « Le principe de précaution est un axe, non pas pour casser l’industrie ou interdire la recherche, mais au contraire pour inventer une nouvelle économie, pour trouver des avantages concurrentiels sur de nouveaux secteurs, ceux de l’environnement, des énergies renouvelables, de la chimie verte, pour inventer une nouvelle croissance. C’est aussi un principe de bon sens qui sert à s’écarter de possibles catastrophes ou de grandes pollutions comme celles que nous observons, ces jours-ci, avec les PCB [polychlorobiphényles] ou la chlordécone aux Antilles [23]. » Finalement, le président de la République a annoncé qu’il ne suivrait pas la recommandation Attali.
Des confusions volontaires
Les attaques contre le principe de précaution ne datent pas d’hier, mais elles se sont intensifiées avec la multiplication des think tanks et, surtout, quand Jacques Chirac a exprimé son intention de l’intégrer au socle constitutionnel français. Pourquoi ont-ils réagi avec autant de virulence alors que le traité constitutif de l’Union européenne l’impose aux États membres depuis… 1993 [24] et qu’il est transcrit dans le droit français depuis 1995 [25] ?
Dans un premier temps, les lobbies industriels ne s’y sont pas attaqués publiquement de peur de lui faire de la publicité et d’attirer l’attention des associations sur ce qui pouvait constituer un appui juridique dans le cadre de procès. Le maintien du commerce de l’amiante et de nombreux produits au-delà de 1993 contrevenait au principe de précaution. Les textes offensifs étaient publiés dans des revues confidentielles, essentiellement rédigés par des consultants de compagnies d’assurances préférant éviter de se voir mises à contribution en cas de problème.
« D’un côté, la prévention vise un objectif imparfait mais rationnellement fondé et économe, de l’autre, la précaution promet un risque zéro uniquement fondé sur la peur et ne pouvant atteindre son objectif – dans le cas où l’hypothèse serait pertinente – qu’au prix de la paralysie », écrivait en 2001 Nicolas Loukakos , un ancien pilote de ligne devenu consultant pour une entreprise de courtage d’assurance [26]. « Qu’on le veuille ou non, le risque est et restera indissociable de toutes les activités humaines », assenait le consultant. « Ce principe peut paradoxalement faire échec à des stratégies de prévention à long terme axées sur l’amélioration de la sécurité. » Cette réduction du principe de précaution à un principe d’interdiction systématique était une énormité, le principe de précaution n’ayant jamais promis de « risque zéro ». Mais les think tanks l’ont reprise en choeur au cours des années suivantes, en se gardant bien de la rectifier. La définition officielle est ainsi devenue un tabou et les caricatures du principe ont envahi la presse.
Pour tenter de limiter ce confusionnisme, le ministère de l’Environnement a demandé au Comité de la prévention et de la précaution (CCP) de diffuser une mise au point à la fin de l’année 2004, à la veille de la constitutionnalisation du principe [27]. Les think tanks feront semblant d’ignorer le document, qui rappelle pourtant que le principe de précaution propose une « panoplie de mesures de sécurité possibles : interdiction pure et simple d’un produit, obligation d’évaluation préalable, organisation d’une veille sanitaire, financement d’un programme de recherche destiné à mieux cerner les risques, etc. ». Un éventail d’actions où « le décideur doit choisir celle qui paraît la plus adaptée aux circonstances de chaque cas d’espèce ». Difficile d’être plus clair et raisonnable. Les auteurs soulignaient d’ailleurs très explicitement que la « mauvaise foi » de certains détracteurs prétendant y voir un « principe suicidaire pour la France » justifiait ce rappel.
Chapitre 10. Préserver notre faculté d’indignation
George Orwell [28], 1946
Il est amusant de noter combien les professionnels des think tanks, en France, se soucient de justifier leur existence auprès de l’opinion. C’est le signe le plus sûr de leur difficulté à se banaliser dans le paysage politique, à tout le moins de leur insatisfaction en termes de reconnaissance. Ce déficit d’image, dû au sentiment diffus de leur manque d’indépendance et de leur vocation obscure, est semblable à celui qu’éprouvent les lobbyistes qui, dans notre pays, se plaignent des suspicions qui planent sur leur métier et imputent leur mauvais accueil dans l’Hexagone à un « retard typiquement français ». Aucun d’eux ne reconnaît qu’en réalité il ne s’agit pas d’un retard congénital mais d’une faculté d’indignation encore vivante, exprimant plutôt notre fraîcheur devant les métiers d’influence et les grands groupes privés qui tissent leurs réseaux.
« Les think tanks français sont trop peu nombreux, trop pauvres, trop cloisonnés » déplorent ainsi le lobbyiste et maître de conférence à Sciences-Po, Stephen Boucher , codirecteur de Notre Europe, et la journaliste Martine Royo [29]. Les mêmes n’hésitent pas à s’en prendre aux groupes de réflexion ayant des ressources publiques qui, dès lors, leur apparaissent comme « enfermés dans le giron de l’État ». Ils en tirent une conclusion sans appel : « L’État et la haute administration ne font pas confiance à la société civile [30]. » L’argument semble sorti tout droit de l’armoire à formules standards du Medef qui oublie toujours que les grandes entreprises ne sont pas à elles seules « la société civile ». Plutôt que de se féliciter de voir des structures échappant un peu au secteur privé qui approfondissent des problèmes sans devoir faire plaisir à des grands groupes les maternant généreusement, les auteurs se montrent goguenards : « Ils ont peu de chercheurs, peu de moyens, et sont plus doués pour la recherche que pour l’influence. »
D’ailleurs, d’où vient l’idée que les réflexions politiques devaient nécessairement passer par des perfusions financières, qui plus est administrées par les grands groupes ? « Être financé par les lobbies financiers ou ne pas être » serait-il devenu le credo de l’intellectuel ? Le désintéressement et l’engagement semblent condamnés à faire sourire les think tankers. À aucun moment, ces observateurs ne s’interrogent sur ce qui les incline à cette condescendance. En réalité, elle traduit une banalisation de l’allégeance financière aux titans économiques. D’ailleurs, poser la question est en passe de devenir tout bonnement incompréhensible pour nos contemporains : pourquoi la vie intellectuelle doit-elle être rémunérée dès lors qu’elle concerne la sphère politique ? Comme s’il fallait se résigner devant la marchandisation de la pensée quand il s’agit de prendre pour objet les affaires de la cité…
En tout état de cause, ces « penseurs politiques » à la mode anglo-saxonne ne craignent pas l’oxymore : « Il n’y a pas moyen de financer une réflexion indépendante », déclare sans vergogne Philippe Herzog , un polytechnicien qui assume la fonction de conseiller spécial de Michel Barnier à la CE [31], après avoir perdu son siège de député européen communiste en 2004 [32]. Il préside par ailleurs Confrontations Europe, un think tank fondé en 1991 qui diffuse une « lettre » à 30 000 exemplaires et se veut une interface entre les entreprises, l’Europe et la « société civile ». Le think tank regroupe des patrons de poids, comme Jean Peyrelevade. Les promoteurs de think tanks s’accordent à soutenir que les institutions européennes seraient de plus en plus sensibles à la « pensée anglo-saxonne », tandis que « Paris constate que la sienne est en recul [33] ». Mais, en regardant les choses de près, on constate surtout que la pensée de Paris est de plus en plus calquée sur le néolibéralisme anglo-saxon.
Fausse indépendance des think tanks
Les think tanks ne cherchent pas à justifier leur existence en défendant l’idée qu’ils peuvent apporter aux « entreprises françaises » une plus grande efficacité dans leurs démarches auprès des instances politiques car cette vocation n’est pas contestée. C’est au contraire l’évidence de cette vocation qui nuit à leur réputation auprès du grand public. C’est toujours la question de leur dépendance vis-à-vis du secteur privé qui freine leur acceptabilité sociale et, au-delà, représente une véritable corruption des institutions. Comment donc faire croire qu’en étant financé par des multinationales ils pourraient affirmer leur indépendance ? Un argument perce progressivement dans les textes, à l’instar du précepte édicté par l’infatigable Stephen Boucher : « L’idéal pour un think tank est d’être financé par des bailleurs de fonds diversifiés dont les velléités d’intervention dans le travail des chercheurs s’annulent les unes les autres. Ou d’être financés par des fondations désintéressées [34]. » L’idéal, donc, serait de trouver des bailleurs qui ne partageraient pas d’intérêts communs et qui seraient même assez opposés pour que leur tropisme respectif soit neutralisé. Mais où a-t-on vu des acteurs privés dont les intérêts s’opposent assez pour ne pas voir dans l’État et la défense de l’intérêt général un obstacle sur le chemin de la dérégulation et de la spéculation ? Nous avons vainement cherché sous la plume des docteurs en think tanks un exemple d’un tel montage qui aurait pu donner un semblant de crédibilité à cette idée. Pourquoi n’en fournissent-ils pas ? Même dans le cas de think tanks dont le budget est abondé à la fois par des fonds publics et des fonds privés, leurs forces respectives ne trouvent pas de point d’équilibre, les financements privés ayant tôt fait de rompre le rapport pour inspirer aux travailleurs de la pensée des sentiments plus libéraux. Voilà précisément ce que le statut des fondations, en France, vise à éviter en fixant des proportions stables à ces ressources. Mais au lieu de les prendre pour modèles, Stephen Boucher y voit encore la mainmise « idéologique » de l’État, tout en reconnaissant qu’« elles produisent elles-mêmes des études souvent de qualité sur des problèmes politiques ou économiques d’actualité ».
Autrement dit, tout ce qui n’est pas libéral serait idéologiquement orienté et manquerait d’indépendance.
La guerre des mots
Si les think tanks confessent qu’ils livrent une véritable guerre des idées, ils parlent moins volontiers des armes qu’ils emploient, à commencer par celles des mots et de leur sens. Les progrès de la linguistique depuis la fin du XIXe siècle ont permis de mieux comprendre les relations entre le langage et la pensée, notamment la manière dont le premier alimente et conditionne les idées et les analyses. On sait aujourd’hui que changer la définition d’un mot ou le remplacer par un autre permet d’élaguer des branches sémantiques qui nourrissent certaines pensées, c’est-à-dire de réduire la probabilité qu’une réflexion critique vienne à l’esprit et de favoriser au contraire des pensées réjouies. Il est ainsi possible, surtout sur les jeunes générations qui n’ont pas été mises au contact de certaines oeuvres critiques, d’effacer littéralement des pensées sédimentées dans le langage par le travail de siècles de penseurs.
L’élagage actif de la multiplicité des définitions qui développaient la richesse d’un mot n’est d’ailleurs pas la seule opération psycholinguistique menaçant de neutraliser des pistes de réflexion. L’inversion des acceptions en est une autre. Dans le langage que répandent les think tanks néolibéraux, le mot « indépendant » est ainsi utilisé généreusement pour qualifier un intellectuel ou une association dont le travail est commandité par un groupe financier ou une formation politique. Là où le soupçon d’« allégeance » devrait se présenter à l’esprit compte tenu de cette relation de dépendance financière et/ou idéologique, c’est la notion d’indépendance qui est employée, arguant de l’idée que « l’indépendance » s’entend vis-à-vis de l’État. Le procédé est énorme, pour le moins abusif, mais systématiquement employé. Son adoption par tous les auteurs de textes produits par les think tanks n’est pas sans effet sur leur lectorat qui, tôt ou tard, en vient à adopter les mêmes réflexes linguistiques et l’appauvrissement mental qui l’accompagne.
On trouve aussi le même procédé pour qualifier les intellectuels eux-mêmes : celui qui travaille pour un think tank créé et financé par un groupe financier est désigné par l’expression « penseur indépendant », tandis que celui qui n’a pas de lien financier avec des entreprises ou un lobby sera qualifié par ses liens publics comme s’il en résultait une orientation coupable de ses écrits : le mot « universitaire » ou « d’État » rend suspecte la personne ou la structure qualifiée.
Les think tanks néolibéraux livrent une guerre permanente contre les valeurs et les repères rappelés par le vocabulaire qui fait obstacle à leur redéfinition du pensable. En réduisant la polysémie des mots à une acception techno-politique néolibérale, ils menacent d’effacer jusqu’au souvenir positif des concepts critiques. Ce qui fut le grand danger de la politique linguistique et idéologique des pays communistes, tenant l’opinion dans les rets d’un langage réorganisé autour d’un nouveau lexique instrumentalisé, est revenu sous la forge des think tanks. George Orwell reste à cet égard d’une parfaite pertinence puisque son 1984 décrit une société où la pensée se réduit à proportion des rétrécissements du dictionnaire et des définitions logiquement inacceptables mais imposées comme nouveau langage (Newspeak ou Novlangue) susceptibles d’advenir aussi bien en Grande-Bretagne que dans les pays du bloc de l’Est [35].
Cette guerre des mots est menée bataille après bataille, comme s’il s’agissait de conquérir des « places fortes » permettant de contrôler les allées et venues de la conscience. Vieil enjeu des débats idéologiques et de la communication des leaders, la sémantique est devenue aussi importante dans le travail des think tanks qu’elle l’est dans le marketing politique et commercial. Notons que les cabinets qui organisent la communication des responsables politiques, le lobbying des entreprises et les stratégies de « gestion de crise » sont également très actifs en ce domaine, appliquant les mêmes recettes. Des exemples particulièrement pathétiques en ont été donnés avec le traitement des dossiers sanitaires de l’amiante et des boues toxiques : l’expression « usage contrôlé de l’amiante » pour remplacer celle de « maintien du commerce de l’amiante » est toujours utilisée dans les pays qui n’ont pas interdit ces fibres cancérogènes. De même, le terme de « nutrigalettes » remplaçant celui de boues toxiques (accompagnant une opération complémentaire de transformation du conditionnement d’une partie des boues en sortie de stations d’épuration avant de les livrer aux agriculteurs) en offre une autre illustration, moins ridicule qu’elle ne semble au premier abord [36].
Autre opération de manipulation rhétorique, les think tanks aiment se présenter comme des contre-pouvoirs alors même qu’ils ont pour vocation d’entretenir et de renforcer le discours du pouvoir politique et économique. Ce faux semblant qui vise moins à dissimuler leur fonction réelle qu’à lui associer des connotations sympathiques et à brouiller les notions critiques a des corollaires : tout d’abord, leur affirmation martelée qu’ils sont indépendants, à l’instar de leurs homologues américains, est frappante. Ce type de répétition a un effet mnémotechnique et sémantique puissant : il parvient, à la longue, à faire entendre encore l’idée du participe quand ce dernier n’est plus prononcé. C’est l’un des principes les plus puissants du marketing et l’un des plus anciens. Il a toujours été à la base de la poésie, de la chanson, de la psalmodie et de la prière. Son effet sur l’imaginaire est d’ordre psychogénétique (pour ne pas dire psychotique), il subvertit ponctuellement la frontière entre le sentiment et le réel, l’annonce et la vérification.
Autre corollaire de l’autoproclamation à l’indépendance et au contre-pouvoir : l’idée que la qualité de l’expertise des think tanks transcende la « vision grossière » ou les « clichés » qui aveugleraient le pouvoir et l’opinion publique. Par exemple, la vocation de l’État à assurer des services publics, à donner à ses agents un statut public, la différence entre intérêt général et intérêt particulier [37]… (...)
Notes
[1] Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Livre IV, Université du Québec à Chicoutimi, 2002, p. 219.
[2] James G. McGann , Global « Go-To Think Tanks Report 2010 », University of Pennsylvania, 2011.
[3] La Fondapol (Fondation pour l’innovation politique) est l’un des membres du European Idea Network , intervenant auprès des instances européennes, notamment grâce à sa proximité avec le groupe parlementaire du parti populaire européen qui le finance, et regroupant un réseau de think tanks puissants, dont la Fondation Robert-Schuman, la FAES Fondation, la Konrad Adenauer Stiftung (Kas), le Centre for European Policy Studies (Ceps) et le Trans Atlantlic group (Tag).
[4] Les chiens de garde, Marseille, Agone, 1998 (La Découverte, 1960), p. 133.
[5] « Zone euro : comment gérer la crise de la dette publique ? », Institut de l’Entreprise , Working paper, n° 54, mai 2011.
[6] Sébastien Guex, « La politique des caisses vides », Actes de la recherche des sciences sociales, n° 146-147, 2003.
[7] Paul Krugman , « The Tax-Cut Con », New York Times, 14.09.2003.
[8] Barbara Ehrenreich , L’Amérique pauvre. Comment ne pas survivre en travaillant, Paris, Grasset, 2004.
[9] Kevin Philips , Wealth and democracy, New York, Random House, 2002.
[10] « Les baisses d’impôts de George W. Bush ont profité de manière disproportionnée aux plus fortunés, exacerbant les inégalités, calcule l’Economic Policy Institute, un think tank démocrate implanté à Washington. Le 1 % des ménages les plus riches (gagnant plus de 645 000 dollars par an) ont bénéficié de 38 % de sommes économisées par les contribuables entre 2001 et 2008 ; 55 % des impôts non réclamés ont concerné la couche des 10 % des ménages gagnant plus de 170 000 dollars par an. » La population des 0,1 % des contribuables les plus aisés (gagnant plus de 3 millions de dollars par an) ont été les bénéficiaires d’une baisse d’impôts d’environ 520 000 dollars, soit 450 fois plus que la part reçu par la moyenne des ménages de la classe moyenne. (Tenth Anniversary of the Bush-era Tax Cuts, Economic Policy Institute, 01.06.2011)
[13] A Plan to Cut Spending and Balance the Federal Budget, by Chris Edwards , Cato Institute , voir ICI, April 2011. Un plan qui comporte des similitudes avec les projets dévoilés par l’American Entreprise Institute (Federal budget mess : Six ways to fix it Christian Science Monitor, 06.07.11).
[15] Serge Halimi, « La Nouvelle-Zélande éprouvette du capitalisme total », Le Monde diplomatique, avril 1997.
[16] Le Nouveau Quotidien, 10 novembre 1997.
[17] Guy Sorman , La Solution libérale, Paris, Fayard, 1984, p. 130, in La politique des caisses vides, op. cit.
[18] La loi du 19 octobre 1946 « relative au statut général des fonctionnaires » reflète le rapport de force issu de la Seconde Guerre mondiale et cristallisé dans le programme du Conseil national de la Résistance, appelé Les jours heureux. « Son élaboration, initiée par le général de Gaulle et reprenant les acquis de la jurisprudence du Conseil d’État, sera essentiellement le résultat d’un travail réalisé sous l’impulsion de Maurice Thorez, alors ministre d’État chargé de la Fonction publique, impliquant activement des représentants de la CGT et de la CFTC », écrit l’ancien ministre de la Fonction publique et des réformes administratives, Anicet Lepors. (Séminaire du SNEP-FSU, Châtenay-Malabry, 04.11.2009 – voir ICI)
[19] Le service public en 2030. Spécial prospective », Acteurs publics, juinjuillet 2011, p. 42.
[20] Constitution de la Ve république, article 5 de la Charte de l’environnement, 2004.
[21] Rapport de la Commission pour la libération de la croissance française, sous la présidence de Jacques Attali , 15 octobre 2007, remis officiellement au président de la République le 28 janvier 2008, p. 91-92.
[22] Hervé Kempf , « Nathalie Kosciusko-Morizet : “La commission Attali a une vision réactionnaire” », Le Monde, 12.10.07.
[23] Ibid.
[24] Le 7 février 1992, en adoptant le traité de Maastricht et son article 130R (entré en vigueur le 1er novembre 1993), l’UE a fait du principe de précaution un droit communautaire opposable aux décisions politiques risquant d’entraîner des dommages importants à l’environnement ou à la santé de la population, mais aussi une référence juridique qui devrait permettre de demander en justice des sanctions contre ceux qui l’ont transgressé.
[25] Loi Barnier de 1995.
[26] Nicolas Loukakos , « Les dérives prévisibles du principe de précaution », Facteurs humains, n° 7, lettre d’information du SAAM, juin 2001.
[27] « Avis du Comité de la prévention et de la précaution relatif au principe de précaution », 2004-2005. Le CCP a été créé en 1996.
[28] La Politique et la Langue, Londres, 1946.
[29] Stephen Boucher et Martine Royo , « La France : des idées mais peu d’influence », in Les think tanks, Paris, Éditions du Félin, 2006.
[30] Ibid., p. 76.
[31] Michel Barnier est commissaire européen au Marché intérieur et Services. Cité par Stéphen Boucher, op. cit.
[32] Siège qu’il a occupé de 1989 à 2004.
[33] Stephen Boucher , op. cit., p. 78.
[34] Ibid., p. 80.
[35] James Conant, « Orwell et la dictature des intellectuels », in Les intellectuels, la critique et le pouvoir, Marseille, Agone, 2009.
[36] Voir John Stauber et Sheldon Rampton, L’industrie du mensonge, préfacé et completé par Roger Lenglet, Marseille Agone, 2003.
[37] Voir index : Dominique Reynié.