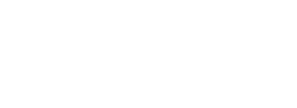Intranet
Accueil > COP climat, justice climatique (...) > Conférences & plaidoyers climat, (...) > COP 16 sur la Biodiversité |
COP 16 sur la Biodiversitéactualisé au 3 novembre 2024 Vendredi 18 octobre 2024, par La 16e conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique s’est achevée le 2 novembre, sur un échec sur le financement du Cadre mondial pour la Biodiversité. |
 |
Bilan de la COP 16 sur la diversité biologique
La 16e conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique, qui a connu une affluence record de l’ordre de 23 000 participant-es, s’est achevée le 2 novembre à Cali, en Colombie. Elle avait été prolongée de 24 heures en raison d’impossibilité d’un accord sur le sujet habituel d’affrontement entre pays occidentaux menés par l’Union européenne, le Japon et le Canada et pays des Suds, menés par le Brésil : le financement du Cadre international sur la Biodiversité adopté en 2022. Celui-ci prévoit notamment la conservation de 30 % des zones terrestres, des eaux intérieures et des zones côtières et marines et la restauration de 30 % des écosystèmes dégradés, nécessitant de mobiliser, d’ici 2030, 200 milliards de dollars par an (dont trente milliards d’aide des pays riches). Les pays du Sud demandent la création d’un nouveau fonds plus accessible que l’actuel Fonds mondial du Cadre sur la Biodiversité (Global Biodiversity Framework Fund) géré par la Banque mondiale, les pays riches refusent ce nouveau mécanisme.
L’impossibilité de prendre une décision renvoie donc cet enjeu central à la prochaine COP17 biodiversité, que l’Arménie a obtenu (contre l’Arzerbaïjan) en 2026 ou à des sessions intermédiaires de la Convention sur la diversité biologique, d’ici là.
La formalisation de processus de suivi et d’indicateurs fiables pour le Cadre mondial sur la biodiversité n’a pas non plus beaucoup avancé.
Par contre la création d’un mécanisme financier multilatéral géré par l’ONU pour le partage des bénéfices tirés des ressources génétiques numérisées entre les pays développés et en développement a été annoncée (le "fonds de Cali"). Les entreprises (comme les industries pharmaceutiques, agroalimentaires, cosmétiques) qui tirent des bénéfices de la diversité biologique en la séquençant en laboratoire à partir de banques de données en libre accès, abonderaient le fonds à hauteur de 0,1% de leurs revenus ou 1% de leurs bénéfices, selon des modalités indicatives et incertaines, car ce mécanisme serait sur la base du volontariat.
La moitié de ces financements devraient revenir aux peuples autochtones et communautés locales, dont l’importance pour la gestion de la biodiversité a été reconnue par la création d’un "organe subsidiaire" (permanent et consultatif) de la CDB (sous l’article 8(j), qui devrait leur permettre d’être mieux représentés dans les processus de consultation et de décision. Le rôle des personnes d’ascendance africaine (au nombre estimé à 200 millions dans les Amériques) a également été reconnu par une décision. [1]
Une décision a été adoptée, "reconnaissant pleinement le rôle des langues des peuples autochtones et des communautés locales communautés locales et, à cet égard, le rôle particulier des femmes autochtones et des membres des communautés locales, des jeunes et des parties prenantes concernées, dans la transmission intergénérationnelle des langues traditionnelles" (Article 8(j)).Télécharger
44 pays ont publié, y compris durant la COP, leur Stratégie et Plan d’Action National pour la Biodiversité (SPANB ou NBSAP) ; 119 pays ont soumis leurs objectifs nationaux.
Une décision sur "Biodiversité et santé" adopte un Plan d’action mondial sur ce thème, visant à "aider les Parties et les autres gouvernements à tous les niveaux les organisations et initiatives concernées, les peuples autochtones et les communautés locales, les femmes, les enfants, les jeunes, le secteur privé et les autres parties prenantes à intégrer les liens entre la biodiversité et la santé dans leurs activités, dans les politiques, stratégies, programmes et comptes nationaux"(...). Télécharger (en anglais)
Autre lieu de négociations important : la COP29 sur le climat, qui a commencé le 11 novembre 2024. Même inachevée, la COP Biodiversité de Cali aura peut-être permis une meilleure prise de conscience des liens étroits entre la crise de la biodiversité et le dérèglement climatique. Pour autant, malgré l’urgence, les approches par les marchés, la financiarisation du vivant, les "solutions" telles que la compensation sont aussi au devant de la scène de la "conservation de la nature" comme elles le sont devenues pour le climat, primant l’approche par les droits humains. Un point intéressant souligné par des organisations de la société civile : la décision de la COP16 réaffirmant le moratoire international de fait sur la géo-ingénierie (notamment les expérimentations de fertilisation des océans pour l’absorption du carbone). Face aux pressions de ces "solutions climat" hasardeuses, la COP Biodiversité parvient donc, sur certains aspects, à maintenir son approche par le principe de précaution.
Mais l’échec sur le financement pourrait aussi exacerber dans d’autres négociations le clivage Nord / Suds sur ces questions financières, que les uns voient comme des "aides", des "transferts" financiers et d’autres des "réparations" de préjudices subis.
![]() Documents des décisions officielles COP16
Documents des décisions officielles COP16
![]() Recommandations de l’Instance permanente sur les questions autochtones relatives à la Convention sur la diversité biologique
Recommandations de l’Instance permanente sur les questions autochtones relatives à la Convention sur la diversité biologique
![]() Le rôle des personnes d’ascendance africaine, comprenant des [collectifs] incarnant les modes de vie traditionnels, dans l’application de la CDB
Le rôle des personnes d’ascendance africaine, comprenant des [collectifs] incarnant les modes de vie traditionnels, dans l’application de la CDB
![]() Biodiversité et changements climatiques
Biodiversité et changements climatiques
![]() Genre et biodiversité, objectif 23 du Cadre mondial pour la biodiversité
Genre et biodiversité, objectif 23 du Cadre mondial pour la biodiversité
Présentation de la Convention pour la diversité biologique
La biodiversité désigne l’ensemble du monde vivant : diversité génétique, diversité des espèces et diversité des écosystèmes ou milieux naturels.
Du fait des activités humaines, la planète est entrée dans une phase d’extinction massive des espèces : surexploitation des ressources, déforestation, extraction minière, destruction des fonds marins, agriculture et aquacultures industrielles, élevage, urbanisation et infrastructures de transport, invasion d’espèces due à la mondialisation des échanges, disparition de milieux naturels... Si le modèle de développement prédateur et inéquitable n’est pas inversé, les humains auront détruit 75 % des autres espèces existant sur la planète en 500 ans (IPBES). Actuellement, 75 % des milieux terrestres et 50% des écosystème d’eau douce sont altérés, plus de 85 % des zones humides détruites, 66 % des milieux marins détériorés. [2] 38% des arbres, soit plus d’une espèce d’arbre sur trois dans tous les pays du monde est menacée d’extinction, selon l’Union internationale pour la Conservation de la NatureI, qui publie en début de 2ème semaine de la COP16 sa première "Évaluation mondiale des arbres" [3]
La Convention sur la diversité biologique (CBD) est l’une des trois importantes conventions internationales adoptées à la Conférence internationale sur l’environnement et le développement à Rio en 1992, avec la Convention cadre des Nations unies sur le changement climatique (CCNUCC) et la Convention des Nations unies sur la Lutte contre la désertification (CNULCD). Les trois objectifs de la Convention sur la biodiversité, traité international juridiquement contraignant, sont la conservation de la diversité biologique ; l’utilisation durable et soutenable de la biodiversité ; le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques.
Une Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) a été instaurée, qui est le pendant du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) pour le climat.
Les Conférences des parties (COP) de la Convention sur la diversité biologique (CBD) se tiennent tous les deux ans (la prochaine aura lieu en 2026 en Arménie). Tous les Etats sont signataires de la Convention (sauf les Etats-Unis). Ils doivent traduire la CBD au niveau national en élaborant tous les 10 ans leur Stratégie et Plan d’Action National pour la Biodiversité (SPANB). Mais 70% des pays n’ont toujours pas publié leur Stratégie de mise en oeuvre du Cadre mondial sur la biodiversité adopté en 2022, et qui devait être présentée pour la COP16. Une évaluation mondiale de la mise en oeuvre des Plans nationaux est prévue en 2026, lors de la COP17. [4]
La 16e conférence des parties (COP16) de la Convention sur la diversité biologique se tient du 21 octobre au 1er novembre à Cali, en Colombie. Elle fait suite à la COP15 de décembre 2022, qui avait aboutit à l’Accord de Kunming-Montréal, remplaçant les précédents "20 objectifs d’Aïchi" (2011-2020). Le cadre de Kumming-Montréal, qui n’est pas juridiquement contraignant, prévoit notamment la conservation de 30 % des zones terrestres, des eaux intérieures et des zones côtières et marines (actuellement 17 % des terres et 8 % des zones marines sont plus ou moins protégées) ; la restauration de 30 % des écosystèmes dégradés ; la réduction de moitié de l’introduction d’espèces envahissantes ; et la réduction des subventions préjudiciables à hauteur de 500 milliards de dollars par an.
Publié par l’UICN et le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) lors de la COP16 le Rapport "Protected Planet" de 2024 fait le bilan de l’objectif “30×30” de l’Accord de Kunming-Montréal. 17,6% des terres et eaux intérieures et 8,4% des océans et zones côtières seraient actuellement dans des zones protégées et conservées. Les forêts couvrent environ 30% des terres émergées et les océans 70% de la planète. Lors de la journée sur la forêt et l’eau le 25 octobre à la COP16, a été présenté le rapport "The Forest Factor : The Role of Protection, Restoration, and Sustainable Management of Forests for the Implementation of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework".
La COP16 de 2024 examine les modalités de mise en oeuvre par les pays des 23 objectifs de l’Accord Kunming-Montréal adoptés à la COP précédente de 2022 (cf. ci-dessous le détail des objectifs) et leurs indicateurs de suivi, ainsi que les financements et leur accessibilité.
Comme dans les négociations climat, la question de la "justice écologique" et le clivage Nord - Sud sont au centre de débats épineux. Un enjeu central est celui de la propriété de la diversité biologique, du "partage juste et équitable" des bénéfices (monétaires et non monétaires) issus de l’utilisation des ressources génétiques et connaissances traditionnelles associées (Protocole de Nagoya adopté en 2010 à la COP10), notamment les "informations de séquençage numérique" (ISN ou DSI "digital sequence information"), séquences génétiques de la biodiversité qui figurent dans des bases de données. En effet, la biodiversité n’a plus besoin d’être prélevée dans la nature, les avancées technologiques des pays les plus riches permettant son séquençage numérique et les outils de l’Intelligence artificielle accélèrent ces processus. En discussion à la COP : la création d’une banque de données génétiques des espèces végétales et animales, qui serait gérée par l’ONU et pour lesquelles les utilisateurs devraient payer. Certains scientifiques estiment que ces banques de données génétiques devraient d’accès public.
Les enjeux financiers de la biodiversité sont énormes (semences, médicaments, vaccins, etc.) et le pouvoir économique des multinationales du secteur pèse lourd face aux droits des peuples et communautés autochtones.
Ceux-ci représentent 476 millions de personnes dans le monde (5 % de la population mondiale), répartis sur un quart des terres de la planète, qui abrite 80 % de la biodiversité mondiale et environ 40 % des zones protégées et des paysages écologiquement intacts. Leur rôle historique et actuel dans le maintien et même la création de biodiversité (semences paysannes par exemple) n’est pas suffisamment reconnu ; des conflits surgissent entre leur place dans leurs territoires et les politiques promues par les Etats ou certaines organisations environnementales pour la "conservation de la nature" (ou des aménagements d’espaces dédiés à des "puits de carbone"). Les communautés autochtones demandent le respect de leurs droits prévus par la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP) et la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples autochtones et tribaux ; en particulier l’application du "Consentement libre, préalable et éclairé" avant et pendant l’octroi de licences, l’extraction et le traitement des minerais.
Comme pour les négociations climatiques, la responsabilité des pays riches et leurs transferts financiers pour le maintien et la restauration de la biodiversité sont discutés ; par exemple abonder au nouveau Fonds mondial du Cadre sur la Biodiversité, lancé en 2023 dans le cadre du Fonds pour l’environnement mondial (FEM). Mais des acteurs de la société civile soulignent d’une part le manque de transparence et d’accessibilité des fonds du FEM pour les pays pauvres (d’où la demande d’un nouveau mécanisme financier par les pays des Suds), d’autre part les subventions aux activités néfastes à la biodiversité - qui se monteraient à 2,6 milliards de dollars par an (soit 2,6% du PIB mondial, selon Earth Track). Ils dénoncent des mécanismes comme les marchés de la biodiversité, les crédits biodiversité, la compensation biodiversité, qualifiés de "fausses solutions", comme le marché ou la compensation carbone, l’encouragement à la participation du secteur privé figurant dans l’Accord de Kuming-Montréal. Tout ce qui pousse vers la notion ambiguë de "bioéconomie", de financiarisation de la biodiversité et de de la nature en général ne remet pas en question les causes structurelles de la destruction de la biodiversité, l’organisation économique productiviste et consumériste, en particulier l’agriculture industrielle et exportatrice, une des grandes causes de la déforestation, qui se poursuit, malgré l’objectif "zéro déforestation" pour 2030 et les OGM (y compris pour les monocultures d’arbres). L’Union européenne (et la Chine) sont à l’origine de "déforestation importée", à cause de leurs importations de soja, d’huile de palme, café, cacao, etc.
Une vigilance s’impose également face aux "solutions climat" misant sur des technologies qui manipuleraient le climat mondial, comme la géoingénierie, dont les répercussions pourraient être désastreuses sur la biodiversité, notamment des océans, déjà mal en point en raison de leur réchauffement et acidification. Jusqu’à présent la Convention sur la Biodiversité a adopté une approche fondée sur un principe de précaution à ce sujet.
Durant la COP16, un "Cadre pour des marchés de crédits biodiversité à haute intégrité" visant à encourager et encadrer les investissements du secteur privé, a été lancé par l’IAPB (International Advisory Panel on Biodiversité Crédits), initiative de la France et Grande-Bretagne prise lors la précédente COP. La notion de "haute intégrité" vient répondre aux critiques sur les risques des mécanismes de "compensation biodiversité" ; un exemple de dérive : les plantations de monocultures d’arbres, censées venir compenser des destructions d’écosystèmes forestiers. Pour ce nouveau Cadre, un crédit biodiversité est défini comme un « certificat qui représente une unité de bénéfices pour la biodiversité qui sont à la fois durables, mesurés, adossés à des preuves tangibles et additionnels à ce qui se serait passé sans intervention". [5]
Récemment la prise en compte du genre (égalité femmes-hommes) a été renforcée. Des organisations de la société civile, notamment féministes, participent aux COP Biodiversité et font des propositions (Cf. ci-dessous sur "COP Biodiversité et genre")
Les 23 objectifs du Cadre mondial pour la biodiversité
Le cadre mondial pour la biodiversité adopté le 19 décembre 2022 comporte quatre objectifs globaux à l’horizon 2050, axés sur la santé des écosystèmes et des espèces, notamment : mettre fin à l’extinction d’origine anthropique d’espèces ; l’utilisation durable de la biodiversité ; le partage équitable d’avantages ; la mise en œuvre ; le financement.
![]() Cible 1 Diminuer à « près de zéro » la perte des aires riches en biodiversité d’ici 2030 (tout en respectant les droits des populations autochtones et des communautés locales).
Cible 1 Diminuer à « près de zéro » la perte des aires riches en biodiversité d’ici 2030 (tout en respectant les droits des populations autochtones et des communautés locales).
![]() Cible 2 S’assurer qu’au moins 30 % des milieux naturels dégradés seront en restauration d’ici 2030.
Cible 2 S’assurer qu’au moins 30 % des milieux naturels dégradés seront en restauration d’ici 2030.
![]() Cible 3 S’assurer que 30 % des milieux terrestres, d’eau douce, côtiers et marins, particulièrement ceux de haute importance pour la biodiversité, seront protégés d’ici 2030.
Cible 3 S’assurer que 30 % des milieux terrestres, d’eau douce, côtiers et marins, particulièrement ceux de haute importance pour la biodiversité, seront protégés d’ici 2030.
![]() Cible 4 Agir pour arrêter l’extinction d’espèces causée par l’humanité et pour favoriser le rétablissement des espèces menacées.
Cible 4 Agir pour arrêter l’extinction d’espèces causée par l’humanité et pour favoriser le rétablissement des espèces menacées.
![]() Cible 5 S’assurer que la récolte d’espèces sauvages est faite de manière « durable, sécuritaire et légale », prévenir la surexploitation et réduire les risques de « débordement » des pathogènes d’une espèce à l’autre.
Cible 5 S’assurer que la récolte d’espèces sauvages est faite de manière « durable, sécuritaire et légale », prévenir la surexploitation et réduire les risques de « débordement » des pathogènes d’une espèce à l’autre.
![]() Cible 6 Réduire les conséquences des espèces exotiques envahissantes ; diminuer de 50 % les taux d’introduction de ces espèces d’ici 2030.
Cible 6 Réduire les conséquences des espèces exotiques envahissantes ; diminuer de 50 % les taux d’introduction de ces espèces d’ici 2030.
![]() Cible 7 Réduire les risques créés par la pollution d’ici 2030 à des niveaux qui ne soient pas dangereux pour la biodiversité. (Notamment, réduire de 50 % les pertes de nutriments dans l’environnement, de 50 % les risques associés aux pesticides et travailler vers l’élimination de la pollution par le plastique).
Cible 7 Réduire les risques créés par la pollution d’ici 2030 à des niveaux qui ne soient pas dangereux pour la biodiversité. (Notamment, réduire de 50 % les pertes de nutriments dans l’environnement, de 50 % les risques associés aux pesticides et travailler vers l’élimination de la pollution par le plastique).
![]() Cible 8 Réduire les conséquences des changements climatiques et de l’acidification des océans sur la biodiversité, notamment avec des « solutions fondées sur la nature » et/ou des « approches basées sur les écosystèmes ».
Cible 8 Réduire les conséquences des changements climatiques et de l’acidification des océans sur la biodiversité, notamment avec des « solutions fondées sur la nature » et/ou des « approches basées sur les écosystèmes ».
![]() Cible 9 S’assurer d’une gestion soutenable des espèces sauvages, de manière à fournir des bénéfices « sociaux, économiques et environnementaux » aux communautés qui en dépendent.
Cible 9 S’assurer d’une gestion soutenable des espèces sauvages, de manière à fournir des bénéfices « sociaux, économiques et environnementaux » aux communautés qui en dépendent.
![]() Cible 10 S’assurer d’une gestion durable des territoires où l’on pratique l’agriculture, l’aquaculture, les pêcheries et la foresterie.
Cible 10 S’assurer d’une gestion durable des territoires où l’on pratique l’agriculture, l’aquaculture, les pêcheries et la foresterie.
![]() Cible 11 Restaurer et rehausser les services écosystémiques, comme la santé des sols et la pollinisation, avec des « solutions fondées sur la nature » et/ou des « approches basées sur les écosystèmes ».
Cible 11 Restaurer et rehausser les services écosystémiques, comme la santé des sols et la pollinisation, avec des « solutions fondées sur la nature » et/ou des « approches basées sur les écosystèmes ».
![]() Cible 12 Accroître significativement les espaces « bleus » et « verts » dans les milieux urbains.
Cible 12 Accroître significativement les espaces « bleus » et « verts » dans les milieux urbains.
![]() Cible 13 Agir pour s’assurer du partage « juste et équitable » des bénéfices découlant de l’utilisation des données génétiques. D’ici 2030, arriver à un accroissement significatif du partage de ces bénéfices.
Cible 13 Agir pour s’assurer du partage « juste et équitable » des bénéfices découlant de l’utilisation des données génétiques. D’ici 2030, arriver à un accroissement significatif du partage de ces bénéfices.
![]() Cible 14 Intégrer pleinement la question de la biodiversité dans l’ensemble des politiques publiques, notamment celles liées au développement.
Cible 14 Intégrer pleinement la question de la biodiversité dans l’ensemble des politiques publiques, notamment celles liées au développement.
![]() Cible 15 Agir pour que les grandes entreprises rendent des comptes au sujet de leurs effets sur la biodiversité et réduisent leurs conséquences négatives sur la nature.
Cible 15 Agir pour que les grandes entreprises rendent des comptes au sujet de leurs effets sur la biodiversité et réduisent leurs conséquences négatives sur la nature.
![]() Cible 16 Encourager des choix de consommation durable. D’ici 2030, réduire l’empreinte mondiale de la consommation, réduire de 50 % les déchets alimentaires, réduire « significativement » la surconsommation, de même que la création de déchets.
Cible 16 Encourager des choix de consommation durable. D’ici 2030, réduire l’empreinte mondiale de la consommation, réduire de 50 % les déchets alimentaires, réduire « significativement » la surconsommation, de même que la création de déchets.
![]() Cible 17 Mettre en oeuvre les mesures de biosécurité et de manipulation de la biotechnologie stipulées dans certains articles de la Convention sur la diversité biologique.
Cible 17 Mettre en oeuvre les mesures de biosécurité et de manipulation de la biotechnologie stipulées dans certains articles de la Convention sur la diversité biologique.
![]() Cible 18 Recenser les subventions néfastes pour la biodiversité d’ici 2025. Les réduire d’au moins 500 milliards de dollars d’ici 2030.
Cible 18 Recenser les subventions néfastes pour la biodiversité d’ici 2025. Les réduire d’au moins 500 milliards de dollars d’ici 2030.
![]() Cible 19 Mobiliser au moins 200 milliards de dollars par année d’ici 2030 pour protéger la biodiversité dans le monde. Les pays développés s’engagent à verser 20 milliards par an d’ici 2025, et 30 milliards d’ici 2030, aux pays en développement [6] pour leurs efforts pour la biodiversité, à doubler l’aide publique au développement dédiée à la biodiversité en 2025 et la tripler d’ici 2030. Tous les pays s’engagent à réduire de 500 milliards de dollars les subventions néfastes à la nature d’ici 2030. (L’accord prévoit aussi d’accroître le recours aux fonds privés et la mise en place de « mécanismes innovants », comme les paiements pour les services écosystémiques et les crédits compensatoires pour la biodiversité).
Cible 19 Mobiliser au moins 200 milliards de dollars par année d’ici 2030 pour protéger la biodiversité dans le monde. Les pays développés s’engagent à verser 20 milliards par an d’ici 2025, et 30 milliards d’ici 2030, aux pays en développement [6] pour leurs efforts pour la biodiversité, à doubler l’aide publique au développement dédiée à la biodiversité en 2025 et la tripler d’ici 2030. Tous les pays s’engagent à réduire de 500 milliards de dollars les subventions néfastes à la nature d’ici 2030. (L’accord prévoit aussi d’accroître le recours aux fonds privés et la mise en place de « mécanismes innovants », comme les paiements pour les services écosystémiques et les crédits compensatoires pour la biodiversité).
![]() Cible 20 Favoriser la coopération scientifique entre les pays du Nord et ceux du Sud au sujet de l’exploitation durable de la nature et de sa protection.
Cible 20 Favoriser la coopération scientifique entre les pays du Nord et ceux du Sud au sujet de l’exploitation durable de la nature et de sa protection.
![]() Cible 21 S’assurer que les meilleures informations sont disponibles pour la prise de décisions en lien avec la biodiversité. S’assurer que les connaissances autochtones sont utilisées avec le plein consentement de leurs détenteurs.
Cible 21 S’assurer que les meilleures informations sont disponibles pour la prise de décisions en lien avec la biodiversité. S’assurer que les connaissances autochtones sont utilisées avec le plein consentement de leurs détenteurs.
![]() Cible 22 S’assurer que la prise de décisions au sujet de la biodiversité se fait de manière inclusive, dans le respect des femmes, des jeunes, des peuples autochtones et des personnes handicapées.
Cible 22 S’assurer que la prise de décisions au sujet de la biodiversité se fait de manière inclusive, dans le respect des femmes, des jeunes, des peuples autochtones et des personnes handicapées.
![]() Cible 23 S’assurer que la mise en oeuvre du cadre de l’accord de Kunming-Montréal est réalisée dans une perspective d’égalité de genre.
Cible 23 S’assurer que la mise en oeuvre du cadre de l’accord de Kunming-Montréal est réalisée dans une perspective d’égalité de genre.
Le Cadre de suivi comporte un ensemble d’indicateurs pour suivre les progrès vers les objectifs et les cibles. Il comprend des indicateurs clés pour le suivi national, régional et mondial, ainsi que des indicateurs complémentaires. Il continue d’être développé par l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques (SBSTTA) et la Conférence des Parties à la CBD.
COP Biodiversité et genre
L’importance d’intégrer les enjeux de genre et égalité femmes-hommes se pose dans domaine de la biodiversité comme dans celui du climat. Les femmes ont un rôle spécifique dans la préservation et la gestion de la biodiversité et des ressources naturelles dans les pays des Suds et dans le domaine agricole. Par exemple, près de 80 % des habitant-es des zones rurales des pays en développement, dont une majorité de femmes, ont recours à des plantes pour se soigner de façon traditionnelle. La perte de biodiversité augmente la charge de travail non rémunéré des femmes et la précarité des agricultrices.
Le Cadre mondial de la biodiversité Kunming-Montréal adopté en 2022 reconnaît que « la mise en œuvre réussie du Cadre dépendra de la garantie de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes et des filles, et de la réduction des inégalités ».
Il a adopté une cible 23 " Assurer l’égalité des genres dans la mise en œuvre du cadre grâce à une approche tenant compte du genre, permettant à toutes les femmes et à toutes les filles de bénéficier des mêmes possibilités et capacités de contribuer à la réalisation des trois objectifs de la Convention, notamment en reconnaissant l’égalité de leurs droits et de leur accès aux terres et aux ressources naturelles, ainsi qu’en favorisant leur participation et leur leadership pleins, équitables, significatifs et éclairés à tous les niveaux de l’action, de la participation, de l’élaboration des politiques et de la prise de décision en matière de biodiversité".
Les Parties à la Convention sur la diversité biologique (CDB) ont également adopté un Plan d’action pour l’égalité des sexes (GPA) pour guider les Parties dans le suivi d’une approche sensible au genre.
Le réseau https://www.women4biodiversity.org/ rassemble les organisations de femmes et féministes qui élaborent des positions et sont représentées aux COP Biodiversité. Un enjeu de la COP16, après l’adoption de l’objectif 23 sur l’égalité de genre, est la formulation d’indicateurs sensibles au genre.. Constatant la faiblesse des indicateurs de genre, le réseau Women4biodiversity a mené un gros travail au niveau international, en partenariat avec l’ONU-WCMC et avec l’appui de Swedbio, pour formuler un cadre méthodologique et organiser des formations. (Cf. ici, en anglais). Ce travail a été restitué lors d’un événement officiel le 21 octobre à la COP16 " Progress on the indicator methodology to measure the national implementation of the Gender Plan of Action".
A la COP16, les organisations féministes réunies dans le "caucus femmes" plaident pour une mise en oeuvre effective et immédiate de l’objectif 23 du Cadre mondial sur la biodiversité et du Plan d’action genre de la Convention Biodiversité, avec une vision transversale de la justice de genre dans toutes les décisions. Détails et document en différentes langues. Le Forum des femmes se tient en deux parties, le 25 et le 29 octobre à la COP16 (zone bleue).
Ressources documentaires
Textes et sites web officiels
![]() Site web de la Convention Biodiversité
Site web de la Convention Biodiversité
![]() CBD, COP16
CBD, COP16
![]() Site web de la COP 16 Biodiversité présidée par la Colombie
Site web de la COP 16 Biodiversité présidée par la Colombie
![]() Décisions officielles prises à la COP16
Décisions officielles prises à la COP16
![]() Télécharger le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal
Télécharger le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal
![]() Télécharger le cadre de suivi avec les indicateurs
Télécharger le cadre de suivi avec les indicateurs
![]() Répertoire des Stratégies nationales Biodiversité
Répertoire des Stratégies nationales Biodiversité
![]() Décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes, 2021-2030
Décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes, 2021-2030
![]() Convention internationale sur la biodiversité (1992)
Convention internationale sur la biodiversité (1992)
![]() Programme des Nations unies pour l’Environnement, Biodiversité
Programme des Nations unies pour l’Environnement, Biodiversité
![]() Suivi de la biodiversité et indicateurs, UN Environment Programme World Conservation Monitoring Centre
Suivi de la biodiversité et indicateurs, UN Environment Programme World Conservation Monitoring Centre
![]() Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques IPBES
Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques IPBES
![]() Rapport IPBS "The global assessment report on Biodiversity and ecosystem services", summary, 2019. Télécharger (en anglais, 60 p.)
Rapport IPBS "The global assessment report on Biodiversity and ecosystem services", summary, 2019. Télécharger (en anglais, 60 p.)
![]() Journée mondiale de la Diversité Biologique, 22 mai
Journée mondiale de la Diversité Biologique, 22 mai
![]() Programme des Nations unies pour l’Environnement
Programme des Nations unies pour l’Environnement
![]() Fonds mondial du Cadre sur la Biodiversité (Global Biodiversity Framework Fund (GBFF)
Fonds mondial du Cadre sur la Biodiversité (Global Biodiversity Framework Fund (GBFF)
![]() Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN) du PNUD (Programme des Nations unies pour le développement)
Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN) du PNUD (Programme des Nations unies pour le développement)
![]() Protected Planet Report, 2024
Protected Planet Report, 2024
![]() Objectif de développement durable n°15 "Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres" ; n°14 "Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines
Objectif de développement durable n°15 "Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres" ; n°14 "Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines
![]() France : Stratégie nationale biodiversité 2030
France : Stratégie nationale biodiversité 2030
![]() Union européenne : Stratégie européenne Biodiversité 2030
Union européenne : Stratégie européenne Biodiversité 2030
![]() Base de données des stratégies et rapports nationaux sur la biodiversité
Base de données des stratégies et rapports nationaux sur la biodiversité
Genre et biodiversité
![]() Suivi féministe des COP biodiversité https://www.women4biodiversity.org/
Suivi féministe des COP biodiversité https://www.women4biodiversity.org/
![]() "L’égalité des sexes et la Convention sur la diversité biologique : une compilation des textes de décision de la COP1 à la COP15". Disponible en français, anglais, espagnol
"L’égalité des sexes et la Convention sur la diversité biologique : une compilation des textes de décision de la COP1 à la COP15". Disponible en français, anglais, espagnol
![]() Rubrique genre de la CBD
Rubrique genre de la CBD
![]() Genre et biodiversité, détails de l’Objectif 23 du Cadre mondial pour la biodiversité
Genre et biodiversité, détails de l’Objectif 23 du Cadre mondial pour la biodiversité
![]() Cadre mondial Biodiversité, Objectif 23 sur l’égalité de genre
Cadre mondial Biodiversité, Objectif 23 sur l’égalité de genre
![]() Gender Action Plan adopté par la CBD en 2022. Télécharger (en anglais)
Gender Action Plan adopté par la CBD en 2022. Télécharger (en anglais)
![]() Indicateurs de genre et biodiversité (en anglais) https://gbf-indicators.org/metadata...
Indicateurs de genre et biodiversité (en anglais) https://gbf-indicators.org/metadata...
![]() Processus méthodologique pour élaborer des indicateurs genre biodiversité
Processus méthodologique pour élaborer des indicateurs genre biodiversité
![]() Vidéos des formations genre, biodiversité, indicateurs (anglais, français, espagnol)
Vidéos des formations genre, biodiversité, indicateurs (anglais, français, espagnol)
![]() Gender and Biodiversity : A Data brief, ONU Femmes, octobre 2024. Télécharger (en anglais
Gender and Biodiversity : A Data brief, ONU Femmes, octobre 2024. Télécharger (en anglais
![]() Placing gender equality at the heart of the implementation of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework ; octobre 2024 Télécharger (en anglais)
Placing gender equality at the heart of the implementation of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework ; octobre 2024 Télécharger (en anglais)
![]() Document de plaidoyer des femmes en 28 points pour la COP 16 (télécharger en français)
Document de plaidoyer des femmes en 28 points pour la COP 16 (télécharger en français)
![]() Evénements féministes à la COP16 organisés par Women’s Earth and Climate Action Network (WECAN)
Evénements féministes à la COP16 organisés par Women’s Earth and Climate Action Network (WECAN)
Documents d’organisations de la société civile
![]() "From Agreements to Actions. A guide to applying a human rights-based approach to the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework", 2024. Télécharger (en anglais)
"From Agreements to Actions. A guide to applying a human rights-based approach to the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework", 2024. Télécharger (en anglais)
![]() La biodiversité au coeur de la crise climatique – Décryptage COP16. Réseau Action Climat
La biodiversité au coeur de la crise climatique – Décryptage COP16. Réseau Action Climat
![]() Rapport Planète Vivante 2024, WWF
Rapport Planète Vivante 2024, WWF
![]() https://www.earthtrack.net/ : suivi des subventions publiques néfastes pour la biodiversité
https://www.earthtrack.net/ : suivi des subventions publiques néfastes pour la biodiversité
![]() Suivi des Plans d’action Biodiversité des pays : le WWF’s NBSAP Tracker
Suivi des Plans d’action Biodiversité des pays : le WWF’s NBSAP Tracker
![]() Plaidoyer du collectif Hand Off Mother Earth "Stop Geoengineering, Our home is not a Laboratory". Télécharger la note en français
Plaidoyer du collectif Hand Off Mother Earth "Stop Geoengineering, Our home is not a Laboratory". Télécharger la note en français
![]() The Risks of Geoengineering : Accelerating Biodiversity Loss and Compounding Planetary Crises https://www.ciel.org/reports/risks-..., Centre for Environmental Law, octobre 2024
The Risks of Geoengineering : Accelerating Biodiversity Loss and Compounding Planetary Crises https://www.ciel.org/reports/risks-..., Centre for Environmental Law, octobre 2024
![]() Suivi des engagements en matière de lutte contre la déforestation par Forest Declaration Assessment, Télécharger le rapport Forest under Fire, octobre 2024 en anglais)
Suivi des engagements en matière de lutte contre la déforestation par Forest Declaration Assessment, Télécharger le rapport Forest under Fire, octobre 2024 en anglais)
![]() Compensations et plantations en monoculture : des menaces croissantes pour les territoires. Mouvement Mondial pour les Forêts Tropicales (WRM). Bulletin octobre 2024 (télécharger 32 p.)
Compensations et plantations en monoculture : des menaces croissantes pour les territoires. Mouvement Mondial pour les Forêts Tropicales (WRM). Bulletin octobre 2024 (télécharger 32 p.)
![]() Déclaration de la société civile sur les mesures compensatoires et les crédits en faveur de la biodiversité
Déclaration de la société civile sur les mesures compensatoires et les crédits en faveur de la biodiversité
![]() International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) ; Télécharger "The Indigenous World 2024" (pdf en anglais, 688 p.)
International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) ; Télécharger "The Indigenous World 2024" (pdf en anglais, 688 p.)
Notes
[1] 2015-2024 était pour l’ONU la Décennie internationale des personnes d’origine afrodescendante https://www.un.org/fr/observances/decade-people-african-descent.
[3] Dans la mise à jour de la Liste rouge des espèces menacées. La Liste rouge de l’UICN comprend 166 061 espèces, dont 46 337 sont menacées d’extinction : https://iucn.org/fr/communique-de-presse/202410/plus-dune-espece-darbre-sur-trois-dans-le-monde-est-menacee-dextinction.
[4] « les stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité sont le principal instrument de mise en œuvre de la Convention au niveau national et les rapports nationaux sont le principal instrument de suivi et d’examen de la mise en œuvre de la Convention et du cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal » (Décision 15/6 « Mécanismes de planification, de suivi, de notification et d’examen »).
[5] "L’intégrité signifie que les crédits doivent être conçus de manière à apporter des bienfaits mesurables et vérifiés pour la Nature, à garantir une participation et des revenus équitables pour les personnes et à reposer sur des marchés bien encadrés". Présentation et téléchargement du cadre https://sites.google.com/iapbiocredits.org/iapbfr/le-cadre
[6] Selon l’OCDE le montant réellement versé était de 15,7 milliards en 2022
titre documents joints
- Cadre mondial sur la Biodiversité adopté 2022 (PDF - 308.3 ko)
- Gender Action Plan Biodiversity 2022 (PDF - 329.3 ko)
- Cadre de suivi et indicateurs Biodiversité (PDF - 518.8 ko)